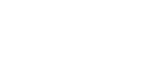Risquer la noyade dans La maison d’Ophélie [1]
Risquer la noyade dans La maison d’Ophélie
Ses vêtements se sont étalés et l’ont soutenue un moment, nouvelle sirène, pendant qu’elle chantait des bribes de vieilles chansons, comme insensible à sa propre détresse […]. (Shakespeare, Hamlet)
Dans Le Ciel de Bay City, Catherine Mavrikakis écrivait: «À Bay City, je n'ai que la mort dans l'âme [...]. je me prends pour une Ophélie verte, chancie, retrouvée noyée au fond de la piscine bleue de ma tante.» Convoquer Ophélie est peut-être nécessaire pour rendre convaincantes les histoires tragiques des Nord-Américaines, princesses torturées au royaume du Plastique. L’inoffensive piscine creusée apparaît soudainement suspecte, menaçant d’engloutir ce qu’il nous reste de raison et d’humanité.
Dix ans plus tôt, Carole David nous faisait entrer dans la maison d’Ophélie et inaugurait ce qu’on pourrait appeler un «lyrisme de banlieue». La première partie, intitulée «En eau profonde», est composée d’un long poème marqué par la scansion des vers «Me voilà» et «Oh mon Dieu!». «Me voilà», dit la narratrice, me voilà sans mots, gesticulant au milieu d’objets trop connus, ma voix s’y perd et s’y éteint. «Oh mon dieu», faites que je sois vivante, croit-on entendre, faites que je ne sois pas déjà morte sans le savoir. «C’est ma vie, pense-t-elle / c’est mon unique vie / et cette maison me l’a arrachée» (37*). Le poème semble chercher la confirmation qu’il y a bien quelque chose là, dans cette vie qui grouille tout autour, des êtres vivants qui circulent, qui souffrent, qui baisent, qui mangent, «Oh mon dieu», faites qu’il y ait quelque chose là. La poète semble demander ce qu’il faut y voir, ce qu’il faut y lire, mais elle n’a plus de mots, même plus de nom.

Chez David, la plongée dans l’aliénation sert à mieux révéler l’épaisseur du réel. Comme s’il fallait se maintenir au bord de l’asphyxie pour redonner au paysage l’intensité de ses couleurs, aux objets la diversité de leurs textures.

La poète entreprend de dévoiler le plus banal et le moins secret pour faire émerger un peu de passion, un peu de suspense. La deuxième partie du recueil est intitulée «Métamorphoses» et les poèmes portent les titres de films et d’émissions de télévision populaires: Ma sorcière bien-aimée, Twilight Zone, Alien, Body Snatchers… Les moments de révélation se succèdent, devant la télévision ou en brossant le chien, même si le contenu de cette révélation reste informulé. Pourtant, le mystère renaît, l’espace se complexifie, la narratrice s’invente des labyrinthes, des coins sombres, des caves secrètes où les images et les signes les plus courants se trouvent tordus, réagencés. Les murs de la maison jouent le rôle d’un écran où l’on peut projeter une vie si semblable à la nôtre, mais qui ressemble aussi aux émissions d’après-midi au canal 10. Ces paysages vrais-faux l’accompagnent dans sa quête de transcendance, comme s’il suffisait d’enfiler les mots les uns derrière les autres pour être délivré de leur trivialité. L’exercice apparaît simple: remâcher les mots les plus connus, re-mettre en scène sans cesse les même actes dérisoires jusqu’à leur donner l’ampleur de rites sacrés.
Quête de sens et quête de foi s’entremêlent, l’intertexte biblique se confondant avec les références populaires. Dans la troisième et dernière partie, «Mystères insolubles», la narratrice entourée de ses objets, derniers compagnons qui la trahiront probablement, se prépare pour la Dernière Cène, l’ultime repas, où on peut imaginer le partage des chaussons Pillsbury, seul rituel de communion encore possible. On aurait préféré que la poète garde fermées les portes et fenêtres de son bungalow, qu’elle ne nous attire pas dans les eaux troubles de sa vie ordinaire pour menacer de nous y perdre avec elle. On aurait préféré qu’elle garde pour elle ses secrets de petite ménagère. Elle s’en excuse elle-même et je vous laisse sur ces mots de repentance :

*Les citations sont tirées de Carole David, La maison d'Ophélie, Montréal, Les herbes rouges, 1998.