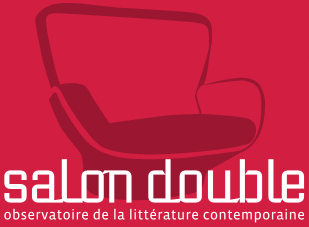Ceci n’est pas un roman sur le chiac
Depuis le grandiose essai Les littératures de l’exiguïté (1992) de François Paré, il est difficile de penser les littératures francophones du Canada autrement qu’à partir du spectre de la minorisation. Paré définit cet état d’esprit du minoritaire comme «une condition absolue du désespoir de ne jamais pouvoir s’accomplir dans le discours dominant» (1992: 14). Or, la lecture de Pour sûr, de France Daigle, qui vient de gagner le prix du Gouverneur général du Canada catégorie fiction, offre un vif contraste avec la vision pessimiste de la démarche des artistes en milieux minoritaires que propose Paré.
Ce «roman cubique» comporte 144 trames thématiques divisées elles-mêmes en 12 ramifications, le tout donnant 1728 (soit 12³) fragments liés par de nombreux artifices langagiers –par exemple, le juron «Saint-Simonaque» (218) ouvre la trame thématique intitulée « La vie des Saints » − et allusions (une référence à Rimbaud devient prétexte à décrire la couleur de dizaines de mots) afin de créer un effet de résonnance. Les descriptions de moments du quotidien d’un couple d’Acadiens et de leurs voisins et amis dominent cette narration éclatée. Daigle insère aussi de nombreuses informations encyclopédiques, qu’elle nomme elle-même des «parenthèses» (610), à propos d’une panoplie de thèmes allant de la broderie aux patates, en passant par les dictionnaires, la langue, la typographie, l’imprimerie, les bibliothèques et les ouvrages de référence sur le jeu de Scrabble. Impossible de ne pas voir dans l’usage de ces fragments réflexifs sur l’histoire de la langue française et de la philologie qui côtoient les propres préoccupations langagières des personnages une sorte de volonté d’inscrire le chiac à l’intérieur d’une constellation épistémologique plus «universelle». Qu’est-ce qu’une langue s’il n’y a pas de dictionnaire pour attester son existence? Daigle pousse d’ailleurs sa transcription du chiac à un tout nouveau degré. Le tilde indique notamment la prononciation de certains termes anglais comme l’expression récurrente «Rĩght õn!» Dans un des nombreux passages méta-réflexifs du livre dans lesquels on ressent que l’auteure utilise ses personnages comme des porte-voix pour véhiculer ses propres préoccupations esthétiques, le locuteur anonyme d’un «dialogue en vrac» mentionne non sans ironie: «Faut-y parler comme qu’on écrit ou ben don écrire comme qu’on parle?» (206) Il y a donc une célébration d’une langue vernaculaire bien vivante mais dont plusieurs ont aussi honte : le chiac n’est-il pas un simple appauvrissement du français, un signe de paresse linguistique? Les parents Carmen et Terry n’essaient-ils pas devant leurs enfants de minimiser l’usage d’anglicismes propres au chiac? Pour sûr, par conséquent, n’apparaît pas comme un pamphlet, une « Défense et illustration du chiac », mais bien la transcription d’une parole (au sens saussurien) la plus authentique possible.
C’est d’ailleurs l’impression forte qui me reste après la lecture de ce pavé monumental de 750 pages: nous n’avons pas affaire à une quête de l’exotisme acadien. Les personnages résident bel et bien dans une capitale urbaine et culturelle nord-américaine où ils vivent des existences typiques. Comme l’expliquait Benoit Doyon-Gosselin à propos du portrait de Moncton dans les textes récents de France Daigle: «D’habitat qu’elle était, la ville devient habitée, c’est-à-dire un espace métonymique de la condition moderne.» (2008 : 339) Bien que la minorisation demeure un phénomène inévitable, Pour sûr témoigne d’une certaine volonté –accidentelle ou volontaire, peu importe− de montrer l’envers du décor, de transmettre une parole qui évoque le plaisir (coupable) de parler chiac, sans pour autant donner une impression de déni. C’est pourquoi Pour sûr apparaît comme un roman aussi exact.
Références
DOYON-GOSSELIN, Benoit (2008). «Pour une herméneutique de l’espace: l’œuvre romanesque de J.R. Léveillé et France Daigle», thèse de doctorat en études littéraires, Moncton, Université de Moncton.
PARÉ, François (1994). Les littératures de l’exiguïté, Hearst, Le Nordir.