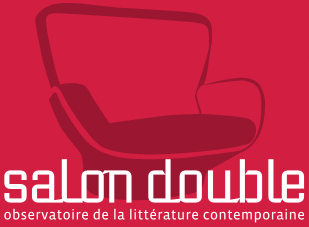Dénaturer un combat
C’est peut-être un accès de chauvinisme qui m’a poussée vers le premier roman d’Emily St. John Mandel, Last Night in Montreal. Si l’auteure m’était inconnue, le titre du roman, lui, piquait ma curiosité, comme si ma ville d’origine pouvait se révéler davantage à travers des yeux étrangers. Malheureusement, la réalité politique et sociale complexe de la métropole est ici mise au service d’un récit improbable qui pousse à son maximum le concept de «licence poétique».
La disparition est au cœur du roman: celle de Lilia, enlevée par son père alors qu’elle avait sept ans, et celles qu’étudie Eli, amant de Lilia à New York, dont les travaux portent sur les langues menacées d’extinction. Désormais adulte et libre, Lilia continue néanmoins d’errer de ville en ville et s’enfuit sans crier gare pour Montréal, où Eli part à sa recherche. Or, dès le départ, quelque chose cloche dans la manière qu’a l’auteure de dépeindre son univers. Lilia est l’objet de toutes les fascinations mais l’impact qu’elle a sur la vie des personnages est inversement proportionnel au charisme qu’elle dégage pour le lecteur. Pas très crédible, le policier montréalais qui étudie son cas, aussi artiste de cirque, cogite Shakespeare au lit et sacrifie sa vie et sa famille pour retrouver Lilia, dont le cas ne semble franchement pas mériter autant d’attention.
Le sort de Montréal exemplifie ce travers: St. John Mandel fait de la métropole une terre hostile où il est interdit de parler anglais sous peine d’être ostracisé. Eli, en débarquant à la Gare Centrale, est ridiculisé parce qu’il est américain, et son amie perd son emploi dans une boutique parce qu’elle oublie par inadvertance de saluer un client en français. De longues pages sont consacrées à raconter les absurdités de la loi 101 dans cette métropole où les anglophones vivent dans la terreur, et toutes ces énormités, loin d’être le fruit d’une réflexion politique quelconque, ne semblent là que pour rajouter un peu d’atmosphère au récit, le dramatiser. Pour les lieux comme pour les personnages, ces descriptions donnent le sentiment que la romancière préfère se complaire dans une idée séduisante, mais en rien ancrée dans le réel, que de véritablement creuser le détail des lieux et des personnages qu’elle met en scène. Ce défaut majeur ne ressortirait pas autant si la narration n’était aussi sage et sobre, mais devant ce style mesuré, il n’y a pas moyen d’excuser le romantisme exagéré du récit comme relevant d’un parti pris esthétique précis. Il apparaît plus simplement que le regard de l’auteure manque de justesse, au point de dénaturer des enjeux linguistiques importants pour alimenter le roman en rebondissements.