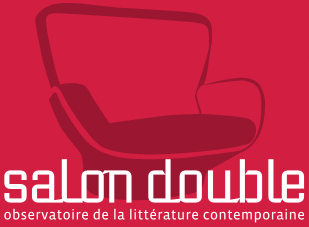La revitalisation d'une ville américaine parmi tant d'autres
Difficile pour moi de ne pas voir dans le récit des grandeurs et misères de la ville d’Arvida, au Saguenay, par Samuel Archibald, le reflet du destin de toutes les petites villes des régions québécoises, voire nord-américaines. Lorsque le conteur nous décrit cette localité vivant au crochet de l’usine d’aluminium Alcan – «où mon grand-père le père de ma mère a travaillé toute sa vie»– comme une «ville modèle» ou comme «la petite utopie d’un milliardaire philanthrope, montée de toutes pièces au milieu de nulle part» (208), je ne peux que penser au «complexe de Kalamazoo» que décrit Pierre Nepveu dans Intérieurs du Nouveau Monde (1998). Arvida semble a priori une métonymie de toutes ces municipalités ennuyantes développées trop rapidement dans l’euphorie du peuplement de l’Ouest américain et du Nord québécois. Comme l’écrit Nepveu à propos de Kalamazoo, au Michigan: «C’est aussi cela, l’Amérique : une petite ville devenue le fantôme ou le pâle souvenir d’une ville du Far-West, dans laquelle plus grand-chose n’arrive sinon des faits divers» (273). Arvida connote bien ce «rêve américain» éphémère que ces villes industrielles ont convié. D’ailleurs, l’énumération des nationalités fondatrices d’Arvida –Américains, Anglais, Russe, Italien, Polonais, Hollandais, Grecs, un Japonais et bien sûr les Irlandais et Écossais– renforce cette impression: «Tous ces gens étaient venus à Arvida, conclut Archibald, attirés par une version nordique de l’El Dorado, un rêve américain délocalisé de quelques milliers de kilomètres. Ils étaient venus pour oublier des choses bien souvent et jamais, au grand jamais, pour se souvenir de quoi que ce soit» (212). Arvida réunit tous ces mythes fondateurs nord-américains : le creuset des nationalités, l’exploitation de la nature, l’attrait de la richesse.
Arvida, c’est une petite ville américaine mais renfermée. Deux épisodes burlesques, exubérants, traitent de road trips avortés et dérisoires. Que ce soit un trio de sympathiques perdants ivres tentant en vain de faire passer une jeune femme louche au-delà de la frontière canado-américaine ou bien ce «voyageur» nommé ironiquement «Menaud», une allusion au célèbre draveur de Félix-Antoine Savard, qui parcourt la Nouvelle-Écosse sur les routes en dormant sur le siège de passager, l’appel des grands espaces typique des sociétés nord-américaines ne parvient plus à résonner. Fusionnée avec Jonquière, dépourvue de ses familles fondatrices, l’Arvida contemporaine qu’Archibald esquisse semble dépourvue de sa magie d’antan. On la devine touchée elle aussi de cet exode rural (ou, comme le politiquement correct le recommande aujourd’hui, la «dévitalisation» des régions) contre lequel elle ne trouve pas de réponse.
Reste la magie du verbe. L’âme du conteur qui anime le projet d’Archibald parvient à transcender la banalité du complexe de Kalamazoo. Arvida redonne à un espace apparemment banal une aura, une profondeur parfois magique, souvent fantastique, toujours captivante. Que Pierre Nepveu condamne ces villes à l’ennui du fait divers ne dérange pas Archibald. Au contraire, la verve de son écriture parvient à sublimer le fait divers en une légende rurale digne des plus grands contes fantastiques du terroir canadien-français. Si cette ville du Saguenay peine aujourd’hui à renouveler sa population, elle peut toujours se consoler en se disant que Samuel Archibald a su enrichir son imaginaire, sa mystique.