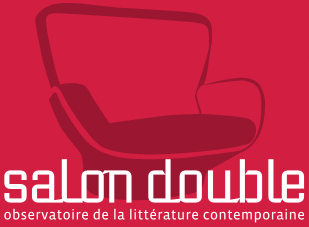Les heures de bureau
En 2004, dans un entretien entre David Foster Wallace et Michael Goldfarb, ce dernier remarquait que les écrivains américains contemporains semblent éviter le thème du travail, peut-être parce qu'ils n'en ont pas l'expérience, ou encore parce que la perspective de sonder le monde du travail est tout simplement terrifiante. Le roman posthume de Wallace, The Pale King, qui porte essentiellement sur les services d'imposition américains, laissait entrevoir l'une des difficultés majeures qu'il y a à traiter ce thème: la vie de bureaucrate est monotone, terne, répétitive et constitue, pourrait-on croire, le sujet antiromanesque par excellence. Le premier roman de Joshua Ferris, Then We Came to the End, évite les écueils du sujet en jouant sur deux plans. Le roman met en scène les travailleurs d'une agence de publicité. Narré essentiellement à la première personne du pluriel, il laisse entendre que l'identité des travailleurs est diluée dans un NOUS corporatif représentant davantage la réalité abstraite de l'entreprise que la véritable subjectivité des gens qui y travaillent. D'un autre côté, le roman insiste sur les relations entre collègues, sur les rumeurs qui circulent de cubicule en cubicule, sur les mauvais coups visant à injecter un peu de couleur dans la grisaille du quotidien. Ce combat entre les forces affirmatives des sujets et leur réification par l'entreprise constitue le nœud du roman de Ferris. On y sent une forte volonté d'éviter la caricature d'une vision aigrie. Or, cet effort trop appuyé constitue à la fois la force et la faiblesse du livre: d'un côté, on a envie de saluer l'effort pour nuancer une réalité complexe. De l'autre, on a l'impression que le roman cherche à démontrer une vérité un peu trop banale: oui, le monde du travail est difficile, mais d'un autre côté, il est possible, par moments, d'y être heureux. Then We Came to the End est un roman qui vaut tout de même le détour, ne serait-ce que pour ces nombreuses scènes où la voix narrative rend avec justesse la réalité complexe du quotidien, à la fois drôle et triste, et l'étrange banalité des gestes ayant perdu leur sens à force d'être répétés de neuf à cinq, la ritournelle des vestons-cravates sans corps.