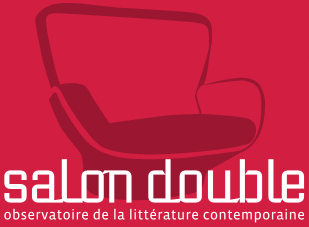Les rejetons du nomade fantasmatique
Dans une trilogie qui comprend les romans La longue portée (1998), La tierce personne (2000) et L’Ange au berceau (2002), Serge Lamothe décrit la trajectoire embrouillée de la famille Godin sur cinq générations d’hommes. Le premier roman raconte la dernière nuit de l’ex-junkie Charles Godin qui rédige son testament moral à son fils, Simon. Le second relate le témoignage du psychopathe Mathieu Arbour qui révèle avoir manipulé Charles afin de se venger du suicide de son frère Luc, qu’il croit être le véritable géniteur de Simon. Le dernier roman montre comment Simon tente de décrypter les mensonges et les fabulations des deux premiers récits afin de se réconcilier avec ses origines. L’ambitieuse construction narrative de Lamothe génère une sorte de «lecture policière» où le lecteur doit, à l’image de Simon, évaluer la véracité des preuves matérielles qu’il découvre et des témoignages que laissent les narrations non-fiables[1].
Symbole ultime de la perpétuation des traditions et des valeurs, la famille se révèle comme un fantasme pour les trois protagonistes accablés par la séparation de leurs parents. Ainsi, Charles rejette son père banquier au profit d’un «géniteur occulte» (1998: 29), son bisaïeul Armand Godin, soi-disant pirate et contrebandier d’alcool, en qui il projette «l’esprit d’aventure, le souffle de la liberté» (1998: 31). Dans le troisième roman, Simon apprend d’ailleurs que son grand-père, Al, entretenait lui aussi secrètement le culte du Armand mythique ayant simulé sa mort, au point d’imiter son geste pour «reconstituer le parcours d’un aïeul qu’il n’avait même pas connu» (2002: 114).
Un phénomène analogue gouverne la psychologie de Mathieu Arbour qui, confronté au fait que les visites de son père au Delaware ne sont en fait que des escapades adultères à Uashat, en vient à idéaliser son frère. Lamothe met en scène l’opposition antédiluvienne du nomade et du sédentaire entre Mathieu, un «homme rangé» qui fantasme secrètement son émancipation, et Luc, son frère «dérangé» vivant l'exil. Le décès de Luc, alors qu’il cherchait à atteindre le Delaware, devenu symbole artificiel de la Providence familiale déchue, dérègle Mathieu au point où il abandonne à son tour sa famille pour venger Luc et, par extension, défendre le fantasme familial qu’il s’est construit.
Dépourvus d’ascendance, abandonnés tant spirituellement qu’affectivement, les personnages de Lamothe ne cessent de se réfugier dans diverses chimères. L’écriture de Lamothe exploite donc le versant tragique de la perte de pouvoir du signifiant paternel en tant que moyen de réguler une identité familiale, sociale et religieuse stable, laissant l’individu aux prises avec une liberté existentielle aussi grisante qu’angoissante.
[1] Une construction aussi habile m’a permis de pardonner à Lamothe l’emploi de métaphores aussi mièvres que la bouche en fraise, la démarche vaporeuse et les yeux comparés à des lacs où se noyer pour décrire Nadia, la mère de Simon.