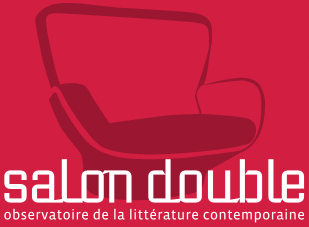Mettre le savoir en jeu
Alexandre Bourbaki est un auteur fictif que «représentaient» Nicolas Dickner, Sébastien Trahan et Bernard Wright-Laflamme dans Traité de balistique. Ce quiproquo sur l’identité de l’auteur me semble exemplaire d’une vision de la littérature en tant que jeu. Même en ces temps de critique dite structuraliste où l’adéquation entre le «vécu» de l’auteur et son œuvre n’attire plus l’attention, je crois que l’idée selon laquelle le «livre» émane de la conscience d’un auteur seul conserve tout son pouvoir. Le trio, avec ce «livre à six mains» revendiqué par un auteur fictif, se joue de cette dernière «vache sacrée». La littérature se prendrait-elle encore trop au sérieux?
Le contenu de ces 19 nouvelles – dont quatre sont des bandes-dessinées – renvoie lui aussi à une vision peu traditionnelle de la littérature où l’intérêt pour les objets supplante celui attribué aux personnages. Ainsi se croisent dans ce «Traité» ce que je nommerais un «imaginaire soviétique» («Laïka» aborde le célèbre chien cosmonaute, «Le Bavard de Svetlana» traite d’officiers russes qui transmettent des messages cryptés sur des partitions musicales, «Soyuz T» d’une capsule soviétique échouée à Sandy Beach, etc.), le destin d’un revolver d’argent («Le plus beau trou qui soit» raconte comment Richard, à Paradise Lost en Arizona en 1943, récupère une épée de Mohammad ibn Musa al-Khwarizmi, qui a imaginé le zéro, qu’il fait reforger en revolver, puis «Un cheval nommé Gravity», « Des lumières qui défilent sur un revolver d’argent » et «Le bal» suivent une bande d’intellectuels montréalais en manque de sensations fortes qui jouent à la roulette russe avec l’arme) et une sorte de fable familiale régionaliste québécoise («Les funérailles», «Le remblai» et «Le poids du monde» traitent d’Arthur qui fuit sa campagne pour éviter la conscription puis qui semble atteint «d’apesanteur», ce qui rendra son fils fou à force de lire des livres de physique). Ainsi, Bourbaki bombarde le lecteur d’informations scientifiques, littéraires, politiques ou historiques, au point où le savoir devient le thème principal du recueil. Il me semble que ce souci fou du détail, cette obsession encyclopédique, ce besoin maladif de recycler le savoir historique et scientifique (la Deuxième Guerre mondiale revient dans chaque nouvelle) pourrait non seulement révéler un éclectisme (voire une superficialité émotionnelle) typique du post-modernisme, mais aussi, comme le suggérait Jean-François Chassay à propos de l’écriture expérimentale de Georges Perec et de l’OULIPO dont Bourbaki s’inspire manifestement, une tentative de «cerner un monde qui nous échappe de plus en plus, qui perd son épaisseur, englué dans la propagande, là où le non-sens passe pour le sens» (Le jeu des coïncidences dans La vie mode d'emploi de Georges Perec, 1992 : 151).
.