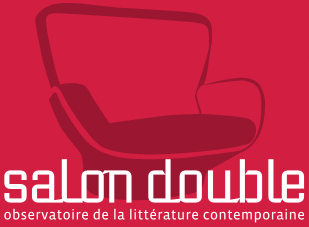Notre dystopie
Avec une langue aussi crue que celle du «Chum à Chabot» de Scotstown et Cranbourne, Fabien Cloutier poursuit sa satire sur l’ignorance et les préjugés qui nous animent.
Un matin de tempête de neige, une «technicienne aux communications de service et d’information avec l’usager de la Commission Scolaire des Trois-Monts» confronte un homme à la garderie après qu’elle l’ait vu s’empiffrer d’un beigne tandis que son fils Billy demeurait seul dans l’auto. Pendant ce temps, une «adjointe senior aux activités de formation du département des ressources humaines» s’indigne de l’incapacité du «préposé à l’installation et à l’entretien du matériel d’affichage», le père de Billy, à lui fixer un babillard. Billy [Les jours de hurlement] donne la parole à ce trio qui fulmine.
Au-delà de la litanie de préjugés que vocifèrent vulgairement les trois monologues intercalés se développe en toile de fond un univers bureaucratique entropique, système suradministré où la tyrannie de l’organigramme déresponsabilise l’individu devenu remplaçable et impuissant. Chaque personnage dont le titre professionnel rappelle la novlangue orwellienne dénonce avec une condescendance hypocrite les travers des «fourreurs du système», tout en profitant eux-mêmes de ses largesses. Leur voix rassemblées en écho trahissent la même détresse intérieure, cette inertie qui nous force parfois à projeter la responsabilité de nos malheurs sur les autres plutôt qu’à confronter nos soi-disant certitudes.
Certains pouvaient ostraciser le «Chum à Chabot» et ses jugements sexistes et xénophobes en raison de son désœuvrement, sa toxicomanie, ses vices. Avec Billy, pourtant, Cloutier nous montre que les idées reçues peuvent contaminer même les citoyens dits «respectables». Pire, alors que l’alcoolique beauceron, en s’ouvrant à la différence, parvenait à grandir, on sent les locuteurs de Billy enlisés dans leur aveuglement volontaire que flattent des médias de masse démagogues: «Y a-tu yinque à radio qu’y a du monde de parlab’?» (p.94)