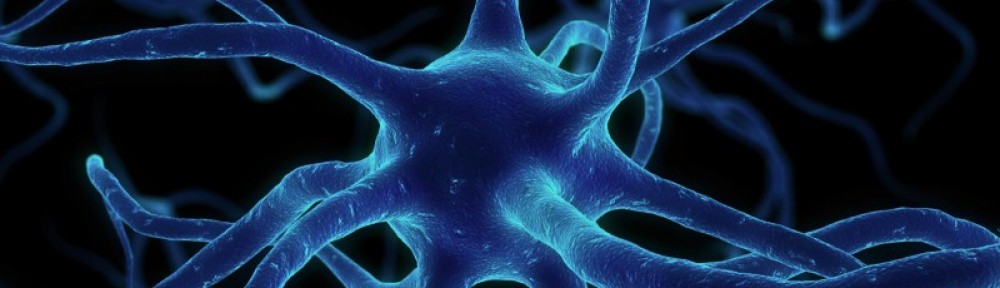Dès les années 1980, Sherry Turkle s’est penchée sur la question de l’identité au contact des nouvelles technologies. Dans son ouvrage fondateur, The Second Self, elle offre le résultat de six ans de recherche sur le terrain. Elle insiste sur la relation étroite que ses sujets entretiennent avec l’ordinateur, qu’ils soient néophytes ou chevronnés, que leurs contacts soient sporadiques ou constants. « The computer, dit-elle, is a new mirror, the first psychological machine. […] the relationships between people and machines that we have seen in the computer subcultures become harbingers of new tensions and the search for resolutions that will mark our culture as a whole […] » (1984, p. 306)
Plus de vingt ans plus tard, dans Simulation and its Discontents, on retrouve ces tensions entre humain et technologie. L’ouvrage offre une série d’études de cas qui dépeignent l’intégration de technologies numériques dans des programmes d’études en architecture, en ingénierie, en biochimie et en physique au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cette intégration ne va pas sans heurts. Par exemple, les professeurs de la faculté d’architecture s’inquiètent de la perfection trompeuse des dessins réalisés à l’aide des logiciels de design (Turkle, 2009, p. 16-17). Ils craignent la déshumanisation et la technicisation de la profession. Les chimistes et les physiciens, quant à eux, se questionnent sur l’opacité du fonctionnement des programmes qui génèrent des simulations. Ces simulations sophistiquées, selon eux, risquent de faire croire aux étudiants que la réalité se confond avec le virtuel : « the users of this apparatus did not understand its inner workings and indeed, vizualisation software was designed to give the impression that it offered a direct window onto nature. » (ibid., p. 29) Les ingénieurs eux-mêmes n’échappent pas à la méfiance généralisée envers l’informatique. Les professeurs observent que leurs étudiants se fient aveuglément à des programmes dont ils ne comprennent pas le fonctionnement, ce qui risque de fausser leur perception de la réalité (ibid., p. 39).
En somme, l’opacité de la technologie, soit l’effet « boîte noire », est un composant essentiel de cette méfiance. Le fait que l’usager ne saisisse pas les mécanismes qui composent l’application ou le logiciel crée une distance quasi infranchissable entre l’utilisateur et son travail, déshumanisant le processus et induisant un faux sentiment de confiance face à la fiabilité de la machine, ce qui peut avoir des conséquences très réelles.
Le travail de Turkle est pertinent pour quiconque s’intéresse à la culture numérique, puisqu’il met en lumière tout un éventail d’attitudes envers la technologie qu’il est possible de mettre en parallèle avec l’expérience des traducteurs.