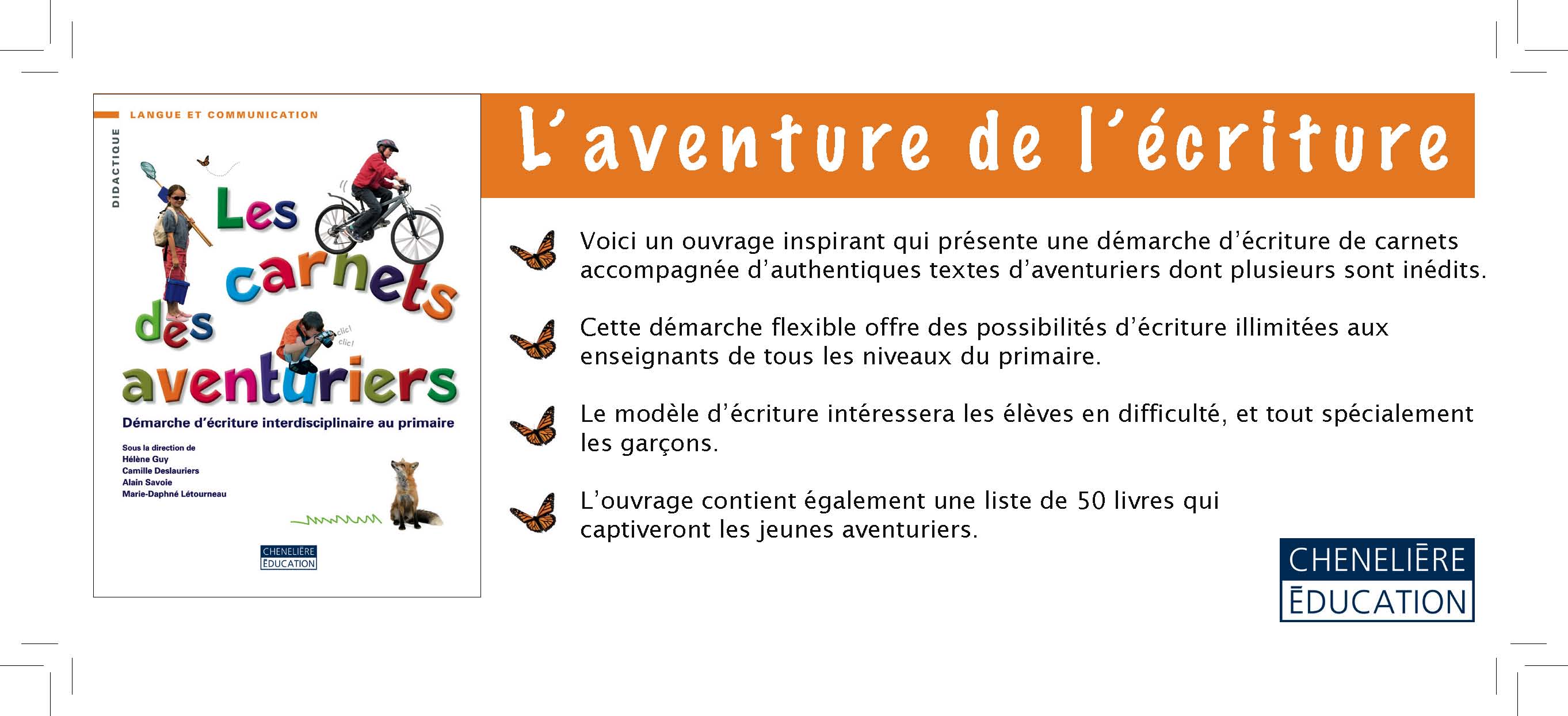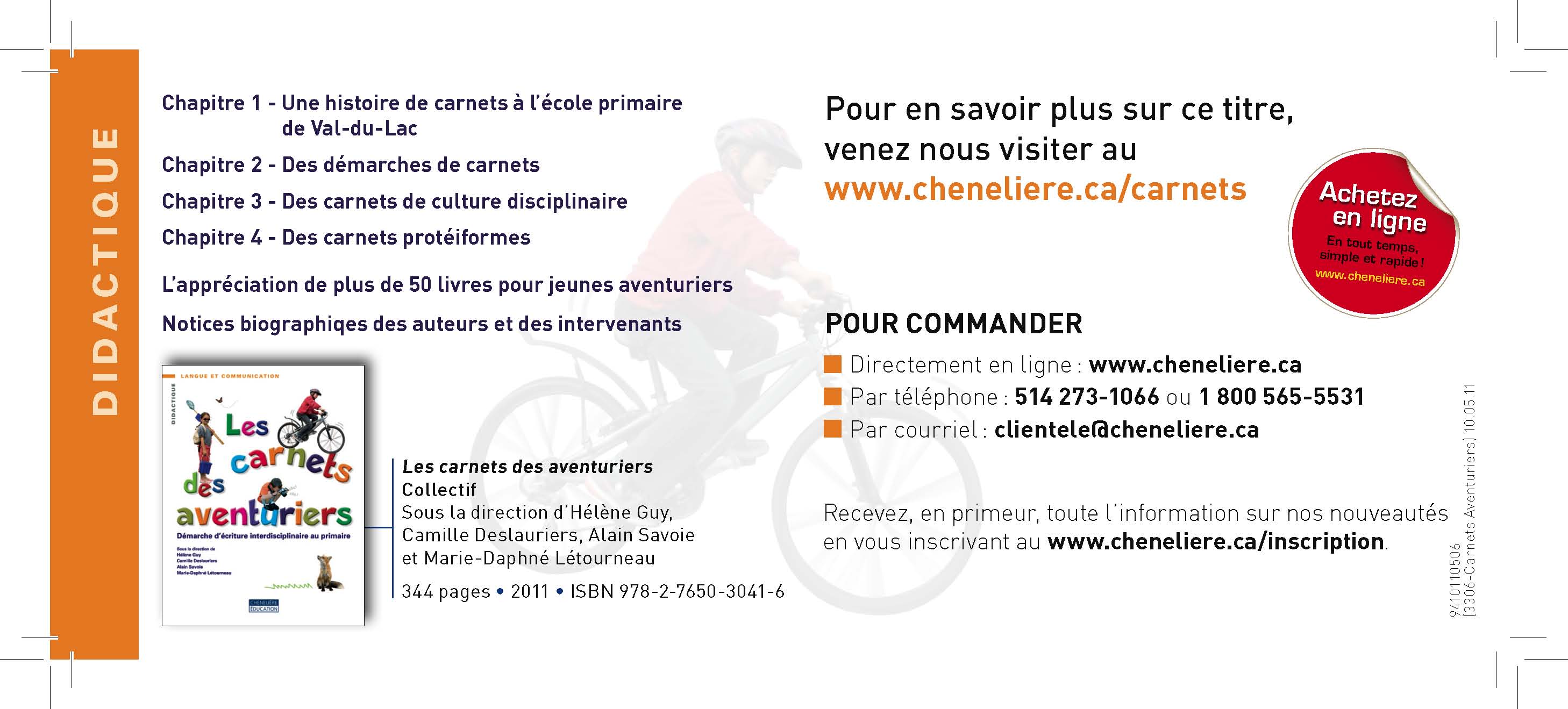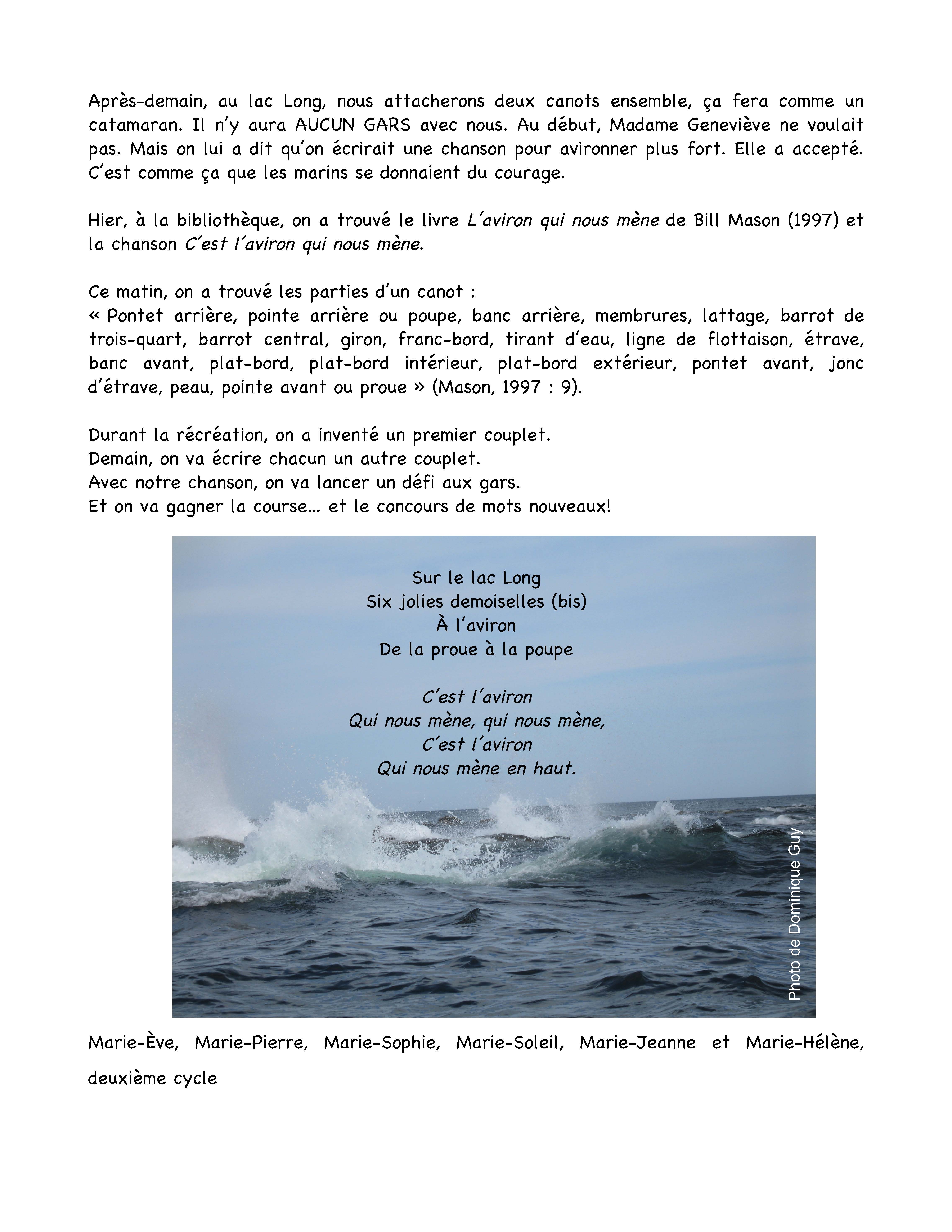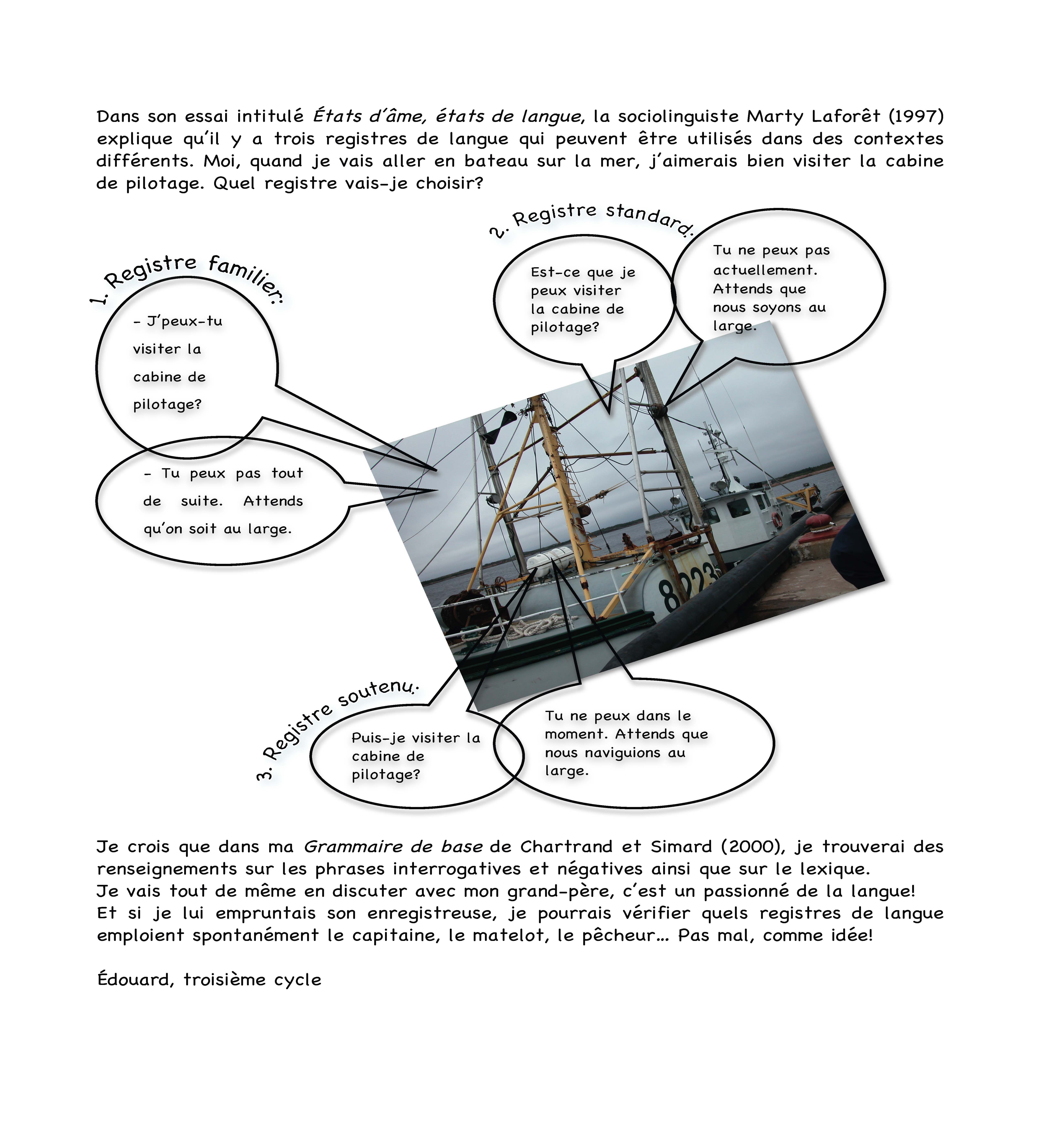Planification d’un texte
Comment apprendre à écrire? À aimer écrire?
Guy, H., Deslauriers, C., Savoie, A. et Létourneau, M.-D. (dir.) (2011). Les carnets des aventuriers. Démarche d’écriture interdisciplinaire au primaire. Montréal : Chenelière Éducation.
1. Situation d’écriture
Croisement du programme de français et de l’expérience des carnets…
Ou encore…
Croisement des genres littéraires transformés en genres scolaires!
En bleu, le programme; en noir, les carnets.
Gouvernement du Québec (2009). Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Progression des apprentissages. Document téléaccessible à l’adresse
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/
Français, langue d’enseignement
Compétence Écrire des textes variés
Section Organisation et cohérence du texte
À la fin du primaire, l’élève rédigera des textes cohérents, découpés adéquatement et dont les idées auront été développées en tenant compte des éléments liés à la situation de communication et des caractéristiques propres au genre de texte choisi.
Pour eux — je le devinais bien —, l’écriture assidue d’un carnet demeure une lutte discrète, c’est comme un accès difficile à la patience, mais la plupart y sont arrivés. La fierté ne s’impose pas, elle surgit. Émotion simple, cette satisfaction par rapport à soimême est un sentiment nouveau que les jeunes ont certainement éprouvé. (…)
M’engageant d’abord dans la lecture de leurs réalisations écrites et photographiques, j’ai pu ressentir ce sentiment de victoire qui les habitait ; sentiment lié au fait que les enfants se sont dépassés grâce à cette capacité qu’ils ont eu de s’éloigner de leurs limites ; limites dont il n’était plus question d’ailleurs, grâce à la mise en valeur du potentiel créatif de chaque enfant. Ce constat de réussite portait une dimension émotionnelle à laquelle je fus incapable de rester insensible. (Roy, p. 20)
L’élève aura atteint cet objectif par :
- l’exploration de différents genres de textes pour en dégager des éléments caractéristiques dont elle ou il pourra tenir compte dans ses propres textes;
- le développement de sa capacité à choisir des idées pertinentes et à les regrouper dans des paragraphes;
- le développement de sa capacité à établir des liens entre ses idées.
Certains élèves, invités à se dépasser, sont allés plus spontanément chercher le dictionnaire parce qu’ils voulaient montrer à l’adulte qu’ils étaient capables de vérifier l’orthographe d’un mot. Mais la plupart des carnets, dans ce projet, se sont écrits en orthographe approchée. L’esprit était celui d’un premier jet, où l’enfant va jusqu’au bout du projet avant d’entamer la réécriture.
D’un côté, les enseignantes saluent ce moyen moins conventionnel et très créatif de faire écrire les élèves, elles ont apprécié cette nouvelle formule et elles souhaitent continuer à explorer de telles avenues. (…) Si les enseignantes avaient guidé le projet, elles auraient sans doute eu des préoccupations normatives et des exigences à la hauteur de ce que peuvent produire les élèves de chacun des cycles, en respectant leurs forces et leurs défis personnels liés aux difficultés d’apprentissage. La réécriture, par exemple, aurait pu se faire par collage : les enfants auraient été invités à corriger leurs fautes sur de petits cartons de couleur qui auraient ensuite été collés en superposition dans le carnet, respectant ainsi le petit côté collimage de cette nouvelle démarche d’écriture. De même, faire un plan dans toutes les classes, à partir des piles de photographies, aurait pu amener les élèves à étoffer plus longuement l’histoire racontée. Ou encore, les enseignantes auraient proposé aux élèves d’écrire d’abord leurs phrases au tableau, avant de les transcrire dans le carnet et de corriger en grand groupe et en coopération l’orthographe et les accords grammaticaux. (Deslauriers, p. 34-35)
Des activités proposées en classe permettront à l’élève d’observer la structure de textes courants ou littéraires avant d’en écrire. Elle ou il pourra voir comment ces textes de différents genres sont construits.
Une fois le projet terminé, les enseignants, les étudiants et quatre « grands gars » qui sont allés écrire à quatre mains avec les élèves ont pu affirmer qu’ils avaient vécu une véritable aventure pédagogique, car l’équipe leur avait donné très peu de consignes au départ. Nous ne leur avions pas décrit, préalablement, ce qu’était un carnet ni comment faire un carnet : nous avons résisté à la tentation de donner des contraintes d’écriture précises, pour favoriser la créativité de tout un chacun et voir ce qui se passerait à l’état naturel. (p. 32)
Les pratiques d’écriture donneront l’occasion à l’élève d’utiliser ses connaissances pour mieux structurer son texte en fonction d’une situation de communication.
Aujourd’hui, Nicole, Isabelle, Johanne et Natashka ont ressorti les carnets des aventuriers. Chacune invite les élèves de sa classe à refaire deux ou trois pages en solo. Elles leur expliquent qu’ils ont vraiment un destinataire : une fois qu’ils auront terminé la séance d’écriture, les carnets seront envoyés aux grands gars qui leur répondront… par une page de carnet !
Les petits n’en reviennent pas. Il faut être minutieux et faire de son mieux: il y a vraiment quelqu’un qui lira leurs carnets ! (Deslauriers, p. 17)
Les réflexions individuelles et collectives sur ces pratiques contribueront à mieux l’outiller pour résoudre des problèmes d’écriture. (Gouvernement du Québec, p. 56)
Catherine s’exclame : « Regarde si c’est beau. On a fait des rimes ! On continue. » Et Xavier tourne la page, enthousiaste. « Qu’est-ce que tu pourrais écrire pour dire que tu as eu du plaisir ? » demande Catherine. Xavier réfléchit très fort et répond : « Je me suis amusé. » « Oui, bravo. Ce mot finit encore par un “e” avec un accent spécial. » Feutre jaune, feutre vert, feutre rouge : les crayons passent de main en main et, tour à tour, chacun transcrit sa portion de phrase. Pendant une heure, l’enfant et l’adulte s’inspirent d’une vingtaine de photographies qui les amènent à revivre l’aventure, à se la raconter mutuellement, et surtout, à l’écrire ensemble. Ils l’écrivent à quatre mains. (Deslauriers, p. 2)
2. Oeuvres documentaires
Comment peut-on lire des textes variés sans apprendre?
STEPHENS, Rebecca (2001). Les montagnes du monde, Paris, Gallimard, coll. « Les yeux de la découverte »,
62 p.
Les montagnes du monde, grand livre documentaire (286 x 223 mm) paru en 2001 chez Gallimard, nous présente, tout en couleurs, plusieurs facettes de la montagne et de l’alpinisme. On y retrouve de nombreuses photos et images nous exposant entre autres la formation des montagnes, la faune et la flore qu’elles recèlent, les peuples qui y vivent et les explorateurs qui en ont tenté l’ascension.
Dans ce livre, les images sont nombreuses et d’une très grande qualité. On peut y admirer des photos de paysages à couper le souffle, des images de vestiges légués par des peuples montagnards et des photos d’époque nous montrant les premiers hommes à avoir conquis les plus hauts sommets du monde. D’ailleurs, une magnifique photo des ruines du Machu Picchu au Pérou nous est présentée, expliquée et située de façon à décrire la vie des Mayas et l’architecture de l’ancienne forteresse. Les courts paragraphes qui ponctuent cet ouvrage nous offrent des éléments d’information variés et très intéressants dans un vocabulaire simple.
Les montagnes du monde est un incontournable pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les nombreuses montagnes qui dominent notre planète. Simple et facile à lire, ce document offrant une multitude de données est un outil incomparable pour des élèves qui voudraient se préparer pour une ascension ou pour une simple randonnée en montagne. Il permettra aux enfants moins aventureux de voyager en visitant ces sommets impressionnants, en découvrant les peuples qui y vivaient ou qui y vivent encore, et les hommes qui les ont explorés.
Jessica Langlois (p. 305)
(Guy, p. 179)
3. Ouvrages normatifs
Un lexique, un dictionnaire, une grammaire… le désir de s’y aventurer!
(Guy, p. 175)
Contant, C. (2009). Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée : cinq millepattes sur un nénufar. Montréal : De Champlain S.F.
De Villers, M.-É. (2009). Multidictionnaire de la langue française. Montréal : Québec Amérique.
Simard, C. et Chartrand, S.-G. (2011). Grammaire de base : 2e et 3e cycle du primaire. Montréal : ERPI.