Culture numérique, culture virale, culture accélérée, autant de termes qui cherchent à décrire, sans toutefois résumer ou englober, le contemporain du village global connecté et occidental. Pour un essayiste, aborder ces questions mène rapidement au renoncement d’en atteindre les limites. De manière inusitée et fascinante, un journaliste professionnel, Bill Wasik, a opté pour une autre approche afin de se pencher sur certains phénomènes des nouveaux médias, soit l’expérience sur le terrain – ou plutôt, sur l’écran.
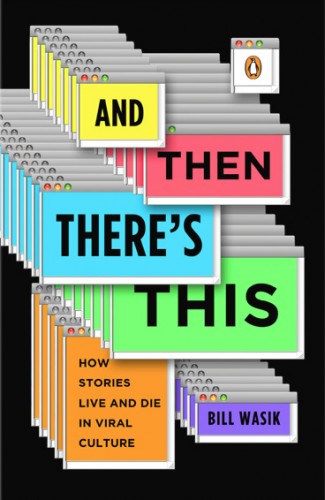
Dans And Then There’s This. How Stories Live and Die in Viral Culture, Wasik, journaliste et notamment éditeur au prestigieux magazine Harper’s, commence en s’interrogeant sur la succession de plus en plus accélérée de microrécits relayés par les médias. Dans son introduction, il souhaite mettre en place le concept de « nanostories » (p. 5) afin de décrire les bribes d’informations qui sont consommées frénétiquement par les internautes. C’est sans doute l’aspect le plus faible de son essai, puisqu’il décrit de manière trop succincte son idée sur la question (et tout porte à croire que certaines théories du récit préexistantes auraient pu faire l’affaire) en plus de mal articuler son concept au cours des chapitres qui vont suivre, alors même que le titre de son essai semblait promettre que le manque d’attention et la consommation compulsive de récits allait être le sujet principal de son projet livresque.
En revanche, ses réflexions sur la « culture virale » annoncée en sous-titre sont plus intéressantes. Toujours dans l’introduction, Wasik cite quatre facteurs qui expliqueraient l’émergence de phénomènes viraux sur le Web :
But what this particular decade, the first of the twenty-first century, has built, I would argue, is a new viral culture based on a new type of sudden success—a success with four key attributes. The first is outright speed: viral culture confers success with incredible rapidity, in a few weeks at the outside. The second is shamelessness: it is a success defined entirely by attention, and whether that attention is positive or negative matters hardly one bit. The third is duration: it is a success generally assumed to be ephemeral even by those caught up in it. These first three attributes, it should be noted, are simply more extreme versions of the overnight success afforded by television.
The fourth attribute, however, is new and somewhat surprising. It is what one might call sophistication: where TV success was a passive thing, success in viral culture is interactive, born of mass participation, defined by an awareness of the conditions of its creation. Viral culture is built, that is, upon what one might call the media mind. p. 8
Wasik a raison de mentionner que les trois premiers attributs, les plus prévisibles en quelque sorte, ne sont que les héritiers de la culture télévisuelle. Mais son insistance sur la sophistication des sujets contemporains face aux médias, leur capacité à faire preuve de discernement et de sélection active du contenu à consommer et diffuser par le biais du Web (par rapport à une sélection plus passive parmi les médias traditionnels), est une observation assez porteuse, et le reste de son essai se penche sur cette « pensée des médias » qui serait plus raffinée à l’époque contemporaine.
En effet, les chapitres suivants détaillent des « expériences » empiriques menées par Wasik afin de déterminer s’il est capable de manufacturer des engouements suffisants pour mettre en place des phénomènes viraux à partir d’une série de critères qu’il énonce en toutes lettres. Sa première expérience, relatée au premier chapitre, « My Crowd », a pris la forme de ces curieux « Flash Mobs » survenus en 2003 à New York et qui ont brièvement défrayé la manchette. Avouant qu’il était à l’époque motivé par une lutte contre l’ennui, il a été l’instigateur de certains de ces rassemblements spontanés par chaînes de courriel. On apprend également au troisième chapitre, « I Have A Meme », qu’il a remporté en 2006 une édition du concours « Contagious Festival » du Huffington Post, où, à chaque mois, un site Web était créé dans le but précis de devenir le plus consulté. Wasik a obtenu la cagnotte de 2500$ en créant le « Right Wing New York Times » et il explique dans son essai qu’il est parvenu à trouver un équilibre juste entre critique de la gauche, parodie de la droite et attitude subversive qui a plu à tous les visiteurs, peu importe leur allégeance politique.

Certaines de ses expériences ont également lamentablement échoué. Il a mis en place oppodepot.com, site de salissage politique qui n’a été que très peu consulté alors que de nouvelles stratégies virales émergeaient au même moment – soit pendant la campagne présidentielle ayant mené à la première élection de Barack Obama. Il avoue également, dans son deuxième chapitre – consacré à l’attention de plus en plus éphémère portée aux « nouveaux artistes », particulièrement aux musiciens – que sa tentative de freiner la montée en popularité du groupe Peter, Bjorn and John en infiltrant les blogues musicaux s’est soldée par un risible échec.
Considérer cet essai dans une perspective académique fait mal paraître le travail de Wasik. Les concepts qu’il cherche à mettre en place dès l’introduction sont pour le moins poreux, flous et mal employés par la suite. Il n’appuie que rarement sa réflexion sur des articles et écrits de penseurs contemporains – bien qu’il n’hésite pas à consulter des études menées dans des champs scientifiques variés, ce qui est tout à son honneur. Toutefois, ce serait faire preuve de malhonnêteté intellectuelle que de vouloir lire And Then There’s This dans cette perspective. Parce que Wasik a plutôt fait une sorte de reportage sur le terrain virtuel du Web, du Gonzo 2.0, appuyé par des hypothèses élaborées et qui visent souvent juste. Davantage un témoignage d’époque qu’un reportage, le livre de Bill Wasik est une porte d’entrée fascinante dans la culture virale.
Wasik, Bill. And Then There’s This. How Stories Live and Die in Viral Culture. New York : Viking Press, 2009
