À chaque année, la rentrée montréalaise accueille le World Press Photo (WPP), une exposition internationale de photojournalisme, combinée cet automne à la biennale de photographie actuelle, Le Mois de la Photo à Montréal. Cette convergence d’expositions de photographie nous a permis de réfléchir au statut de l’image dans la pratique journalistique et artistique en vue des nouvelles technologies de l’information. Ce billet présente, dans cette optique, cinq artistes qui s’approprient des images produites originalement par Google Street View (GSV): Michael Wolf, Mishka Henner, Jon Rafman, Aaron Hubson et Doug Rickard.
La majorité des débats entourant la légitimité de ce type de pratique artistique ont sévi sur la toile entre les années 2010 et 2012. Il semble en effet que le comité d’évaluation du WPP 2011 ait déclenché une controverse lorsqu’il a décerné sa mention honorable au photographe Michael Wolf pour sa série A Series of Unfortunate Events (2011). La série rassemble des images captées par le drone à neuf yeux (à noter qu’il en possède désormais 12) de la corporation Google. L’empire californien a initié cette entreprise de cartographie sans précédent en 2007 avec un véhicule de type crossover, équipé d’appareils photo, de capteurs laser ainsi que d’un GPS, qui sillonne et parcourt toutes les rues du monde, ou presque. GSV participe ainsi à la volonté de la société Google «d’organiser les informations à l'échelle mondiale et de les rendre accessibles et utiles à tous» [1]. Wolf, tout comme ses homologues, interroge la raison d’être de cette banque de données et les prétentions de l’entreprise mondiale à représenter la «réalité». Loin d’exclure ce matériel visuel, les artistes de la mouvance Google reconnaissent la valeur de ces représentations «documentaires» et explorent le potentiel artistique de ces images dotées d’une esthétique amateur.
D’abord, Michael Wolf recadre ou rogne les images originales dégottées sur GSV. La série Street View, à laquelle appartient A Serie of Unfortunate Events, inventorie des images sous des thèmes variés, tels que «Fuck You», «Manhattan», «Eiffel Tour», etc. Le photographe Michael Wolf s’intéresse parfois à l’impromptu et aux apparitions loufoques, mais une attention particulière est portée à l’esthétique spécifique des images produites par l’appareil automatisé de Google. Certaines de ses séries sondent l’image fragmentée par le pixel et par les zones de floutage des visages, tandis que sa série Interface fait voir des captures d’écran dominées par les curseurs, les flèches, les capteurs de position, etc.
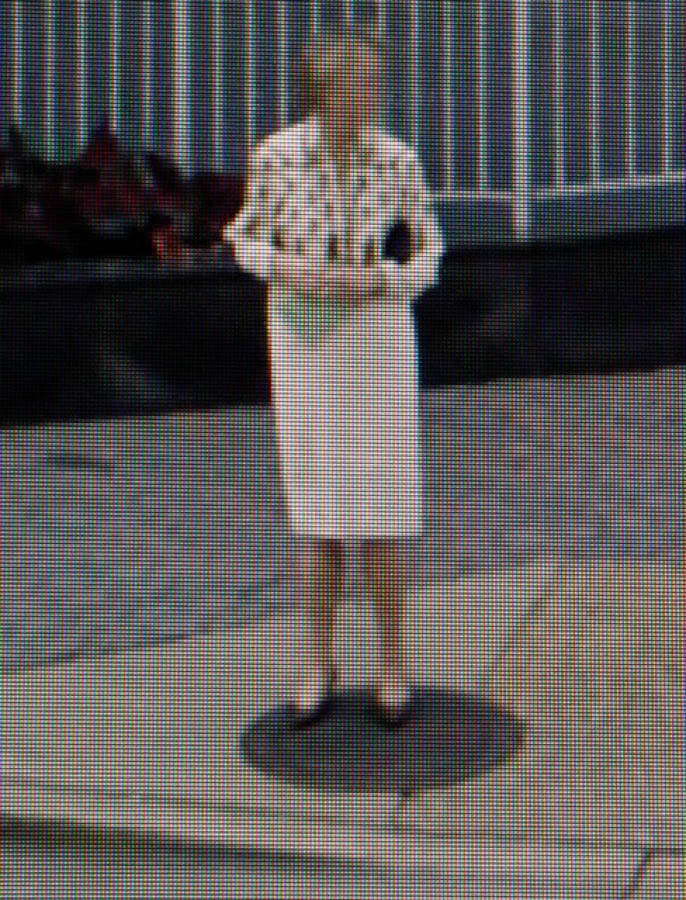
34, A Series of Unfortunate Events, 2011
Jon Rafman adopte une approche sensiblement différente. Sa série The Nine-Eyes of Google Street View, entamée en 2009, est une collection d’images tirées de ce répertoire visuel du monde. Rafman ne modifie pas les photographies et les rediffuse telles quelles, avec la rose des vents, l’annotation «copyright» de Google et, parfois, les flèches jonchant les rues. Dans un essai qu’il publie sur le site new-yorkais Art F City en août 2009, au début de son périple dans l’univers Google, Rafman note son intérêt pour l’urgence et la spontanéité qui caractérise les photographies de GSV et qui leur confère une prétendue neutralité [2]. L’artiste enjoint le regardeur à interroger le projet, son étendue et sa finalité. Il se pose ainsi en tant qu’explorateur de la conscience collective contemporaine telle qu’elle est représentée par cette technologie.

(sans titre)
Mishka Henner a conçu, de son côté, No Man’s Land (2011). Cette série rassemble des photographies de prostituées qui se positionnent sur les bords des routes en périphérie des grands centres urbains d’Espagne et d’Italie. Ces femmes africaines (majoritairement du Niger) sont captées par le drone de GSV et se dégagent de ces espaces de transition et de circulation, en suspens, dans l’attente. La série fut l’objet d’une vive polémique alimentée, entre autres, par les blogueurs Peter Brook et Joerg Coldberg. Plusieurs détracteurs ont dénoncé le traitement «inhumain» et froid d’un sujet qui devrait pourtant soulever les sympathies des regardeurs. Henner se défend de créer une œuvre amorale et affirme que GSV élargit le langage étroit du format documentaire en reproduisant l’expérience mercantile et réductrice du client potentiel [3].

Strada Santa Caterina, Bari, Italy
Doug Rickard s’inscrit dans une démarche similaire et entreprend d’explorer en images les revers du rêve américain. A New American Picture (2010-2011) recense des photographies des villes de Détroit, de Dallas, de Chicago, du Bronx, de Houston, etc., et en expose la réalité blafarde et l’esthétique post-industrielle. Le photographe affirme dans le quotidien The New Yorker, en novembre 2012, que la distance entre les sujets de la photographie et le regardeur, distance provoquée par la nature «lo-fi» (low-fidelity) des images et le floutage des visages, refuse au lecteur l’identification et la sympathie traditionnellement suscitées par la photographie documentaire, faisant écho aux propos d’Henner [4].

#41.779976, Chicago, IL (2007), 2010
Enfin, Aaron Hobson crée la série cimenamascapes: Google Street View (2011-2012). L'artiste y collectionne des images de paysages magnifiques provenant de lieux reclus de la planète. Au lieu de s’attarder à des réalités urbaines ou sociales, Hobson privilégie le registre du rêve, de l’inaccessible, de l’exotique ou du fantastique. La série cinemascape fait ainsi écho à la notion romantique de l’explorateur; les scènes sublimes que nous présente Hobson nous donnent un accès privilégié à ses voyages, à ses découvertes et à la grandeur presque surréaliste du monde tel qu'il est saisi par le véhicule ominiscient de GSV.

La Linea de la Concepcion, Spain
Ces pratiques appropriationnistes – datant de la révolution dada – atteignent un point culminant avec l’abondance des flux d’informations sur le Web. Le sujet, qu'il soit artiste ou regardeur, impose sa lecture subjective sur des photographies conçues initialement par la machine. Que cette appropriation et cette réécriture de l’image découlent d’un intérêt purement esthétique pour la photographie numérique ou qu’elles s’inscrivent plutôt ou simultanément dans une réflexion sur la nature de ce projet d’«archivage du réel», GSV n’a pas terminé de susciter de l’intérêt, de l'inquiétude ou de la fascination. Entre temps, il y a toujours cette vidéo en image par image de Tom Jenkins, intitulée Adress is Approximate, qui raconte l’histoire d’un jouet solitaire qui s’évade de sa pièce sombre grâce aux panoramas GSV répertoriés sur le Web. La vidéo est accompagnée d'une trame sonore du groupe Cinematic Orchestra, avec la pièce «Arrival of the Birds».
Address Is Approximate from The Theory on Vimeo.
[1] Google. En ligne: http://www.google.com/about/company/ (consulté le 30 septembre 2013)
[2] Jon Rafman (12/08/2009) «IMG MGMT: The Nine Eyes of Google Street View», ART F City. En ligne: http://artfcity.com/2009/08/12/img-mgmt-the-nine-eyes-of-google-street-view/ (consulté le 2 octobre 2013)
[3] Peter Brook et Mishka Henner (23/04/2012) «A Conversation with Mishka Henner», Prison Photography. En ligne: http://prisonphotography.org/2012/04/23/a-conversation-with-mishka-henner/ (consulté le 25 septembre 2013)
[4] Rachel Klapheke (09/11/2012) «Doug Rickard’s Street View», The New Yorker. En ligne: http://www.newyorker.com/online/blogs/photobooth/2012/11/doug-rickards-street-view.html#slide_ss_0=1 (consulté le 2 octobre 2013)
