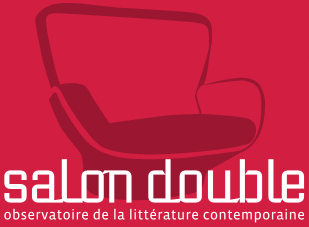Répondre au commentaire
Intersections et collisions
La lecture des onze nouvelles du très beau recueil de Mélissa Verreault, Point d'équilibre, ne m'a pas permis de résoudre une ambiguité que j'ai relevée avant même de me rendre à la première page : doit-on comprendre le titre comme la recherche d'un point milieu, symbole de stabilité, ou doit-on plutôt le comprendre comme une mise en garde pessimiste, un constat de désillusion nous assurant que l'atteinte de l'équilibre est impossible?
Difficile de trancher. Qu'elles nous présentent un personnage au seuil de la vie adulte (Casse-gueules, merchurochrome et autres déchirures), de la trentaine (Les ballons de fête), de l'arrivée dans un nouveau pays (Over), de la paternité (Étoiles de papier) ou de la mort (La femme en bleu), les nouvelles, mettant habilement en place un microcosme en moins de vingt pages, abordent des projets de résolutions de conflits internes et externes, qui achoppent pour la plupart. Des facteurs externes viennent parfois brouiller les cartes, mais il est souvent permis de penser que le projet de réussite échoue parce que les personnages ont mal joué leur main. La dernière nouvelle du recueil, loin d'être lumineuse, parvient toutefois à redonner espoir. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié comment l'écrivaine parvient, par des détails subtils, à créer un enchaînement entre les nouvelles par une récurrence d'un élément de la nouvelle précédente dans la suivante, un jeu d'intersections ajoutant une congruence à l'ensemble.
Verreaut a une écriture précise, qui force l'admiration sans jamais brusquer le lecteur, facilitant l'incursion dans l'univers privé des personnages. Elle traite en moins de 200 pages de plusieurs sujets et thèmes avec une maîtrise enviable, et son recueil dépeint de la sorte un portrait de société assez vaste et complet. La principale, voire unique, anicroche commise par l'écrivaine vient de son emploi de temps à autre malhabile des niveaux de langage croisés, parfois au sein d'un même paragraphe. Les dialogues sonnent juste mais les passages en focalisation interne contiennent à l'occasion des incongruences qui font sourciller. Par exemple : « Jouer au Père Noël : c'est la partie de son job que Luc préfère. Autrement, il a souvent l'impression qu'entre lui et un gérant de Wal-Mart, il n'y a pas grand' différence » (p. 88, mes italiques). Job est bel et bien un nom masculin, mais les Québécois auront tendance à l'accorder au féminin, et ce sont surtout les Français qui l'accordent correctement. Le texte est donc grammaticalement exact, mais la phrase suivante contient une abbréviation typiquement québécoise de l'expression « il n'y a pas une grande différence » et le passage d'un registre de langue à l'autre en l'espace de deux phrases accentue la portée de cette disparité. Ce point d'équilibre langagier n'a pas été atteint à quelques reprises au long du recueil, mais quand on prend la peine de mentionner cette broutille, c'est en partie parce qu'on aime chipoter sur les détails, et en partie parce que par ailleurs, le reste est pratiquement irréprochable.