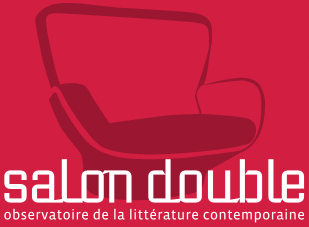Répondre au commentaire
Chassez la famille...
Le premier roman de Catherine Leroux, La marche en forêt (2011), esquisse le portrait de quelque 30 membres de la lignée des « Brûlé » en empruntant le style fragmenté de la courtepointe qui ne va pas sans rappeler Les ponts (1995) de Jean-François Chassay, Fugueuses (2005) de Suzanne Jacob ou, évidemment, Nikolski (2005) de Nicolas Dickner. Les va-et-vient entre les membres de la famille, les époques et les générations, dans ces livres, tendent à estomper la linéarité au profit de regroupements isotopiques ou thématiques.
Ici, Leroux semble proposer l’exploration de diverses dégénérescences et maladies, physiques ou mentales; mais aussi de la défaillance de la famille nucléaire traditionnelle –pour ne pas dire patriarcale− au profit de nouveaux modèles de vivre-ensemble atypiques. Ainsi, Fernand, un des patriarches, s’attire les foudres de ses quatre enfants lorsqu’à 72 ans il se remarie avec une femme 20 ans sa cadette, Emma. Or, quand Fernand se révèle atteint de la maladie d’Alzheimer, l’idylle devient une épreuve pour la famille; épreuve qui se répétera quelques années plus tard quand Emma sera handicapée par un AVC. Sa fille, Justine, qui se remet d’une rupture amoureuse en prenant soin d’un autiste avec qui elle aura une aventure, emménage avec sa mère pour en prendre soin et pour donner naissance à l’enfant qui naît de son union inusitée. Parallèlement, Leroux relate le divorce d’un des fils de Fernand, Normand, lorsque le couple subit la condamnation pour viols de leur fils Hubert, diagnostiqué comme accroc des jeux virtuels. À ces deux histoires fédératrices se greffent plusieurs trajectoires individuelles, liées généralement à des expériences plurielles de l’amour et de la famille : le mariage gai de Pascal Brûlé, l’adoption d’un enfant par Nicole qui s’est réfugiée dans le new age à la mort de sa mère, l’inceste entre les cousins Ève et Marc qui a rendu celle-ci toxicomane, les infidélités de Tristan aux dépens de sa conjointe dévastée Caroline, les amours adolescentes d’Anthony qui reflètent celles de sa mère qui l’a eu à 18 ans et Luc, vieux garçon, qui redécouvre le sentiment amoureux à 64 ans avant de périr d’un cancer du pancréas le même jour que son frère Jacques, self-made man propriétaire d’un garage, trépasse d’une crise cardiaque.
Outre ces regroupements thématiques évidents, il semble que les métaphores du corps et de la forêt qu’a identifiées David Hébert sur son blogue permettent de proposer une interprétation d’ensemble de cette fresque. Comme l’indique sa lecture, la forêt correspond à une habile métaphore de la famille (ne parle-t-on pas de l’arbre généalogique?): «Une unité lorsque regardée avec un retrait, de l’extérieur seulement. Mais à l’intérieur, dans sa densité, chacun des membres y fait son propre chemin. […] Ce qui reste commun, c’est le sol, la base sur laquelle ces chemins se forment, la terre, les origines.» Et les racines, ajouterais-je. Ces chemins chaotiques, rhizomiques, de la forêt correspondraient aux méandres des veines dans le corps, aux dédales qu’empruntent les synapses de l’esprit, aussi vulnérables qu’imprévisibles.
Dans cette allégorie des métamorphoses de la notion de famille à l’époque contemporaine, l’aïeule de la famille, Alma Brûlé, sorte de versant féminin admirable du mythe du coureur des bois qui délaisse ses sept enfants à la ferme pour renouer avec le nomadisme de ses origines indiennes afin de dériver sur le continent, prenant part à la construction de chemins de fers et à la Guerre de Sécession, permet également de lier la métaphore de la forêt-famille à l’idée de nation. On peut certes voir dans le refus de celle-ci de se cantonner dans son rôle de femme au foyer un atavisme ayant mené à la prolifération de nouveaux modèles familiaux au sein de sa descendance. Son errance continentale, quant à elle, traduit le désir d’émancipation qui hante l’imaginaire québécois. Si je dois exprimer une réserve à l’endroit du roman, c’est précisément de ne pas avoir exploité suffisamment l’impact atavique d’Alma sur les identités collectives et nationales des personnages qui ne réfléchissent pas à leurs appartenances sociales.