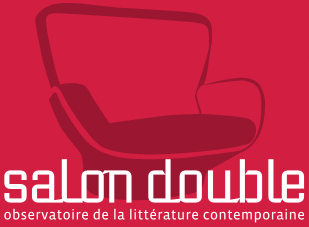Répondre au commentaire
Des contes barbares
Les monologues Scotstown et Cranbourne de Fabien Cloutier donnent la parole au «Chum à Chabot», résident de la Beauce rustre et vulgaire. L’hurluberlu relate des péripéties de son quotidien et décrit le monde à travers le filtre de ses préjugés et de son ignorance. Alors que le premier volet de la série, Scotstown, met en scène en quelque sorte le «fond du baril» qu’atteint «L’CHUM» à la suite de virées éthyliques et d’intoxications compulsives, Cranbourne raconte son difficile processus de mûrissement où il se trouve un travail, se distancie de ses amis odieux et s’apprête à se marier.
Je retiens de ces monologues crus l’habile récupération du genre du conte traditionnel qu’opère Cloutier. L’éditeur présente d’ailleurs Scotstown comme le «chaînon manquant entre le conte urbain et la conterie rurale». À l’image du Jos Violon de Louis Fréchette ou du plébiscité Fred Pellerin, on y retrouve ce travail extrêmement assidu de la langue parlée et de l’oralité. D'ailleurs, Cloutier truffe la parole de cet homme soi-disant vulgaire et ignare d’habiles métaphores et jeux de langage. Par exemple, observant la figure crispée d’un pouceux qu’il a fait monter dans sa voiture, L’CHUM mentionne : «J’morvire vers lui/ Y a comme la face de même/ Toute rentrée par en dedans/ Comme si y venait d’pard’ trente livres/ Comme si quequ’un/ Y avait branché une balayeuse Shop Vac dans l’cul» (Scotstown: 73).
Les contes de Cloutier s’approprient non seulement la langue et l’oralité rituelle des contes canadiens, mais aussi tout le patrimoine imaginaire de leur l’univers. Ainsi, à l’exemple de «La Chasse-galerie» d’Honoré Beaugrand, les irruptions du fantastique dans le récit peuvent à la fois s’expliquer par le surnaturel ou tout simplement par l’ivresse avancée des protagonistes qui leur aurait donné des visions. On y trouve aussi les symboles catholiques d’usage tels que le diable et les bonnes sœurs, mais aussi l’Oratoire Saint-Joseph. Cette parole, toujours sur le bord de l’hallucination, puise donc à même les ressorts traditionnels du conte, tout en restant pleinement consciente d’elle-même : «J’pourrais-tu avoir une vie normale? /Le surnaturel/ J’commence à l’avoir assez profond dans l’cul» (Scotstown: 80) dit-il à Lucifer en personne. Derrière cette apostrophe se cache une sorte d’ironie qui indique justement que le conteur joue avec des codes traditionnels qu’il reconfigure.
Enfin, les contes de Cloutier se démarquent par leur fort enracinement dans la région beauceronne, phénomène qui a certainement poussé Samuel Archibald à rattacher Cloutier au courant du «néo-terroir» (Archibald, 2012: 18). Par contre, contrairement aux sympathiques saguenéens que présente l’auteur d’Arvida, la Beauce de Fabien Cloutier sent le purin et semble peuplée de grossiers personnages imbus d’alcool et de fornication sans aucun regard pour la morale. Cette scène jouissive de Cranbourne où L’CHUM se trouve à Saint-Magloire pour le festival de «La vache qui chie» où des centaines de rustres parient sur l’endroit où déféquera ce pauvre animal en constitue l’exemple le plus frappant. Cloutier présente en quelque sorte une caricature (pleinement assumée) des stéréotypes négatifs rattachés aux régions, à savoir un repli sur soi qui génère une peur de l’Autre et une sorte de complaisance dans l’ignorance.
Or, le portrait rural n’est pas entièrement noir, puisque le diptyque de Cloutier raconte justement la libération du CHUM. Au fil de ses virées à Montréal et à Québec, il rencontre des individus d’horizons divers au point où Scotstown se clôt par une sorte de tombola multiethnique dans son village où se réunissent Mohamed le barman rencontré dans le quartier gay, une famille de Russes et une autre d’Africains, comme si le conteur voulait figurer par synecdoque la diversification culturelle de la société québécoise contemporaine par rapport à la référence traditionnelle. C’est dans ce vœu de conjuguer de manière assumée et ludique le folklore québécois avec la réalité contemporaine (caractérisée non seulement par la diversité, mais aussi par l’omniprésence de la culture de masse américaine, comme en témoignent les dizaines d’allusions au heavy metal chez Cloutier), je crois, que se trouve toute la richesse de Scotstown et Cranbourne et, par extension, du mouvement du néo-terroir au Québec.
Références
Archibald, Samuel, «Le néoterroir et moi», Liberté, vol. 53, n°3, (295) 2012, p. 18-26.