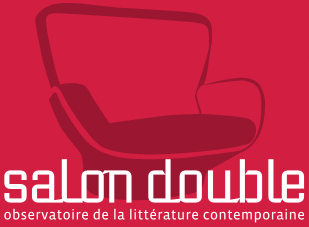Répondre au commentaire
De la Frontière à Grand-Mère
Passées les centaines d’heures à happer l’Amérique du Nord à partir de logiciels de cartographie ou encore de la base de données en ligne sur les délinquants sexuels, les désœuvrés Jude et Tess décident d’explorer de visu la ville de Bird-in-Hand, en Pennsylvanie. Le financement du voyage routier passe par une arnaque littéraire auprès du Conseil des arts du Canada à qui ils promettent de remettre le récit de leur épopée. Décidant, par orgueil, de ne pas remettre un manuscrit bâclé, Tess entreprend une formation littéraire à partir d’ouvrages de son mentor, Marc Fisher, qu’elle cite pour mieux parodier.
Les mises en abyme et procédés métatextuels qu’emploie Blais pour échafauder cet «anti-roman» qu’écrit une novice n’ayant cure des règles de l’art romanesques mièvres de Fisher n’impressionnent plus de nos jours, même s’ils demeurent maîtrisés et hilarants. Document 1 n’attirerait pas davantage mon attention si Blais n’avait pas su proposer une vision du monde qui m’apparaît révélatrice du contemporain. Il ne s’agit pas uniquement de sa conception du sujet velléitaire, s’embourbant dans un univers virtuel aux dépens de la réalité –Ducharme abordait ces thèmes il y a 40 ans– mais du rapport nouveau qu’il développe avec l’espace et le voyage continental rendu célèbre par le roman de la route kérouacien. Jean-François Côté, sur le récit de voyage nord-américain, rappelle que l’expérience de la Frontière favorise la (trans)formation cosmopolite de l’identité «à l’intérieur de territoires qui semblaient connus, mais qui se révèlent en fait dès lors, par le biais d’une nouvelle exploration, inconnus» (2003, p.504). Or, chez Blais, Tess spécifie que «les progrès dans les transports et les communications ont rendu le voyage banal. Aujourd’hui, tout le monde peut aller partout, ou, à défaut, tout le monde peut mémérer ce qui se trame à Rio de Janiero ou à Fort Myers […]» (p.64). Le périple providentiel à Bird-in-Hand relaté dans le sous-genre du récit de voyage, à une époque où Wikipédia fournit tous les renseignements désirés sur les us et coutumes des lieux, n’apporte plus la possibilité de renouvellement identitaire, même pour un lecteur vivant le voyage par procuration. D’où l’intérêt des périples automobiles extatiques du duo à l’intérieur de leur région, la Maurice, se substituant au voyage procrastiné aux États-Unis qui ne surviendra jamais. Dans un monde transnational où s’établit une «culture-monde» gouvernée par les États-Unis, «dans l’univers incertain, chaotique, atomisé de l’hypermodernité, montent ainsi les besoins d’unité et de sens, de sécurité, d’identité communautaire» (Lipovetsky, 2006 : 92). Au dépaysement souhaité à Bird-in-Hand se substitue le repaysement de la région natale, nouvel univers communautaire de proximité en palimpseste à la fois de la nation (québécoise ou canadienne) et de l’idéal postmoderne transnational déraciné.
Bibliographie
Lipovetsky, Gilles et Sébastien Charles (2006). Les temps hypermodernes, Paris, Le livre de poche (Coll. « Biblio-essais »).
Côté, Jean-François (2003). « Littérature des frontières et frontières de la littérature : de quelques dépassements qui sont aussi des retours », Recherches sociographiques, vol. 44, n° 3, 2003, p. 499-523.