Les fêtards et les trouble-fêtes
Printemps spécial est un recueil visiblement rempli de bonnes intentions, parfois naïf, qui prend le parti d'exposer les images marquantes de la grève plutôt que d'opérer ce travail souterrain auquel on se serait attendu de la part de littéraires. Certains textes se démarquent néanmoins du lot et sont d'une puissance qui nous fait oublier les moments plus décevants de l'ouvrage.
Je pense d'abord au magnifique récit de Nicolas Chalifour, «La jeune fille et les porcs», qui entrecroise habilement les discours et qui poursuit une montée dramatique saisissante. Chalifour explore ici un moment très médiatisé du mouvement étudiant, mais nous situe dans un lieu qui nous était inaccessible et pose un regard lucide sur l'effroyable violence qui s'y est déployée, avec une tendresse toute particulière pour celles et ceux qui en furent les victimes. Au cœur de ce texte, beaucoup d'informulé également qui en fait bien davantage qu’un simple compte-rendu d’événement. Quel effet la répression produira-t-elle sur chacun-e de ces militant-es matraqué-e, gazé-e, arrêté-e, battu-e? Chalifour soulève courageusement cette question, qu’on préfère généralement éviter.
Étonnant, et peu maladroit dans sa forme, le texte de Catherine Mavrikakis, «À la casserole!» nous confronte à un autre point de cécité du mouvement étudiant, à un aspect passé sous silence par les partisans du gel des frais de scolarité. À travers ce personnage du naufragé, Hervé, ce brillant intellectuel négatif, à travers cette évocation de la difficulté d’oeuvrer au sein de l'université, d’y trouver une place ou d’y évoluer, Mavrikakis pose des questions essentielles. Existe-t-il une véritable adéquation entre l'accessibilité financière aux études et l'accessibilité au monde universitaire? En d'autres termes: suffit-il d'entrer à l'université et de posséder un esprit brillant pour réussir à l'université? L'université telle qu'on la connaît est-elle si désirable? En trame de fond s'esquissent toutes les raisons pour lesquelles on pourrait sciemment décider de rejeter l'université. Et quoi qu’en disent les militant-es, qui affirment qu’on s’est interrogé sur la nature de l’université pendant la grève, ce débat fondamental n’a même pas été esquissé.
Fidèle à son habitude, Simon Paquet nous montre avec «L’inactiviste» (un bijou de titre!) un autre type de loser, pathétique, attachant, qui voudrait bien mais qui ne réussit pas. On aurait tort d'y voir là une banale critique du mouvement de protestation qui aurait entraîné avec lui des individus sans volonté propre. Il y a beaucoup plus que ça dans ce texte à la fois intelligent, un peu niaiseux et hilarant.
Insaisissable, «La corde» d'Olga Duhamel-Noyer représente assurément le moment le plus déstabilisant du recueil. L'érotisme qui entourait le mouvement y est évoqué avec subtilité et raffinement.
Enfin, le texte de Martine Delvaux «Autoportrait en militante», s'il n'est pas surprenant comme les autres mentionnés (ce n'est, de toute évidence, pas là son projet) restitue dans une langue rythmée le sentiment d'exaltation et d'angoisse qui a pu saisir plusieurs d'entre nous au printemps. Bien que l'utilisation de la deuxième personne du singulier gâche un peu l'effet, cela n’enlève rien à la très belle vivacité de ce texte qui nous replonge instantanément au cœur du printemps.
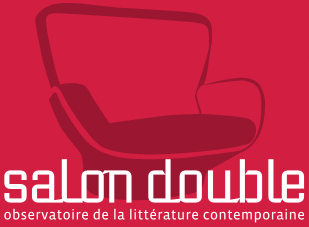



Commentaires
Quelques thèmes supplémentaires
Après consultation avec l'équipe de Salon Double, je me permets d'ajouter à la critique précédente en soulignant quelques thèmes supplémentaires ressortant de ce recueil, dans l'intérêt des lecteurs intéressés par cet ouvrage.
Si certaines de ces nouvelles se rapprochent davantage du compte-rendu documentaire (Gabriel Anctil, « La Révolte », Martine Delvaux, « Autoportrait en militante », Nicolas Chalifour, « La jeune fille et les porcs »), à mon avis, ce sont les approches décalées qui sont les plus intéressantes et les plus pertinentes. Je note au moins trois de ces thèmes récurrents.
«Je n'étais pas là » est le premier de ces thèmes, porté (à regret) par des nouvelles d'André Marois, Patrice Lessard, Michèle Lesbre et Gail Scott. Ironiquement, regarder le Printemps Érable à distance via les médias sociaux, que l'on soit à Paris, New York ou Montréal, aura peut-être été la grande expérience commune. A ce jour, cette question reste à approfondir.
Une autre idée revient: et si le Printemps Érable était enfin le « grand soir » attendu en vain par plusieurs pendant des dizaines d'années? Est-ce trop peu, trop tard, pour des gens impliqués dans la contre-culture depuis les années 80, mais qui ont fini par devenir amers dans leur vie personnelle et usés par le système universitaire? Les textes de Catherine Mavrikakis et Carole David (« L'atelier rouge ») se penchent sur cet aspect.
Autre thème recurrent à noter, l’absurde nous offre une approche un peu plus apolitique du Printemps Érable, en déconnectant complètement le récit du contexte politique. Avec « L'inactiviste », le personnage de Simon Paquet se retrouve coincé malgré lui dans un taxi fonçant sur les manifestants. Grégory Lemay nous rappelle que les lois de l'attraction n'étaient pas en grève. Et comment oublier la nouvelle la plus décalée, la plus surprenante relecture du Printemps érable que nous offre Olga Duhamel-Noyer avec « La corde », un récit ambigu et sexuellement trouble?
Publier un recueil de fiction sur un thème aussi ponctuel demeure un pari risqué pour un éditeur. Néanmoins, la fiction permet au recueil de se démarquer de la dizaine d'ouvrages documentaires parus à l'automne 2012. Nous ne pouvons que souhaiter à ce recueil de rester d'actualité un peu plus longtemps que la saison littéraire dont il est issu.