S'aimer comme dans une publicité
«Une de mes meilleures qualités en tant qu’humain est mon élitisme», annonce d’entrée de jeu le narrateur de Charlotte before Christ, et sans surprise, celui-ci passera une grande partie des pages suivantes à prouver qu’il est incontestablement plus branché que son lecteur. Les poètes, les marques de vêtements, les codes sociaux: Sacha, jeune vingtaine, connaît tout et en est revenu. Il sera bientôt riche et se rangera, mais pour l’instant, il est libre de se vouer à la seule chose qui semble le sauver de son sentiment de vide intérieur, sa relation avec Charlotte. Si Charlotte before Christ se présente initialement comme un roman sur une jeunesse désoeuvrée et trash, multipliant sans états d’âme les mauvais coups et les films porno, ce vernis de décadence subversive agit surtout en trompe-l’oeil. Au final, l’histoire d’amour entre Charlotte et Sacha ne se démarque pas vraiment d’un fantasme adolescent convenu, celui d’une histoire d’amour à la Sid et Nancy, carburant à la pulsion de mort et au narcissisme, entre gens beaux, jeunes et lubriques. Sacha est atteint de la maladie de Still, Charlotte a eu une enfance difficile, mais ces problèmes semblent davantage créés pour nourrir l’image romantique de leur couple que pour conférer une véritable profondeur aux personnages, comme s’ils posaient pour une publicité de Calvin Klein en exhibant des blessures positionnées avec esthétisme.
Évidemment, tout ceci peut être considéré comme le sens même du projet: à une jeunesse superficielle et en dérive correspondraient des personnages qui le seraient tout autant. Le même questionnement est amené par le style adopté par Soublière, un mélange d’anglais, de français et d’expressions à la mode. L’auteur ne manque pas d’oreille, mais l’ensemble n’est pas non plus d’une grande richesse ou d’une inventivité particulière, au-delà de l’effort pour reproduire les derniers tics langagiers montréalais. Une fois le livre terminé, quelques observations justes ou amusantes sur les mœurs contemporaines demeurent, de même qu’un épais catalogue de chansons et de marques.
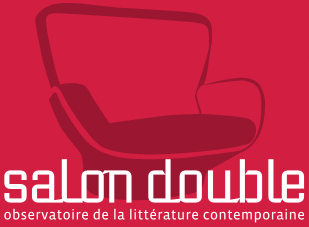



Commentaires
Question de filiation littéraire
(D'entrée de jeu, je précise que je n'ai pas lu le roman de Soublière. Mon commentaire semblera donc peut-être un peu stupide, mais c'est plus fort que moi et je me lance!)
Une collègue et amie qui a lu le roman m'en a parlé avec enthousiasme, il y a de cela quelques mois peut-être, et son "rapport de lecture" va à peu près dans le même sens que ta brève, Laurence : name dropping, langage trashy-trashouille, énumération de grandes marques; un cocktail qui n'est pas sans rappeler le Brat Pack, surtout Bret Easton Ellis, et les écrivains people (comme je hais ce terme!) à la Chuck Palahniuk. Dis-moi : est-ce que la parenté entre le roman de Soublière et ces écrivains américains à la prose parfois subversive s'arrête-là? La fiction, dans Charlotte before Christ semble-t-elle informée de ces auteurs auxquelles elle est peut-être redevable? Y aurait-il une sorte d'hommage là-dedans, à tout le moins un désir de s'inscrire dans ce type de littérature en particulier?
Tu sembles dire que le projet achoppe un peu, et tu déplores son «effort pour reproduire les derniers tics langagiers montréalais»; ce genre "d'étude de moeurs" trop collé à la réalité a souvent tendance à provoquer chez moi des réflexions semblables. Mais parfois, comme avec Bret Easton Ellis, on sent que c'est la littérature qui prend le dessus sur le projet, et qu'on atteint quelque chose comme une vérité universelle —permet moi le cliché horrible. Là, si je comprends bien, ça ne décolle pas. C'est ça?
Merci!
Bret Easton Ellis et Soublière
Pierre-Luc, tu as tout à fait compris le sens de ma critique, et je ne ferai à peu près que te paraphraser. La filiation avec Bret Easton Ellis a été amplement mise de l'avant par la critique, et sans doute confirmée par les propos mêmes de Soublière. Certainement, il me semble que l'auteur a ici voulu faire une sorte de The Rules of Attraction québécois. Contrairement à Bret Easton Ellis, toutefois, Soublière ne parvient pas, à mon avis, à dépasser l'aspect spectaculaire de son récit pour présenter un projet esthétique véritablement singulier, qui puisse se démarquer des chroniques style «Urbania». Plus que ça: j'ai l'impression que Soublière ne réussit pas à rendre son univers cohérent. Soit, on trouve beaucoup de tape-à-l'oeil du côté de la subversion (drogue, porno, vols, et j'en passe), mais il y a aussi un côté «romance adolescente» franchement insolite dans ce contexte, qui n'est jamais vraiment tenu à distance ou présenté comme tel, alors que le narrateur se voudrait pourtant une sorte d'homme du monde blasé et revenu de tout. À vrai dire je crois que c'est en partie à cause du personnage du narrateur que tout disjoncte: j'ai eu l'impression que Soublière voulait en faire une sorte d'anti-héros prodigieusement intelligent, mais ni son usage de la langue, ni les dialogues - assez peu rythmé ou surprenant -, ni ses réflexions sur le monde, ni la romance tout à fait convenue qu'il entretient avec Charlotte ne valident cette description. Sa voix manque de force et d'unicité, et c'est là où Soublière échoue, contrairement au Bret Easton Ellis des meilleurs jours.
Ellis, Soublière et pourquoi pas Louis Hamelin
Sans vouloir aller complètement ailleurs - je dois avouer ne pas avoir lu de Bret Easton Ellis, mais avoir lu le roman de Soublière -, un aspect qui a marqué ma lecture est évidemment la réception du roman, lourde et marquée à la radio, dans les journaux et jusqu'au quatrième de couverture. On insiste : c'est le roman d'une génération. L'aspect sociologisant m'a amené, au fur et à mesure que je découvrais ce roman, à établir des liens avec un autre roman qui, paru en 1989, était aussi décrit comme le roman d'une génération : La rage, de Louis Hamelin. Ici aussi, une histoire d'amour, un être cultivé - et porté par la culture, son petit nom est Malarmé -, un conflit avec l'autorité, une recherche du langage, l'avenir qui ne sourit pas, etc. Les différences entre les deux romans sont cependant marquantes : Malarmé n'a pas d'avenir, il va poursuivre ses études par désoeuvrement, sans espoir de carrière véritable - un X de la génération perdue - alors que Sacha est riche, il étudie et croit pouvoir tout perdre de son présent parce que sa vie appartient à cet avenir. Alors que dans La rage on marque le lien intergénérationnel par le personnage du Propriétaire (un vieux de la génération d'avant-guerre), et de ses enfants, des Baby-Boomers, et Malarmé, le X, dans le roman de Soublière, on reste au rapport conflictuel avec le confort des parents, et le confort de ces bourgeois qui partent en voyage en laissant leur grosse maison sans défense, maison que violeront avec plaisir les personnages de Charlotte Before Christ. Enfin, tout cela ne se retrouve pas explicitement dans ce roman, mais la réception induit une telle lecture qui, si elle n'a pas de valeur d'exemplum, sert quand même à mettre du sens dans ce projet de trop-contemporanéité - tellement trop que moi, de ma région, je trouvais qu'il poussait la note et m'amenait lentement dans un univers d'anticipation.