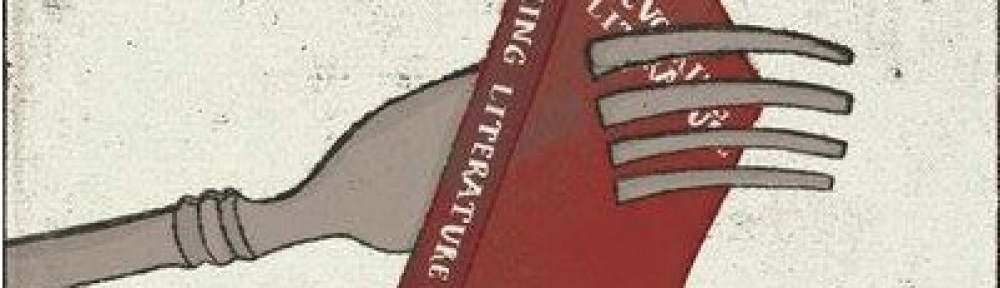Comme dirait cet illustre sage avec sa non moins illustre pensée philosophique : » Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. » Je me suis donc plongée cette semaine dans la lecture de livres savants pour étoffer mon discours et me donner une perspective d’analyse (pas juste pour avoir l’air intelligente!). Deux livres me sont tombés sous la main Le Discours gastronomique français – Des origines à nos jours, de Pascal Ory, Gallimard, Paris, 1998; et Écritures du repas – Fragments d’un discours gastronomique, de Becker et Leplatre, éd. Peter Lang, Allemagne, 2007.
J’ai donc lu ces deux ouvrages pour essayer d’y retrouver des thèmes récurrents, des thèmes dans le sens de topoï, outre que la nourriture bien sûr, qu’on pourrait retrouver peut-être (c’était en fait mon hypothèse de départ) dans une même époque chez certains écrivains. La surprise fut totale. Autant d’écrivains et de textes que de façon de voir, d’interpréter la gastronomie (l’acte de manger et celui de préparer la nourriture) chez les écrivains d’une même époque. C’est en fait intéressant de constater que la nourriture abondamment citée au Moyen-âge dans les livres est à la fois un symbole de festivités : descriptions de banquets fastes chez les Suzerins qui avaient pour but de distinguer nettement l’appartenance à une classe supérieure et de faire rêver ceux qui n’y appartenaient pas; est en même temps un symbole d’interdit : les nourritures « terrestres » sont condamnées, puisque « chère » et « chair » font parties des mêmes péchés que certains auteurs de l’époque, comme Saint-Benoît par exemple, s’évertua à dénoncer. À travers les années, d’ailleurs moult exemples de discours et de significations contradictoires existent sur la gastronomie avec des sous thèmes tout aussi en opposition (sexualité gourmande ou fétichisme extrême, épicurisme vs oisiveté excessive, abondance vs gaspillage, sensualité vs bestialité,…). Le discours gastronomique français traverse donc le spectre de toutes les couleurs possible dans ses significations. Même une oeuvre peut contenir les deux revers de la médaille : Pantagruel et Gargantua de Rabelais sont un bon exemple où la boustifaille est à la fois abondante et délicieuse mais dans la bouche des ogres, elle devient dégoûtante et putride. Où donc se situe le discours québécois contemporain ? Si on se fit au titre du dernier chapître du livre de Leplatre et Becker, intitulé : « Le 20ème siècle: l’entre-dévoration ou l’écriture de l’anti-repas ? » , il devrait peut-être tendre vers une connotation négative. Mais j’aurais tendance à dire « autres lieux, autres moeurs ». Il faudrait plutôt analyser les tendances du Québec contemporain dans leur propre ensemble et non en les comparant aux tendances françaises dont parle le chapitre de ce livre. Par contre, la lecture de ces deux livres me pousse à faire une lecture plus hétérogène du discours de la gastronomie au Québec. Une lecture qui pourrait aussi se laisser dériver vers des connotations négatives même si la tendance populaire est plutôt encline à donner des connotations positives, en 2013, à la gastronomie et ce, même en littérature.