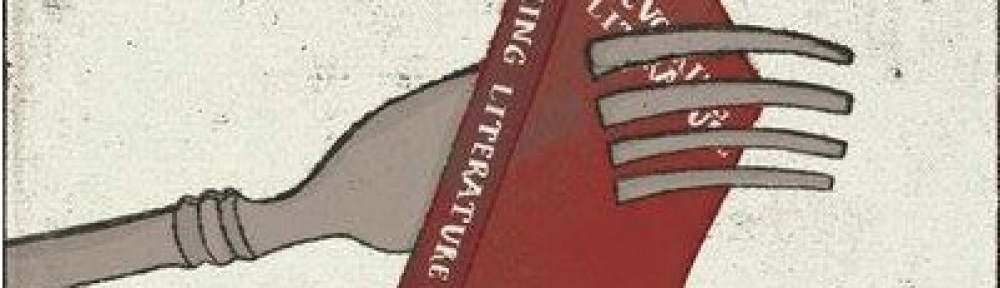La planète entière tourne autour de la nourriture ! Les émissions de cuisine foisonnent, les livres de recettes se multiplient, les chefs s’expriment sur tous les plateaux, les médias sociaux deviennent un buffet à ciel ouvert, les Foodies sont légions et le Food une religion! Par conséquent la littérature, qui n’est pas étanche au discours social, s’en empare et les écrivains qui parlent de cuisine dans leur livre ont la cote. La preuve, ils semblent avoir une visibilité que d’autres n’ont pas…
Ce petit quelque chose…
Il n’y a pas même trois semaines, le roi du barbecue américain, Steven Raichlen*, a fait beaucoup parler de lui en sortant son dernier livre, Refuge à Chappaquiddick : un roman! Bien qu’ayant publié une vingtaine de livres, tous des best-sellers, cet Américain n’avait jusqu’alors publié que des livres de recettes ! Il faut dire, quand même, qu’il a un parcours particulier : diplômé en littérature française de l’Université Reed en Oregon, il quitte ensuite les États-Unis pour étudier la cuisine médiévale en France, puis vient au Québec pour conclure un accord de publication de sa traduction en français aux Éditions de l’Homme, une division du Groupe Québécor, et tourner les 13 émissions de télé sur le barbecue pour le canal Zeste. Chouchou de tous les Québécois et les Québécoises qui voient en lui le maître incontesté du barbecue (combien d’hommes ont regagné leur virilité en dominant le gril grâce aux judicieux conseils de leur gourou?), peut-il aussi réussir à les séduire avec son roman ? Si on se fie à la critique (critique favorable de Chrystine Brouillet à Ça finit bien la semaine à la Première Chaîne de Radio Canada, mentions dans Rouge Fm, Cite Boomers, Le Journal de Québec, Le Journal de Montréal, Le Devoir, La Presse…) tous les médias, sans exception, parlent de son livre en termes élogieux, et de lui comme un être charismatique aux multiples talents. Évidemment, les mauvaises langues diront que le fait qu’il appartienne maintenant au Holding Québécor l’aide beaucoup (Éditions Québécor, TVA, Le Journal de Montréal, et Archambault en prime pour la vente de livres); mais les autres médias le prouvent : il a la cote. En plus, il sait comment plaire à son public : dans ses entrevues, il se fait un devoir de mentionner que même si l’intrigue est dominante… ses fans ne seront pas déçus puisque la nourriture y est présente et importante. Les interviewers en sont ravis et ne cessent de le questionner là-dessus. Comment y échapper ? En tous cas, cela l’aide à vendre ses livres car, comme on le sait, il ne suffit pas d’être un bon écrivain pour s’assurer un succès commercial. C’est le « principe Hygrade » : plus de gens en parlent et plus de gens en mangent! Gageons que ce sera aussi un best-seller.
Une autre sortie récente, québécoise cette fois, c’est le dernier roman de Kim Thùy, Mãn, paru aux éditions Libre-Expression et dont l’auteure a fait le lancement au restaurant Sesame du Vieux-Montréal. Dans son entrevue à la Première chaîne de Radio-Canada, elle répond au journaliste qui l’interroge sur l’omniprésence de la nourriture dans le roman et sur son apparence autobiographique : « Oui, la nourriture est très importante. Mais même si le personnage principal est restauratrice dans le roman, ou plutôt cuisinière au restaurant de son mari, cela n’est pas autobiographique. Par contre la nourriture est là parce qu’elle représente l’amour, la vie, cela fait partie de la culture vietnamienne et de son partage avec la culture québécoise… ». Une corde sensible que Thùy a touchée là en tous cas c’est l’intérêt des Québécois pour la cuisine vietnamienne, et plus largement pour les « cuisines du monde ». Une façon d’établir le contact par le biais de la nourriture. Coïncidence ou hasard que son avant-dernier roman, À toi, n’ait pas suscité le même engouement ni de la part du public ni de la part des médias ? Entendons nous bien ici, on ne parle pas de la critique, mais bien de couverture médiatique. Ex-restauratrice, passionnée de nourriture, nous livrant même ses recettes dans son dernier roman (on a tous les détails pour préparer certains délices de la cuisine vietnamienne), elle nous est immensément sympathique. Ce capital d’amour se traduit par des invitations à toutes les émissions importantes pour se faire voir (dont Tout le monde en parle) et lui vaut la coanimation d’une émission sur le câble, avec trois autres chroniqueurs dont notre comédien-épicurien, recyclé en animateur d’émission de cuisine, et j’ai nommé Monsieur-un-ti-verre-de-vino en personne : Christian Bégin! Les sujets à l’émission se mélangent allégrement : lecture, nourriture, vin, cinéma… On y découvre aussi la femme derrière l’écrivaine, une femme qui « croque dans la pomme », suivant l’expression de l’auteure.
On ne peut finir cette chronique sans parler de la précurseure, la première Québécoise à s’être fait connaître comme une écrivaine épicurienne et qui prend un malin plaisir à mettre en scène de la nourriture et du vin dans ses romans : Chrystine Brouillet. Notre « Dona Leone » québécoise (Dona Leone, l’auteure américaine de polars à succès qui parle de nourriture dans ses romans, ayant même publié un livre de recettes qui met en scène ses personnages, dont son protagoniste l’inspecteur Brunetti, dans Brunetti passe à table). Brouillet est aujourd’hui connue autant pour ses livres que pour ses nombreuses présences à la télévision et à la radio. C’est d’ailleurs elle qu’on a invitée en premier lieu à parler du roman de Raichlen sur les ondes de Radio-Canada. Grande amie de Ricardo Larrivée, ex-animatrice d’une émission de cuisine et amatrice de vins, elle incarne les plaisirs de la vie que sont la lecture et la nourriture!
Buon appetito!
Bref, même si cette chronique n’a pas du tout l’intention de remettre en question le talent de nos auteurs cités, force est de constater que parler de nourriture est de bon ton et de bon goût! Les médias et les journalistes ont un faible pour ces auteurs qui parlent de nourriture, les considérant sexys et c’est pourquoi ils leur font une grande place dans leur couverture médiatique car ils mangent littéralement l’écran!
entrevue de Kim Thùy: http://www.radio-canada.ca/emissions/cest_bien_meilleur_le_matin/2012-2013/chronique.asp?idchronique=283208
entrevue de Steven Raichlen: http://www.youtube.com/watch?v=mrVIUmL5lcA
* La Librairie Gourmande du Marché Jean-Talon se spécialise dans la vente de livres qui traitent de gastronomie ou qui placent la nourriture en avant-plan ou en arrière-scène. On peut y trouver les livres de Raichlen, Brouillet, Thùy et Leon.