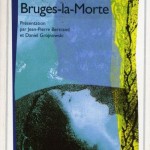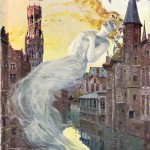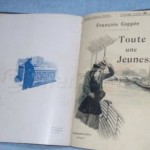« Bruges-la-Morte » une oeuvre hybride
Bruges-la-Morte est le premier des romans photographiques. Cette œuvre apparaît environ trente ans avant Nadja, d’André Breton. Ce roman photographique suscita de nombreuses controverses dans les milieux littéraires en raison de l’insertion de photos dans le texte, ce qui en faisait une œuvre hybride. Elle paraît en 1892, avec 35 similigravures, d’après des clichés de maisons pris par J. Levy & Cie ainsi que Nérudien Frères. Les premières éditions furent publiées avec la totalité des similigravures originales. En 1905, après la mort de Rodenbach, Flammarion publia une nouvelle édition contenant 19 des 35 similigravures. En 1910, Bruges-la-Morte sera publiée dans la collection illustrée de Flammarion, mais avec toutes les similigravures remplacées par des photographies d’amateurs non-signées. Dans les éditions qui suivirent, le livre fut accompagné d’illustrations représentant les personnages du roman. Toutefois, ces illustrations n’étaient pas des photographies mais des peintures. En 1914, Flammarion renonça à toute illustration. Il faudra attendre jusqu’en 1993 pour voir réapparaître 14 des 35 photographies originales, dans une traduction en anglais publiée par Atlas Press. Grâce à l’initiative de Terry Hale, l’œuvre fut ensuite reconstituée, au moyen d’illustrations photocopiées tirées d’un exemplaire de l’édition originale aux éditions Flammarion.
Les péripéties qui ont accompagné les différentes parutions du livre ont un rôle important dans mes recherches, car elles s’inscrivent une logique cohérente avec une certaine perception de la photographie. En effet, les formes de pensée ne percevant la valeur de la photographie qu’en fonction de sa reproductibilité mécanique font oublier le photographe et l’aspect artistique de son œuvre.
Les photographies accompagnant les premières éditions étaient des photographies de la ville de Bruges dans lesquelles les traces de la présence de l’homme avaient été effacées, ce qui est un aspect important du message que l’auteur a voulu transmettre dans son travail. C’est la ville, plus que ses habitants, qui joue un rôle fondamental dans l’œuvre. Certains critiques iront même à désigner la ville comme personnage principal de l’œuvre. Celle-ci apparaît morte, triste, mélancolique et grise, dans le roman. Hugues Viane pensait que cette ville l’aiderait à faire son deuil, mais cela n’a pas eu l’effet escompté. Il s’enferme, la plupart du temps, dans sa chambre, seul. Ses sentiments à l’égard de la ville ne sauraient être mieux traduits qu’avec ces photographies. Pourtant, la photographie a été négligée au fils du temps, avec chaque publication. Rodenbach était très conscient de l’impact de la photographie dans ces œuvres. Il décrira même l’arrivée de cet art comme le l’amorce d’une nouvelle ère pour la littérature, dans une conférence qui s’est déroulée à Paris en 1894. Malgré les déclarations de Rodenbach, les changements à travers les publications influenceront, malgré lui, les perceptions à l’égard de son œuvre.
Ses intentions quant à la place de la ville dans son œuvre étaient pourtant clairement explicitées dans l’avertissement qui accompagne Bruges-la-Morte :
Dans cette étude passionnelle, nous avons voulu aussi et principalement évoquer une Ville, la Ville comme un personnage essentiel, associé aux états d’âme, qui conseille, dissuade, détermine à agir.
Ainsi, dans la réalité, cette Bruges, qu’il nous a plu d’élire, apparaît presque humaine… Un ascendant s’établit d’elle sur ceux qui y séjournent. Elle les façonne selon ses sites et ses cloches.
Voilà ce que nous avons souhaité de suggérer : la Ville orientant une action ; ses paysages urbains, non plus seulement comme des toiles de fond, comme des thèmes descriptifs un peu arbitrairement choisis, mais liés à l’événement même du livre.
C’est pourquoi il importe, puisque ces décors de Bruges collaborent aux péripéties, de les reproduire également ici, intercalés entre les pages : quais, rues désertes, vieilles demeures, canaux, béguinage, églises, orfèvrerie du culte, beffroi, afin que ceux qui nous liront subissent aussi la présence et l’influence de la Ville, éprouvent la contagion des eaux mieux voisines, sentent à leur tour l’ombre des hautes tours allongée sur le texte.
La ville de Bruges a perdu sa voix en suppriment la photographie au cours des éditions subséquentes.