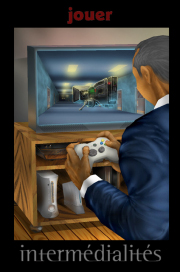Cinema and Play
 Printer-friendly version Printer-friendly version
Publications
BooksPerron, Bernard [2007]. Intermédialités (Montreal), Jouer, (ed.), No. 9, spring. [ online]
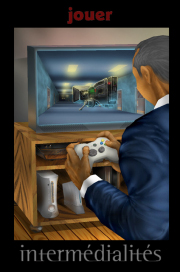
Homo ludens. Johan Huizinga affirme que ce terme qui caractérise l’homme qui joue convient peut-être mieux à notre espèce que les noms de homo sapiens — l’homme qui raisonne — ou de homo fabien — l’homme qui fabrique. Bien qu’il faille, comme le rappelle Jacques Henriot, résister à l’idée que le jeu soit "un facteur fondamental de tout ce qui se produit au monde", l’importance des jeux vidéo, de nos jours, ne peut que souligner la conviction de Huizinga voulant que "la civilisation humaine s’annonce et se développe au sein du jeu, en tant que jeu".
Des arts médiatiques à la littérature, en passant par le jeu vidéo et le cinéma, ce numéro propose une réflexion sur la ludification de la culture et des médias. Les textes présentés, bien que différents par les thématiques abordées, peuvent être regroupés selon deux approches distinctes. Premièrement, plusieurs auteurs ont choisi de s’intéresser aux relations fiction/jeu ainsi qu’aux médiations qu’elles engendrent. Qu’il s’agisse de l’interaction entre réel, virtuel et fictionnel au sein des jeux vidéo, de l’espace conflictuel fiction-réel créé par le "cinéma d’exposition" ou d’une redéfinition de la notion de hors-jeu à partir de l’activité autoriale et/ou spectatorielle, tous soulignent le caractère éminemment ludique de la fiction. La deuxième voie empruntée interroge, quant à elle, deux théories fondamentales du jeu : l’une qui rapporte l’activité ludique à l’apprentissage et à une pratique interprétative et l’autre qui l’associe à une forme anti-esthétique menant à la destruction.

Book chapters and papers
Arsenault, Dominic and Vincent Mauger [2012]. "Au-delà de 'l'envie cinématographique': le complexe transmédiatique d'Assassin's Creed", Nouvelles vues: revue sur les pratiques et les théories du cinéma au Québec (Québec), Le cinéma québécois et les autres arts (Elspeth Tulloch, ed.), No. 13. [online]
Perron, Bernard and Martin Picard [to be published in 2011]. "Petit guide en six termes pour survivre à l’approche théorique des relations entre le jeu vidéo et le cinéma", Les Cahiers du jeu vidéo (Paris), Jeu vidéo et cinéma, No 4.
Picard, Martin [2008]. "Video Games and Their Relationship with Other Media", The Video Game Explosion: A History from Pong to PlayStation and Beyond, Mark J.P. Wolf (ed.), Greenwood Press, Wesport, Conn., p. 293-300. [pre-publication PDF]
Perron, Bernard [2007]. "Présentation. L’entre-jeux : médiations ludiques", Intermédialités (Montreal), Jouer, Bernard Perron (ed.), No. 9, spring, p. 9-13.
Perron, Bernard [2007]. "Anaconda, a Snakes and Ladders Game. Horror Film and the Notions of Stereotype, Fun and Play", Journal of Moving Image Studies, Vol. 5 No 1, December, p. 20-30. [PDF]
In a chapter of her book Les idées reçues. Sémiologie du stéréotype (1991), Ruth Amossy deals with the industrialization of the fear and associates the fiction of terror to play and games. It is precisely this relationship between stereotype (a monster hiding behind every sign once said Barthes) and playfulness that this paper will wish to clarify. Borrowing concepts from social cognition, cognitive psychology, literature studies and theory of play, it will study the details of this "repetition within the diversity that insures the effect of the stereotype" (Amossy).
To do so, this paper will make a textual analysis of the genre film Anaconda (Luis Llosa, 1997). Furthermore, it will show how this film, introducing as the monster a huge snake, is designed as a sort of snakes and ladders game. It will demonstrate how stereotyped characters, here the documentary film crew - composed in particular of one Hispano-American director, one Black-American cinematographer, one British narrator and one White-American scientist -, are pawns that the director can "move". Following or perverting specific genre rules known by the spectator, those "moves" are also intended to make the latter "move around" the space or, to be more precise, the playground circumscribed by the fiction, i.e. the Amazon River. For instance, some moves, which could be called ladders-displacements, will make the characters and the narrative stride along, while snakes-displacements will eliminate pawns or thwart expectations.
This paper will conclude be showing the generalization of this design regarding the horror and the monster movies (the Snakes and Ladders displacements analogy can obviously be applied to other movies that do not have a snake as monster) and underlining that it is finally in a playful or ludic exchange that stereotypes take all their values.
Picard, Martin [2007]. "Machinima: Video Game as an Art form ?", Loading: Journal of the Canadian Game Studies Association, Vol. 1, No. 1. [PDF]
Perron, Bernard [2006]. "Quand le brouillard se dissipe : Silent Hill, le film", Ciné-Bulles (Montréal), Vol 24 No 4, autumn, p. 42-47. [PDF]
Therrien, Carl [2006]. "Le cinéma sous l'emprise du jeu. Références ludiques et mise au jeu dans le cinéma contemporain", Jeux et enjeux de la narrativité dans les pratiques contemporaines, Paris, Dis Voir, p. 92-104.
Perron, Bernard [2004]. "Pleins jeux sur le cinéma contemporain", Cinéma contemporain: état des lieux, Collection Champs Visuels, L'Harmattan, Paris, p. 293-308. [PDF]
Cet article interroge les diverses relations entre le cinéma, le jeu vidéo et la notion de jeu en général. Il réfléchit aux changements que celles-ci entraînent sur la production, sur la réception et sur la consommation des films. Si, tel que l'a entre autres souligné Guy Scarpetta, l'avènement de la postmodernité a redonné au ludique la valeur qu'il avait perdue dans le cinéma moderne, les jeux vidéo ont évidemment accentué cette dimension au-delà de toute mesure. "La mode des jeux vidéo, a pour sa part noté Alain Le Diberder, n'a pas seulement dopé l'industrie du cinéma. Elle a imposé un nouveau rapport du spectateur au récit : l'interactivité" (Cahiers du cinéma, No 503, juin 1996). De la sorte, s'il y a eu un temps où il était pertinent de conceptualiser le spectateur comme un décodeur ou un interlocuteur, il est aujourd'hui nécessaire de percevoir ce dernier comme un joueur. Le cinéma contemporain ne se conçoit plus sans un important rapport au ludique.
Babeux, Sébastien [2002]. "Le terrain de la narration ; en-jeu et hors-jeu (l'exemple de Deep Red de Argento)", Artifice, Dossier Cinéma, jeu, jeux vidéo : contaminations.[en ligne]
Perron, Bernard [2002]. "Hors-jeu : introduction", Artifice, Dossier Cinéma, jeu, jeux vidéo : contaminations. [en ligne]
Perron, Bernard [2002]. "L'approche ludique du cinéma de fiction : un jeu à motif mixte", Compar(a)ison, Culture médiatique, vol 2, p. 69-88. [PDF]
Cet article étudie les assises de l'analogie entre le cinéma et la notion de jeu. Il s'agit d'abord de présenter les notions qui collaborent à cette analogie (notamment la définition de l'art du suspense de Truffaut, la feintise ludique partagée de Jean-Marie Schaeffer et certaines thèses de la lecture comme jeu de Michel Picard) et celles qui entrent en conflit (comme la critique de Colas Duflo des définitions du jeu trop vagues et les distinctions de Espen Aarseth entre le texte narratif et le cybertexte ou le texte ergodique).
En second lieu, considérant les films fictionnels et narratifs comme des parties-jeux filmique, cet artcile souhaiter préciser de quel type de jeux il est question. D'une part, il est nécessaire de noter que les joueurs (parlons ici du réalisateur et du spectateur) doivent coopérer et collaborer (collaborative game) dans la progression du récit. D'autre part, il est nécessaire de montrer qu'il s'agit néanmoins d'une situation de compétition ("zero-sum" competitive game) où les joueurs ont des intérêts exclusifs. C'est pourquoi, mariant à la fois la collaboration et la compétition, cet article définit la situation de jeu du cinéma narratif comme une situation à motif mixte (mixed motif game).
Perron, Bernard [1999]. "Un indice pour ouvrir le jeu", Cinémas (Montréal), Cinélekta 3, Vol 10 No 1, p. 95-110. [PDF]
L'auteur trace les grandes lignes de l'analogie très féconde entre le jeu et le cinéma narratif. Il définit d'abord succinctement les traits constitutifs de l'activité ludique instituée par le cinéma narratif. Ensuite, il en étudie les principes à travers l'analyse de Clue (Jonathan Lynn, 1985), le film adapté du célèbre jeu de société de Parker Brothers.
Perron, Bernard [1995]. "Une machine à faire penser", Iris (Iowa City et Paris), La notion de genre au cinéma, Vol 20, autumn, p. 76-84. [PDF]
Barthélémy Amengual définit un genre comme une "machine à faire penser". Certes, dans la mesure où un film de genre est vu comme un récit préfabriqué qui suppose un ensemble de conventions et d'attentes, il est pertinent d'étudier les processus perceptifs et cognitifs mobilisés (consciemment ou non) durant le visionnement d'un film. Analysant House de Steve Miner (1986), l'auteur montre comment le spectateur est constamment engagé dans un cycle perceptivo-cognitif pendant qu'il produit du sens et prend plaisir au sein d'un genre cinématographique et du cinéma narratif en général. Durant ce cycle perceptivo-cognitif, le mode de perception top-down demeure le plus significatif. En bout de ligne, l'auteur souligne que l'espace fondamentalement ludique du genre (et de tout le cinéma narratif) est généralement toujours le théâtre d'un affrontement entre le réalisateur et le spectateur.
Perron, Bernard [1994]. "La mémoire, c'est ce qu'il me reste à défaut d'une vue", Cinémas (Montréal), Le temps au cinéma, Vol 4, No 1-2, autumn, p. 91-103. [PDF]
La temporalité filmique est analysée ici par rapport aux contraintes fixées par le temps de la projection. Parce que la projection d'un film s'effectue en temps réel, la compréhension du récit exige un effort perceptif et cognitif de la part du spectateur. Et la narration filmique tire profit de cet apport spectatoriel. Analysant Le Silence des agneaux de Jonathan Demme (1990), l'auteur étudie donc les mécanismes de la mémoire, les processus inférentiels ainsi que les deux modes de perception (bottom-up et top-down) qui sont activés lors du visionnement d'un film. Il expose aussi la tricherie qui ponctue la dernière partie du film.

Master and doctoral theses
Picard, Martin [2009]. Pour une esthétique du cinéma transludique : Figures du jeu vidéo et de l'animation dans le cinéma d'effets visuels du tournant du XXIe siècle, doctoral thesis, Livia Monnet and Bernard Perron (supervisors), Université de Montréal (unpublished). [PDF]
Babeux, Sébastien [2004]. L'interférence dans le cinéma postmoderne, master's thesis, B. Perron (supervisor), Université de Montréal (unpublished).
Perron, Bernard [1997]. La Spectature prise au jeu. La narration, la cognition et le jeu dans le cinéma narratif, doctoral thesis, André Gaudreault and Johanne Villeneuve (supervisors), Université de Montréal (unpublished). [PDF]
Cette thèse s'intéresse à la spectature-en-progression, c'est-à-dire à l'activité perceptive et cognitive du spectateur. En fait, il s'agit de reprendre à la base le programme initial de la sémiologie — le fameux «comprendre comment le film est compris» — afin d'étudier le parcours qu'effectue le spectateur tout au long d'un film fictionnel et narratif.
La première partie de la thèse questionne les principes que la narratologie cinématographique comparée a empruntés à la linguistique structurale. D'une part, l'analyse benvenistienne de l'énonciation donne préséance aux instances racontantes, instances qu'on pose a priori afin de comprendre l'«ordre des choses en soi». D'autre part, l'étude genettienne du récit consiste en une étude à partir de l'histoire, c'est-à-dire à partir d'un ensemble d'événements déjà racontés et (ré)arrangés dans un ordre chronologique. Dans un cas comme dans l'autre, ces approches ont laissé en plan et le spectateur et son parcours.
Parce qu'il appert difficile de comprendre «comment le film est compris» sans accorder de l'importance aux aspects cognitifs de l'activité spectatorielle, la seconde partie de la thèse tire profit des recherches effectuées en sciences cognitives. Je me préoccupe alors de la propension du spectateur à l'organisation narrative, de ses connaissances schématiques, de ses horizons d'attente, de son travail mémoriel, de ses anticipations et de ses modes de perception et de traitement de l'information. Encore toute récente dans le champ cinématographique, l'application des concepts et des notions de la science cognitive permet d'actualiser et de jeter un regard nouveau sur la réception du film. L'étude montre clairement que la compréhension du cinéma narratif repose sur tout un savoir préalable. Déplacée ainsi de l'énonciation vers la cognition, la spectature se définit comme une interaction avec le film.
Enfin, la dernière partie de la thèse emprunte une avenue théorique que les études cinématographiques n'ont pour ainsi dire pas explorée : la notion de jeu. Parce qu'il n'a pas de matière et qu'il oblige la reconnaissance de l'esprit, le jeu permet de prolonger les réflexions de la seconde partie. Conséquemment, en reprenant l'héritage de la théorie philosophique du jeu (Johan Huizinga, Roger Caillois et Hans-Georg Gadamer), il s'agit de définir les traits et les principes constitutifs de l'activité ludique instituée par le cinéma narratif et de se référer, suivant Gadamer, à une ontologie du film basée sur le jeu. Les films fictionnels et narratifs sont alors considérés comme des parties-jeux et sont répartis entre deux pôles : un pôle ludus-ilinx favorisant le plaisir gratuit de la vitesse et du vertige et un pôle ludus-agôn qui nécessite que le spectateur se creuse les méninges afin de comprendre une intrigue. Par ailleurs, en acceptant de prendre part à une partie-jeu, le spectateur se plie d'une façon ou d'une autre à un système de règles. Je propose un système composé de quatre règles : la règle de l'attention, la règle de la signification, la règle de la configuration ainsi que la règle de la cohérence. À travers cette régulation, l'activité perceptive et cognitive du spectateur se transforme en pure tâche ludique.

|
|