Introduction
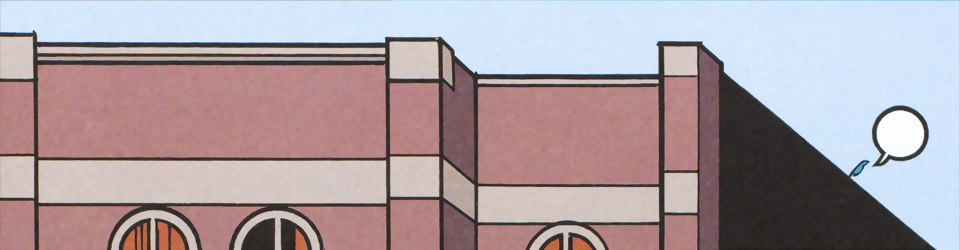
Quiconque explore la bande dessinée contemporaine découvrira un médium en évolution fulgurante. Largement consacrée à la littérature jeunesse avant les années 1960, il ne lui aura fallu que quelques décennies pour adopter les formes les plus variées, de la brève au roman graphique, de l’abstraction à l’autobiographie. D’abord considérée comme un genre mixte et immature, la bande dessinée s’impose aujourd’hui comme un langage complexe, sans équivalent. Sa composition hybride, où le trait se fait symbole, où le texte se fait texture, est en soi la promesse – bien tenue – d’un art en réinvention constante.
Il y a bientôt quatre ans, j’entamais une maîtrise au département d’études littéraires de l’UQAM. Mes premiers travaux abordaient l’autobiographique en bande dessinée : comment un « je » se complexifiait-il lorsqu’il était dessinateur-dessiné, ou plutôt narrateur-dessinateur, terme que j’employais alors? Le témoignage historique – pensons à Maus d’Art Spiegelman – me paraissait trouver en la bande dessinée un langage d’une justesse inouïe; sans doute, paradoxalement, grâce au biais visiblement subjectif du dessin. La mémoire – et son corollaire, l’oubli – s’est rapidement imposée comme porte d’entrée dans l’univers du témoignage. Car raconter, c’est se souvenir; et inversement.
Mon chemin était donc tracé : j’allais consacrer mon mémoire à une bande dessinée autobiographique. La lecture de Jimmy Corrigan, de Chris Ware, a tout bouleversé. Je me retrouvais soudainement devant une œuvre qui me semblait entièrement dirigée par ce qu’on pourrait appeler une logique de l’intime. Or, cette subjectivité échappait à mes outils théoriques d’alors; elle transcendait la question de la narration, autobiographique ou non. Elle s’incarnait à même le récit, en était la structure profonde.
Alors même que j’aurais dû entamer ma rédaction, j’ai changé de cap, renouvelé presque tout mon corpus. Je partais d’une intuition presque ésotérique et d’une fascination inaltérable pour tout ce que je lisais de Chris Ware. Ce demi-tour, qui me semblait folie pure, n’a guère impressionné Bertrand Gervais, mon directeur, qui m’a aussitôt encouragé à travailler sur Chris Ware. Outre ce coup de pouce, je lui dois les premières balises théoriques de ma recherche. La mémoire, comme processus cognitif et comme mode narratif, s’imposait pour approcher l’œuvre de Ware; Bertrand Gervais m’a suggéré d’étudier ses rapports avec l’architecture.
La richesse de ce couple conceptuel (mémoire et architecture), posé dès les débuts de mon travail, ne s’est jamais démentie. Outre qu’il fasse écho à la mnémotechnique antique des loci et imagines, qu’on détaillera au premier chapitre, ce couple permet d’étudier les rapports entre l’expression du temps et l’organisation de l’espace à la fois sur le plan de la figure et sur celui de la structure. Autrement dit, l’architecture, dans mon travail, sera considérée assez largement pour inclure à la fois les immeubles (qui impliquent toutes sortes de rapports au temps : ruines, sites commémoratifs, palais de mémoire... ) et les espaces abstraits. Dans l’œuvre de Ware, cela permet une porosité entre les figures (dessins d’immeubles) et l’espace même de la page, en tant qu’architecture narrative.
Mais avant de détailler davantage les concepts sous-jacents à ce travail, penchons-nous un instant sur l’univers de l’auteur. Franklin Christenson Ware s’est consacré à la bande dessinée dès son entrée à l’Université du Texas à Austin, publiant chaque semaine dans The Daily Texan, un des plus importants journaux universitaires des États-Unis. Il se fait offrir, en 1994, une publication régulière chez Fantagraphics, qu’il baptise ACME Novelty Library : quinze numéros paraîtront jusqu’en 1999. C’est grâce à l’ANL que Ware consolide définitivement sa réputation, accumulant un nombre impressionnant de prix Harvey, Eisner et Ignatz. Tous de format différent, ces numéros de l’ANL sont presque autoédités. Ware prend en effet en charge plusieurs étapes de l’édition, de la conception des couvertures à la révision linguistique. Or, le nom de Chris Ware n’est signé nulle part – certains lecteurs croient même lire un collectif. Plusieurs personnages naissent dans ces numéros : Frank Phosphate, Big Tex, Rocket Sam et, surtout, Jimmy Corrigan. Ce dernier donnera son nom à un roman graphique publié en 2000 chez Pantheon Books. L’ouvrage, acclamé par la critique, connaîtra un succès international.
Trois ans plus tard, Ware publie une compilation des planches de Quimby the Mouse, principalement réalisées au début des années 1990 pour The Daily Texan. Il reprend, en 2005, la publication de l’ACME Novelty Library, autour de deux projets de romans graphiques : Rusty Brown et Building Stories. Ce dernier a abouti en 2012 à l’œuvre la plus récente de Ware : une boîte à l’allure de jeu de société rassemblant 14 livrets de tailles très variées.
Héritier de la ligne claire, Ware a un tracé précis, voire géométrique. Ses dessins schématiques sont investis de couleurs vives et réalistes, le plus souvent en aplats. Ware défend ainsi cette esthétique :
I see the black outlines of cartoons as visual approximations of the way we remember general ideas, and I try to use naturalistic color underneath them to simultaneously suggest a perceptual experience, which I think is more or less the way we actually experience the world as adults; we don't really "see" anymore after a certain age, we spend our time naming and categorizing and identifying and figuring how everything all fits together1.
Ainsi, Ware recherche une expérience de lecture à la confluence de la cognition et de la perception. Cette esthétique agit comme catalyseur de lecture, rendant ses objets facilement lisibles. Or, avec Isaac Cates, le lecteur doit admettre que « Ware's comics are, as a general rule, anything but easy to read2 ».
Cette difficulté de lecture n’est pas causée par le dessin lui-même, mais plutôt par la composition des pages, que Ware construit comme des tableaux dont l'architecture, à la fois symétrique et surchargée, recèle des récits complexes et ramifiés. C’est ainsi que, paradoxalement, l’architecture des pages imbrique les dessins presque enfantins de Ware dans un processus de lecture remarquablement exigeant. Après tout, ne trouve-t-on pas cet avertissement sur la couverture de Jimmy Corrigan : « A bold experiment in reader tolerance3 »?
Jacques Samson remarque chez Ware « l’effet paradoxal d’un dessin apparemment froid et distant qui porte en lui la brûlante subjectivité d’une expérience intériorisée du réel4 ». En effet, les récits de Chris Ware se développent autour de l’intimité. Le temps est toujours celui du quotidien, lent5 et fragile, celui de la solitude et de l’introspection. Aussi les thèmes plus larges, comme ceux de l’Histoire des États-Unis ou de la filiation, se développent-ils également à partir de l’intime, du quotidien.
La question du temps, chez Ware, s’avère toujours problématique. La mémoire nourrit une nostalgie irrémédiable. Le rapport à l’enfance est énigmatique (Jimmy Corrigan), nostalgique (Quimby the Mouse), voire pathologique (Rusty Brown). Le deuil, l’oubli et le regret tissent les personnages. Or, malgré le passage du temps, ces personnages semblent jouir d’une certaine immuabilité : de père en fils, les Corrigan et les Brown sont des copies conformes. Thierry Groensteen formule ainsi ce paradoxe :
La question qui préoccupe Ware semble bien, au bout du compte, pouvoir être résumée (en termes bouddhistes) comme celle de la permanence et de l’impermanence des êtres et des choses. À la fois, tout change et tout demeure. Ou, comme le disait déjà Héraclite, rien n’est permanent sauf le changement.
Le phénomène affecte les êtres vivants mais aussi, Chris Ware ne l’ignore pas, les choses et les lieux6.
Les « lieux » sont, chez Chris Ware, non seulement le théâtre du temps, mais également son symptôme. Les figures architecturales évoquent à la fois le passé immuable (comme la maison de la grand-mère dans Quimby) et la ruine (comme le palais d’exposition de Chicago dans Jimmy Corrigan).
Devant la fuite du temps, les récits de Chris Ware s’offrent eux-mêmes comme espaces de mémoire. Le dessin et la mise en page semblent épouser les mécanismes intimes de la remémoration. Selon Jacques Samson, « le schématisme idéel de Ware ambitionne de plonger [son lecteur] dans une perception non-événementielle de la réalité7. » À la cinétique du temps qui passe, Ware oppose la statique d’une esthétique claire et schématique. Les cases, telles des briques, forment un bâtiment narratif qui est simultanément le lieu du récit et le récit lui-même.
***
Cet essai emprunte aux planches de Chris Ware une certaine allure symétrique. Il est composé de trois chapitres, chacun divisé en deux sections distinctes.
Le premier chapitre posera l’essentiel des prémisses théoriques utilisées ensuite. Sa première section sera consacrée aux rapports entre la mémoire et l’architecture (ou, plus généralement, l’espace) au sein de l’imaginaire. Il s’agit d’un programme ambitieux; trop, sans doute, pour cette modeste section. Mon intention sera surtout de soulever les rapports possibles entre la mémoire et l’architecture plutôt que d’en cerner les modalités systématiques. À cette fin, les figures du labyrinthe et du palais de mémoire serviront de repères conceptuels.
La seconde section de ce premier chapitre s’attardera ensuite à la bande dessinée elle-même, en tant que médium. Le Système de la bande dessinée de Thierry Groensteen constituera le fondement théorique à partir duquel cette section sera développée. Ce choix de corpus, qui sera discuté en détail plus loin, repose essentiellement sur l’importance que Groensteen accorde à l’architecture de la bande dessinée, en s’appuyant notamment sur les notions de lieu, de structure et d’articulation. Cette section constitue sans doute la partie la plus autonome de cet essai. Si la majorité des concepts serviront directement dans l’analyse des chapitres suivants, d’autres resteront en filigrane. Au final, cette section parfois digressive voudra proposer une terminologie cohérente pour parler de bande dessinée.
Les deux chapitres suivants constitueront l’analyse comme telle. Quatre ouvrages, à raison de deux par chapitre, y seront abordés. Cela peut sembler un nombre particulièrement élevé pour l’ampleur modeste de cet essai, et on pourrait défendre qu’un seul de ces livres nourrirait aisément une thèse entière. Toutefois, les œuvres de Ware abordent les questions de la mémoire, de l’architecture et de la subjectivité d’une façon à la fois variée et cohérente. Un corpus restreint m’aurait contraint à un douloureux sacrifice. Aussi ai-je choisi d’aborder toutes les œuvres qui me semblaient apporter une lecture intéressante aux problématiques de la mémoire, et de m’intéresser à ce que chacune proposait d’unique. Bien que décoiffant, ce large corpus a l’avantage d’offrir au lecteur un panorama du travail de Ware, en dépit de la spécificité des thèmes abordés.
L’analyse s’entamera autour des figures architecturales, c’est-à-dire de l’architecture dans le récit. Le premier ouvrage étudié, et non le moindre, sera Jimmy Corrigan. Ce roman graphique tisse un réseau de lieux récurrents, essentiels à l’ancrage temporel du récit. Nous verrons comment ces lieux peuvent s’avérer à la fois l’expression d’une mémoire historique et d’une mémoire subjective. Dans la seconde section, l’intimité occupera toute notre attention, autour du seul travail ouvertement autobiographique de l’auteur : Quimby the Mouse. Nous verrons comment un lieu récurrent peut accompagner un processus de deuil et d’oubli. De plus, Quimby nous confrontera à la perméabilité des figures et des structures, alors que certains lieux du récit y déterminent l’organisation même des pages.
Si le deuxième chapitre s’inspire de considérations architecturales (figurales ou structurantes) pour analyser la mémoire, le troisième et dernier chapitre effectuera un parcours inverse : l’expression de la mémoire des personnages m’intéressera d’abord. Le chapitre s’ouvrira donc sur un survol de quelques théories cognitives de la mémoire, principalement celles de Daniel L. Schacter, qui sera suivi d’une réflexion sur leur résonnance dans la bande dessinée. L’analyse de Building Stories – ou plus exactement d’un de ses chapitres paru en 2007 dans l’ANL, puis reproduit presque identiquement dans l’œuvre complète en 2012 – nous permettra d’observer la mise en espace de différents mécanismes de remémoration théorisés par Schacter. De plus, le récit fournira quelques exemples éclairants quant aux notions de mise en page et de narration développées dans le premier chapitre.
Le parcours se terminera avec Lint, un chapitre de la série Rusty Brown paru dans l’ANL en 2010. Ce récit, couvrant la vie entière d’un personnage, soulève plusieurs questions quant aux modalités d’expression de la subjectivité en bande dessinée. Nous verrons comment des processus cognitifs, tels la mémoire, mais également la rêverie et l’anticipation, peuvent se fusionner au présent d’un récit. Lint permettra également de pousser la question architecturale dans son dernier retranchement : le codex – qui impose, de page en page, son propre rythme au récit. Cela sera l’occasion de reconsidérer Building Stories dans sa forme finale, à savoir une grande boîte rassemblant 14 livrets séparés. Nous verrons comment cette fausse « monographie » permet un mode narratif tout particulier, insufflant une part d’aléatoire à l’expression d’une mémoire biographique.
Lint et Building Stories comptent parmi les ouvrages les plus audacieux de la bande dessinée contemporaine, et je tâcherai de leur rendre justice en ouvrant mes réflexions sur des terrains plus glissants : outre un bref questionnement sur l’héritage littéraire de l’esthétique de Ware, j’extrapolerai certains éléments d’analyse vers le médium de la bande dessinée en général. Pouvons-nous affirmer, avec Sattler, que la bande dessinée offre un terrain privilégié aux récits de mémoire?
[The] « art of memory » resonates, almost uncannily, with the art of comics: both emerge as a form of « inner writing, » deploying sequential images that come to life as one moves through them8.
Les chapitres qui suivent, sans pour autant répondre directement à cette question, tenteront de cerner les formes de cette « résonnance étrange » entre bande dessinée et mnémotechnique dans le travail de Ware.
- 1. Chris Ware, entrevue avec Rebecca Bengal. 2006. « Interviews: On Cartooning ».
- 2. Isaac Cates. 2010. « Comics and the Grammar of Diagrams », p. 97.
- 3. Sur la première édition cartonnée. (New York, Pantheon, 2000.)
- 4. Jacques Samson et Benoît Peeters. 2010. Chris Ware : La bande dessinée réinventée, p. 140.
- 5. Voir l’article de Georgiana Banita. 2010. « Chris Ware and the Pursuit of Slowness », p. 177-190.
- 6. Thierry Groensteen. 2010. « Chris Ware : Transmission, ressemblances, impermanence ».
- 7. Jacques Samson. 2010. Chris Ware : La bande dessinée réinventée, p. 135.
- 8. Peter R. Sattler. 2010. « Past Imperfect: "Building Stories" and the Art of Memory », p. 213.


