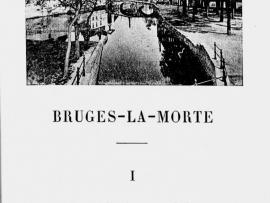OBSERVATOIRE DE L'IMAGINAIRE CONTEMPORAIN
Fragmentation et détachement du corps dans l'art de Zola et de Rodenbach
L’impossible représentation d’un corps véritablement incarné dans les arts est à la source d’une force créatrice particulièrement puissante dans la seconde moitié du XIXe siècle. Que ce soit chez Émile Zola ou chez Georges Rodenbach, l’impossible équivalence entre l’œuvre et la vie anime un rapport à la représentation du corps qui permet une observation en parallèle des pratiques artistiques de ces deux écrivains.
Créer un vrai corps dans l’art n’est qu’un leurre –un mirage séduisant, fascinant mais tout autant l’objet d’une indicible peur face à l’impossibilité de le toucher. Le rêve du vivant mène nécessairement toute œuvre vers une reproduction qui ne peut le rendre réel, car seul le mythe de Pygmalion pourra l’atteindre. Cette impasse semble particulièrement profonde et créatrice chez Zola et Rodenbach. Au-delà d’un simple subterfuge du monde réel, leur représentation d’une chair vivante semble tenter une échappatoire en l’exprimant en fragments, en morceaux découpés, ou en objets métaphoriques. Ces fragments relèvent généralement du désir, du fétichisme; seulement, chez Zola et Rodenbach, ces parties solitaires du corps deviennent une mise en abyme de la réification du monde dans la création littéraire, n’étant pas celle d’un démiurge divin: une coupure avec la vie, une représentation qui n’est faite que de lignes, de réseaux, d’objets déshumanisés. Cette spécularité de l’écriture entraîne nécessairement le désespoir de ne pas avoir un «matériau vivant» du corps –«matériau» qui aura cependant lieu dans les performances artistiques du XXe siècle comme chez Gina Pane. Parfaites incarnations du «symptôme» de la création face à la chair, Rodenbach et Zola le transfigurent à l’intérieur de leurs œuvres. Ce drame devient alors l’outil esthétique de leur art, mais aussi le lieu d’une rivalité entre la description littéraire et la photographie. Les Rougon-Macquart, le soutien inconditionnel à Manet et une pratique intense de portraits photographiques chez Zola semblent installer un dialogue avec Bruges-la-Morte de Rodenbach, sur le morcellement nécessaire des corps et l’illusion du vrai dans la photographie –réflexion relativement avant-gardiste à la fin du XIXe siècle. Au-delà des principes réalistes ou symbolistes, ces échos rendent les deux écrivains à la fois proches et lointains.
La marchandise des morceaux de chair dans Les Rougon-Macquart
Les fragments du corps exposent dans ce cycle romanesque la volonté d’une mise à distance avec ce qui ne peut être directement décrit, grâce aux actions des regardeurs. Ces personnages servent à lancer de longs portraits dans le texte, grâce à certains «trucages» tels qu'un miroir, une vitrine ou une esquisse d’artiste, comme l’a montré Philippe Hamon1. Or, dans ces descriptions zoliennes, le corps féminin connaît un démembrement inquiétant, des morceaux découpés et détachés voire même des objets.
L’omniprésence du corps de Nana dans le roman éponyme réalise-t-il un contre-exemple? Rien n’est moins sûr. La jeune femme est toujours décrite à travers les yeux de son amant Muffat, mais aussi de tous les hommes à travers lui, devenant une allégorie des effets de la chair. Ces regards masculins installent un fétichisme créant une distance rassurante face à un être uniquement physique, impossible à sonder, tel un sphinx2. Les portraits de Nana –parfait nom du rien– se transforment dès lors en une spécularité personnifiée de l’impuissance de la description romanesque des corps. La chair de Nana apparaît ainsi à travers de multiples reflets de miroir ou n’est vue que de dos. Une métaphore filée la détourne également en la transformant en lionne. Il en est de même plus loin lorsque sa chair est décrite par l’intermédiaire des bas-reliefs d’orfèvre sur sa tête de lit, devenant un mythe, une bacchante dans un badinage érotique. Le cheval «Nana» dans une course hippique porte quant à lui ses poils et sa chevelure et la nudité de la femme est contemplée à travers sa tenue transparente à travers un trou du rideau de scène. Muffat nous transmet alors sa fascination de la chair figée mais aussi terrifiante par des métaphores systématiques. Un seul exemple vient contredire nos propos dans l’explicit du roman, un portrait sans fard ni intermédiaire:
Nana restait seule, la face en l’air, dans la clarté de la bougie. C’était un charnier, un tas d’humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin. Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l’autre; et, flétries, affaissées, d’un aspect grisâtre de boue, elles semblaient déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie informe, où l’on ne retrouvait plus les traits. Un œil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence; l’autre, à demi ouvert, s’enfonçait, comme un trou noir et gâté. Le nez suppurait encore. Toute une croûte rougeâtre partait d’une joue, envahissait la bouche, qu’elle tirait dans un rire abominable. Et, sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux gardant leur flambée de soleil, coulaient en un ruissellement d’or. Vénus se décomposait. (Zola, 1960: 1485)
Voilà donc la vraie vision physique de Nana, lorsque son corps n’est plus… vivant: un objet biologique de la science –rivalisant avec le scandale de la fin de Madame Bovary. Ce regard précis et concret arrive seulement lorsque la maladie détruit l’intégralité de la chair humaine d’un être. Le retour de Nana, après sa fuite d’une lointaine Russie, sonne la fin de son existence qui n’était qu’une non-existence digne d’une déesse irréelle de la beauté3, car le vrai réel revient: l’oxymore du verbe «décomposer» détruit ce corps intouchable de manière expéditive en une phrase de trois mots. Celui-ci disparaît dans les dernières phrases qui s’éloignent de Nana, en observant le départ des soldats vers la guerre de 1870.
L’ensemble de ce roman souligne le rapport problématique des descriptions zoliennes à la chair vivante dans le cycle, que confirment de nombreux détails. Les tendances de la mode des vêtements transmises par des mannequins en témoignent dans Au Bonheur des dames. Sans tête, sans identité, ceux-ci deviennent les doubles des clientes. Dans les descriptions, ils partagent une posture immobile, mais aussi un tronçonnage dans les multiples miroirs du magasin. Les corps féminins sont ainsi montrés à distance, mais jamais en entier. Comme le remarque Régine Borderie, s’ajoute alors «un anonymat et une indétermination qui favorisent la fragmentation» (2005: 252). Ces «morceaux» de femmes en arrivent même à s’intégrer au design du magasin de Mouret en se mélangeant avec les séduisants objets et tissus et en devenant des produits à vendre, des marchandises en pièces détachées. Les vrais mannequins sans tête deviennent quant à elles paradoxalement, ou plutôt cyniquement, plus vivantes que les clientes:
La gorge ronde des mannequins gonflait l’étoffe, les hanches fortes exagéraient la finesse de la taille, la tête absente était remplacée par une grande étiquette, piquée avec une épingle dans le molleton rouge du col; tandis que les glaces, aux deux côtés de la vitrine, multipliaient sans fin, peuplaient la rue de ces belles femmes à vendre, et qui portaient des prix en gros chiffres, à la place des têtes. (Zola, 1964: 3924)
La description de ces «corps» semble plus facile mais elle est aussi le siège d’une réflexion sociologique sur la déshumanisation des consommations futiles. Au départ, l’énumération de ces membres est plus réelle que les vraies femmes dans Les Rougon-Macquart comme Nana. La gorge, la taille et les hanches évoquées relèvent qui plus est des parties charnelles, étymologiquement liées alors à la chair qu’on peut vouloir «pétrir». Ces objets de vitrine deviennent ainsi des vrais corps, abondants et donc séduisants (it.). La fin de l’énumération stoppe cette illusion personnifiée. Quoique. Leur visage et leur esprit sont remplacés par une étiquette de prix sur un «molleton rouge du col», couleur rappelant cyniquement une décapitation. Les mannequins deviennent donc des «belles femmes», certes «à vendre», grâce au miroir. Cet outil permet de les «multipli[er]» pour les faire devenir une foule «peupl[ant] la rue», donc en dehors de la vitre. Les reflets leur donnent dès lors la vie et les transportent vers le vrai monde. Cette description n’est pas seulement un amusement ironique de l’écrivain, car les miroirs en arrivent à inverser les règles. Dans la suite du roman, le magasin séduit les clientes et réussit alors à les enfermer dans son monde –principe commercial créé par Mouret. D’emblée, les femmes s’opposent à la fuite des mannequins au dehors des vitrines grâce aux miroirs, en les replaçant à l’intérieur. L’humanisation malheureuse des mannequins se renverse chez les clientes qui devraient avoir, elles, des corps humains:
Des piles de rubans écornaient les têtes, un mur de flanelle avançait un promontoire, partout les glaces reculaient les magasins, reflétaient des étalages avec des coins de public, des visages renversés, des moitiés d’épaules et de bras. (Zola, 1964: 627)
La phrase juxtapose des articles en vente et les reflets des clientes tronquées (it.). Les corps sont déshumanisés grammaticalement: ils sont des COD, donc des éléments passifs. Or, les verbes d’action qui les commandent ont paradoxalement comme sujet les choses du magasin. Ainsi s’inverse l’humain et l’objet dans le texte. De même, les «moitiés», le pluriel, les articles indéfinis associent ces membres à des morceaux dissociés de corps humains particuliers, d’autant que la présence du mot «étalage» à ce moment ne peut que nous faire penser à un «étal» dans une vitrine de boucherie. Au-delà de la critique du commerce nouveau, ces fragments du corps confirment la problématique du rendu d’un être vivant chez Zola. Ce chiasme des clientes objectivées en face des «mannequins vivants» ne peut que nous faire penser à la manifestation qui scandait la même expression contre les Galeries Lafayette Haussmann en 1999. Dans un «coup de maître» publicitaire, tel ceux d’Octave Mouret, le magasin avait laissé Chantal Thomass créer une exposition de sous-vêtements en vitrine par des vraies femmes vivantes face au regard des badauds. Les mannequins de cire sont alors incarnés par des femmes dont le métier est d’être «mannequins». Cette syllepse, comme celle de «l’incarnation», semble réaliser la prémonition de Zola.
Le portrait de Lisa dans Le Ventre de Paris se situe quant à lui dans des «étals» de boucherie. À l’intérieur de sa charcuterie, la jeune femme se trouve entourée de miroirs en cadre doré, du «m’as-tu-vu» de la boutique: une «immense glace» au plafond, «d’autres glaces» derrière le comptoir, à gauche, et au fond. Ces reflets qui se répondent sans cesse joueront à démembrer, à reproduire à l’infini et à déshumaniser son corps. Or, cette échoppe expose des morceaux de chair à vendre dans la vitrine, qui ne peuvent que nous faire penser aux parties du corps de Lisa qui sont choisies, identiques aux meilleures pièces de… viande. Celles-ci sont d’ailleurs aussi évoquées dans les reflets: «des portes […] semblaient s’ouvrir sur d’autres salles, à l’infini, toutes emplies des viandes étalées.» (Zola, 1960: 653) Ce parallélisme monstrueux est mené dans le regard de son beau-frère Florent, arrivant famélique après son évasion de Cayenne:
Florent finit par l’examiner à la dérobée, dans les glaces, autour de la boutique. Elle s’y reflétait de dos, de face, de côté; même au plafond, il la retrouvait, la tête en bas, avec son chignon serré, ses minces bandeaux, collés sur les tempes. C’était toute une foule de Lisa, montrant la largeur des épaules, l’emmanchement puissant des bras, la poitrine arrondie, si muette et si tendue, qu’elle n’éveillait aucune pensée charnelle et qu’elle ressemblait à un ventre. Il s’arrêta, se plut surtout à un de ses profils, qu’il avait dans une glace, à côté de lui, entre deux moitiés de porcs. Tout le long des marbres et des glaces, accrochés aux barres à dents de loup, des porcs et des bandes de lard à piquer pendaient; et le profil de Lisa, avec sa forte encolure, mettait une effigie de reine empâtée, au milieu de ce lard et de ces chairs crues. (Zola, 1960: 667)
La plupart des membres du corps de Lisa ne semblent pas lui appartenir en n’étant pas désignés par des déterminants possessifs, comme s’ils étaient à l’extérieur de son être. Les virgules d’une énumération de ces parties du corps insistent sur leur détachement. Le début de la phrase, «c’était toute une foule de Lisa», annonce quant à elle sa disparition de l’humain. Le pronom démonstratif neutre supprime son existence personnelle, que confirme sa multiplication, aboutissant en une foule. Son prénom «Lisa», qui devrait désigner une véritable identité, devient dès lors un simple complément du nom «foule», comme si le personnage n’était que des «clones» inquiétants. L’omniprésence des pluriels dans les fragments du corps suggère déjà le malaise du regardeur Florent face à elle. Cette terreur est renforcée par la présence violente de la chair dans ce portrait. Cet extrait succède à la description de l’abondance des étals de la charcuterie; or, les membres du corps de Lisa évoqués correspondent aux termes utilisés dans les morceaux de viande vendus dans cette boutique: «poitrine», «épaules», «ventre», «emmanchement des bras», «encolure». La position des glaces dans la pièce en arrive même à intercaler les reflets des fragments de Lisa entre les morceaux de viande exposés: «entre deux porcs», puis «au milieu de ce lard et de ces chairs crues». La femme se transforme ainsi en allégorie de la charcuterie, «l’effigie de reine empâtée» encadrée par les morceaux de viande. Le choix de l’adjectif «empâté» pour désigner sa lourdeur nous fait entendre nécessairement un «pâté» en terrine dans la vitrine. Les morceaux des corps de Lisa et des porcs se juxtaposent ainsi sans cesse, une phrase après l’autre, pour les faire se confondre lors de notre lecture.
Démembrée, réifiée voire même débitée comme une viande, Lisa devient des parties de chair morte dans cette description. Le regard de Florent semble ainsi exprimer la question épineuse de pouvoir représenter un être chez un écrivain ou un peintre. Le portrait réel du corps ne parviendra nécessairement jamais à être la chair. Claude Lantier, le peintre de L’Œuvre apparaît d’ailleurs pour la première fois dans Le Ventre de Paris. En racontant à Florent sa plus belle œuvre, Claude explique que ce tableau particulier était flamboyant dans la charcuterie: la vitrine devenait son cadre, les morceaux de viande des pigments, et leur chair cuisinée ou découpée un outil artistique parfait5. Décodons-le dès lors: la peinture ne peut rendre la chair vivante en n’étant pas elle-même réalisée avec de la chair, car toute représentation ne peut attendre la matière vivante, quoiqu’en soit le rêve artistique. Dans L’Œuvre, Claude incarnera ainsi une véritable mise en abyme de cet échec dans l’art.
La hantise picturale du corps de L’Œuvre: la spécularité d’une impossible création littéraire
Le rapport de Claude avec son modèle Christine met en scène le combat de l’art aboutissant à un morcellement du corps dans ce roman. Les œuvres les plus abouties du peintre sont en effet paradoxalement sous le signe de la fragmentation. La chair de Christine obsède l’artiste en le mettant face à son incapacité à créer du vivant –une entreprise fatalement vaine. De nombreuses scènes confirment la conscience zolienne de l’aspect hors réalité d’une œuvre, qui ne pourra jamais être l’équivalent de la vie.
La première rencontre de Christine et Claude entraînera son unique moment de réussite d’ébauche, avant l’abîme de la suite du roman. Accueillie pendant un orage, la jeune femme sera subrepticement dessinée durant son sommeil, lors d’une révélation du peintre apparue en voyant son corps. Modèle sans le savoir, cette jeune femme endormie révèle sa chair par petits bouts dans les jours de sa blouse, de manière immobile, naturelle et sans conscience. Cette création sera toutefois déjà peinte dans une décomposition du corps, Claude «découvrant la gorge», et admirant «une chair dorée, d’une finesse de soie, le printemps de la chair, deux petits seins rigides». Ainsi les fragments vivants se transforment-ils en un simple objet de gouache et d’allégorie, et non un vrai être humain: «C’était ça, tout à fait ça, la figure qu’il avait inutilement cherchée pour son tableau, et presque dans la pose.» (Zola, 1966: 19) La tautologie du rien, «c’était ça», annonce par avance la tragédie de son rapport très ambigu entre cette femme et son image peinte. Une fois devenue sa compagne, Christine n’est théoriquement plus «utilisée» comme modèle. Toutefois, les difficultés financières entraînent la reprise de quelques poses. Christine devient alors de manière inquiétante l’outil des «morceaux» de corps:
Claude avait pris d’après Christine des indications, une tête, un geste des bras, une allure du corps. Il lui jetait un manteau aux épaules, il la saisissait dans un mouvement et lui criait de ne plus bouger. (Zola, 1966: 238)
Tel un objet, la jeune femme s’avère «balancée» sans la moindre possibilité de volonté ou de gestes, et même désignée par un simple pronom anonyme, qui plus est l’objet du sujet… Les verbes d’action violents, mais aussi l’énumération de ses parties du corps comprenant des articles indéfinis, révèlent son morcellement et sa réification, tel un mannequin du Bonheur ou un morceau de viande du Ventre de Paris. Ce démembrement rappelle certes les croquis qui sont toujours exposés dans nos musées, tels ceux d’Ingres ou de Géricault. Toutefois, ce dépouillement ne se situe pas dans une description du dessin mais plutôt dans un vrai corps qui dort dans l’atelier…
Claude décrira lui-même ce corps vivant dans un faux dialogue avec sa compagne. Comme un critique d’art face à une toile, voire un anatomiste face à un cadavre, le peintre désigne ses fragments en termes techniques, froids, indéfinis comme s’ils n’étaient plus les siens6: c’est alors l’art qui va vider le corps vivant de Christine, devenu déréalisé. Puis, lorsque Claude en arrive à l’utiliser comme un objet quelconque, le narrateur compare cruellement ce corps à un «chaudron» ou une «cruche»:
Il l’employait pour tout, la faisait se déshabiller à chaque minute, pour un bras, pour un pied, pour le moindre détail dont il avait besoin. C’était un métier où il la ravalait, un emploi de mannequin vivant, qu’il plantait là et qu’il copiait, comme il aurait copié la cruche ou le chaudron d’une nature morte. (Zola, 1966: 240)
La jeune femme devient une fois de plus l’objet des verbes d’action que commande Claude: la toute-puissance d’un client sur ce modèle standardisé, disponible pour tout usage (it.). Ces termes font d’ailleurs écho à un bricolage ou une construction d’immeuble. Zola utilise l’énumération et l’anaphore pour dissocier les parties par des virgules et prépositions anaphores. La présence du mot «détail» dans la liste de l’accumulation place également au même niveau les fragments impersonnels et un outil mécanique. Tel un mannequin du Bonheur, Christine rencontre donc une inexistence de l’être dans la «copie», violemment comparée à des ustensiles de cuisine quelconques, la «cruche» et le «chaudron». Or, la cruche et le chaudron sont deux objets creux et vides, mots qui ont sans doute été choisis par Zola grâce à leurs sens subliminaux: le second possède dans son étymologie le sens de la mort en provençal, donc le vide; d’autre part, le premier rappelle le célèbre tableau de Greuze au Louvre, La Cruche cassée. Dans cette toile, le pot représente allégoriquement la perte du corps vierge de la jeune fille. Ces associations semblent concordantes dans la métaphore à l’intérieur de cette comparaison, puisqu’ils appartiennent à une «une nature morte», art qui les élève au même niveau qu’un être humain portraituré, comme l’énonçait Diderot sur l’art de Chardin:
Ô Chardin, ce n’est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette; c’est la substance même des objets, c’est l’air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau, et que tu attaches sur la toile. […] On n’entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleur, appliquées les unes sur les autres, et dont l’effet transpire de dessous en dessus. […] Approchez-vous, tout se brouille, s’aplatit et disparaît. Éloignez-vous, tout se crée et se reproduit. (Diderot, 2008: 82-83)
Ces propos rappellent la théorie artistique de Claude dans Le Ventre de Paris déjà évoquée, mais aussi celle du début de L’Œuvre. Son désir était de faire des œuvres vibrantes où une carotte équivalait en tout point une femme comme sujet, deux objets tout aussi louables:
Est-ce que tout ne se réduisait pas à planter une bonne femme devant soi, puis à la rendre comme on la sentait? est-ce qu’une botte de carottes, oui, une botte de carottes! […] Le jour venait où une seule carotte originale serait grosse d’une révolution. (Zola, 1966: 44)
Et pourtant, l’expression «nature morte» indique à elle seule l’impossibilité du rêve de Claude. Un objet, certes réel et naturel mais sans vie et immobile, ne pourra jamais être identique à un corps humain. La terreur du peintre engendre presque logiquement son acharnement pictural lors du décès de son fils7: les yeux fixes de son cadavre permettent à l’artiste d’adapter enfin sa création à un corps humain, en éloignant ainsi son incapacité à faire naître une vraie chair sur une toile. Comment ne pas encore penser alors à la sentence de Denis Diderot, qui annonce déjà le drame de cette esthétique dans le roman: «Mille peintres sont morts sans avoir senti la chair; mille autres mourront sans l’avoir sentie.» (2008: 181) Ce constat de l’impossibilité de rivaliser avec la vie entraînera le suicide de Claude en face de son dernier portrait irréel, non fini, et par là-même inexistant, qui devient le miroir de son propre corps mort.
Les termes utilisés par Zola pour désigner sa création préviennent déjà subliminalement la fin du roman dès son début. L’«acharnement» permanent de Claude dans l’art réussira à lui faire perdre sa propre chair. De la même manière, sa particularité est de toujours sublimer les «ébauches», terme désignant en effet à l’origine un embryon, un être créant ses propres parties du corps avant de naître. Ce mot désigne donc à la fois cette constitution vivante en cours et la préparation d’une œuvre d’art. Le récit est un véritable chiasme entre la naissance impossible de la peinture et le retournement de l’embryon dans l’existence arrêtée chez Claude. Une image furtive prévoit le drame esthétique de Claude dans son atelier dès le deuxième chapitre:
Il y avait encore d’admirables morceaux, des pieds de fillette, exquis de vérité délicate, un ventre de femme surtout, une chair de satin, frissonnante, vivante du sang qui coulait sous la peau […]. [Ces études] annonçaient un grand peintre, doué admirablement, entravé par des impuissances soudaines et inexpliquées. (Zola, 1966: 44)
Ce génie s’arrêterait ainsi aux esquisses, aux ébauches sur… des morceaux de corps. Le premier croquis du visage de Christine devient même presque comique par la syntaxe: «D’un mouvement instinctif, et dont il ne fut pas le maître, le peintre glissa dans un carton la tête de Christine.» (Zola, 1966: 32) Cette tête cachée réussit à nous faire imaginer un cadavre découpé, prédisant déjà la suite du roman8: la suppression du couple, de l’identité de Christine, de leur procréation, et enfin de la vie du peintre9. Claude n’est alors «pas le maître» de ses actes, ce qui annonce déjà son échec à devenir un autre «maître», celui de l’art. La suite du chapitre le confirme lorsqu’il découpe et détruit le visage sur la toile finale, de manière irrépressible:
Et, d’un seul coup, lentement, profondément, il gratta la tête et la gorge de la femme. Ce fut un meurtre véritable, un écrasement: tout disparut dans une bouillie fangeuse. […] Il n’y eut plus, de cette femme nue, sans poitrine et sans tête, qu’un tronçon mutilé, qu’une tache vague de cadavre, une chair de rêve évaporée et morte. (Zola, 1966: 57)
Ces premiers extraits sur ses uniques ébauches de génie face à un tableau irréalisable sont repris naturellement pendant son enterrement, lorsque ses œuvres et sa vie s’en sont allées. Faut-il dès lors y voir un écho de la même impuissance de la littérature réaliste dans la représentation de la vie dans la chair? Le plus proche ami de Claude, Sandoz, évoque lui-même ces ébauches dans sa conversation avec le peintre Bongrand:
Ah! ses anciennes toiles, reprit Bongrand, […], vous vous souvenez? Des morceaux extraordinaires! Hein? les paysages rapportés du Midi, […] des jambes de fillette, un ventre de femme, oh! ce ventre… […] Un grand peintre, simplement! […]
–Et il ne laisse rien.
–Absolument rien, pas une toile, déclara Bongrand. Je ne connais de lui que des ébauches, des croquis, des notes jetées […]. Oui, c’est bien un mort, un mort tout entier que l’on va mettre dans la terre! (Zola, 1966: 355-356)
Les fragments du corps dans ses ébauches superbes sont toujours gâtés par la suite, l’artiste ne sachant s’arrêter pour ne pas détériorer son œuvre –comme le démontrait d’ailleurs Picasso en peignant devant la caméra de Clouzot. Aucune solution ne semble offerte dans ce roman. Le dilemme entre faire vivre de manière illusoire un corps peint ou vraiment «vivre la vie» –expression non tautologique chez ce personnage– s’avère sans solution. Selon Bongrand, «autant partir que de s’acharner comme nous à faire des enfants infirmes, auxquels il manque toujours des morceaux, les jambes ou la tête, et qui ne vivent pas». Sandoz confirme lui-même ce constat des œuvres réalistes: «il faut vraiment manquer de fierté, se résigner à l’à-peu-près et tricher avec la vie… Moi qui pousse mes bouquins jusqu’au bout, je me méprise de les sentir incomplets et mensongers, malgré mon effort10.» (Zola, 1966: 363) Les derniers mots de Sandoz, «Allons travailler», s’avèrent donc en pure perte.
Si l’on associe les nombreux corps faux devenus des objets utilitaires et industriels sans la moindre existence dans Les Rougon-Macquart, ceci semble exprimer l’impasse du souhait de dépeindre un corps réel, toute représentation étant une reproduction, qui ne sera jamais «vraiment vraie» ni vivante. Toutes les descriptions de corps humains ne révèlent pas ce symptôme dans le cycle, en particulier lorsqu’elles sont des hommes ou des femmes vêtues; en revanche, il en est tout autrement quand le portrait se consacre à la chair, en particulier féminine –source de la vie. Ce morcellement de la chair humaine nous semble indiquer un malaise de l’écrivain dans sa propre volonté de créer un monde réel. Or, l’art littéraire n’en est pas l’unique indice.
Lorsque les corps inquiétants contaminent la photographie de Zola
La position d’un critique d’art est une chose, mais sa propre production artistique est parfois tout autre. Les engagements esthétiques de Zola, soutenant dès 1866 les œuvres de Manet au cœur du scandale, semblent en effet se retourner dans ses propres œuvres non littéraires, lorsqu’il réalise dans les années 1890 des milliers de photographies en partie préparées, composées, construites. Ces clichés manifestent alors une évolution croissante de son rapport paradoxal avec le corps dans Les Rougon-Macquart.
Dans la critique d’art des années 1860 sur Manet, la question des regards croisés entre un regardeur et une figure peinte est introduite par Le Déjeuner sur l’herbe et Olympia, le premier exposé en 1863 au Salon des Refusés, et le second en 1865. Les deux femmes centrales dans ces tableaux paraissent s’adresser au spectateur droit dans les yeux, le défiant voire même avec dédain, en nous faisant réaliser notre propre voyeurisme sur leur corps. Comme l’a montré Michael Fried, Manet supprime les «personnages absorbés», habituels dans la peinture plus traditionnelle, où le personnage feint de ne pas être vu par le public à travers une serrure dérobée. L’œil n’est alors pas toujours détourné, à la condition qu’il soit vague, désincarné ou rêveur pour ne pas atteindre directement le spectateur. (Fried, 2000: 143-168)
Ces deux œuvres de Manet renversent en tout point ces conventions en interrogeant notre observation des modèles féminins qui ne cachent pas leur nudité, et elles installent donc le «non absorbement». Au contraire d’une Vénus nue reposante, telle celle de Cabanel achetée par Napoléon III la même année, le déshabillage de ces femmes ne peut être associé à une simple grivoiserie de salon ou à un quelconque prétexte mythologique, mais plutôt à un concret «travail» féminin complémentaire. Olympia introduit dès lors des réactions scandalisées dans le public que les chroniqueurs retranscrivent, tel Chaumelin pour qui «tous ces gens-là ont l’air de nous dire: regardez-moi! Ils ne pensent pas à autre chose», ou Sensier qui s’amuse des effets sur les spectateurs: l’«insurrection armée dans le camp des bourgeois: c’est un verre d’eau glacée que chaque visiteur reçoit au visage lorsqu’il voit s’épanouir la belle courtisane» (cités par Fried, 2000: 165, 198). Lors de cette «affaire Manet», Zola exprime en presse un soutien ravageur contre ces spectateurs déchaînés et publie même un ouvrage entièrement dédié à l’artiste:
J’imagine que je suis en pleine rue et que je rencontre un attroupement de gamins qui accompagnent Édouard Manet à coups de pierres. Les critiques d’art –pardon, les sergents de ville– font mal leur office; ils accroissent le tumulte au lieu de le calmer, et même, Dieu me pardonne! il me semble que les sergents de ville ont d’énormes pavés dans leurs mains. Il y a déjà, dans ce spectacle, une certaine grossièreté qui m’attriste, moi passant désintéressé, d’allures calmes, et libres. (Zola, 1991: 142)
La revendication du vrai chez Zola entraîne nécessairement son soutien à Manet. La nudité accède en effet chez le peintre à la réalité suprême de la vie, notamment dans Olympia: «J’ai dit chef-d’œuvre et je ne retire pas le mot. Je prétends que cette toile est véritablement la chair et le sang du peintre. Elle le contient tout entier et ne contient que lui.» (Zola, 1991) Cette chair du peintre devient donc la gouache même de la création, transmettant sa vie dans l’œuvre: «la femme nue du Déjeuner sur l’herbe n’est là que pour fournir à l’artiste l’occasion de peindre un peu de chair.» (Zola, 1991: 159-160) Toutefois, son goût l’emporte avant tout vers une analyse purement esthétique des formes, des lignes et des nuances:
L’artiste placé en face d’un sujet quelconque, se laisse guider par ses yeux qui aperçoivent ce sujet en larges teintes se commandant les unes les autres. Une tête posée contre un mur, n’est plus qu’une tache plus ou moins blanche sur un fond plus ou moins gris; et le vêtement juxtaposé à la figure devient par exemple une tache plus ou moins bleue mise à côté de la tache plus ou moins blanche. (Zola, 1991: 151)
Ce regard zolien précoce annonce en théorie ses souhaits dans le cycle des Rougon-Macquart: comme Manet, l’écrivain compte ne plus rien masquer du réel. Toutefois, les fragments du corps qui apparaissent dans cet extrait proviennent de personnages échangeables et indiscernables. La tête, le visage et les vêtements ne sont que des taches, un agencement considéré uniquement entre les couleurs et les lignes abstraites. La volonté d’une représentation d’une vraie chair sera en effet plus malaisée plus tard, en raison de sa conscience de l’impasse de créer la vie. Cette description des toiles de Manet met ainsi à distance le corps vivant grâce au morcellement, qui rejoint déjà la mécanisation et la reproduction des fragments dans ses romans. Dans son article consacré aux fragments du corps dans l’art, Jocelyne Lupien confirme indirectement le paradoxe qui contaminera la théorie, la littérature, la critique d’art et la pratique photographique de Zola. L’historienne de l’art nous éclaire en comparant Olympia avec Sainte Cécile sculptée par Stefano Maderno à la fin du XVIe siècle:
[La] dureté [du regard d’Olympia] met à distance ce corps alors même que sa nudité semble au contraire vouloir tout en révéler. On a beau promener notre regard sur d’autres détails du tableau, c’est au regard particulier d’Olympia que nous revenons sans cesse. […] Le vêtement est aussi un outil formidable de représentation de l’image du corps […]. [Au contraire, Sainte Cécile] s’offre à la contemplation d’autrui, n’interposant pas son regard, ni son visage, ni son moi, contrairement à l’Olympia de Manet […]. La tête est même détournée, désaxée, par rapport à la position globale du corps. Cette Sainte-Cécile ne peut «voir» mais elle peut «être vue». […] Le caractère très tactile des vêtements ainsi que la visibilité des mains et des pieds dont la fonction est de palper les objets. (Lupien, 1993: 28-29)
Ce problème du regard installe un traitement ambigu du corps féminin chez Zola, aussi bien dans ses descriptions romanesques que dans son art photographique. De la théorie à une reproduction du réel, l’auteur démontre sa contradiction entre la chair qu’il loue chez Manet en critique d’art et ses propres descriptions qui la détournent grâce au morcellement opéré par les miroirs, les objets, ou encore les ébauches dessinées. Or, son goût tardif pour la photographie lui fait faire un grand pas vers la désincarnation. En effet, un cliché devait alors apparaître comme un aboutissement suprême dans la reproduction d’un être vivant. La fanatique «photomanie» de Zola engendre des milliers de prises de vue entre 1888 et 1902, tirées dans ses propres laboratoires. Faut-il y voir une libération de son impossible description des corps vivants? Rien n’est moins sûr. Dans sa prise de vue d’un paysage, les êtres humains sont minuscules ou secondaires; dans celle de ses proches au centre, ceux-ci jouent souvent une scène, une action posée ou immobile préparée par le photographe. Étonnamment, la plupart de ses portraits semblent plus proches des regards traditionnels en peinture et en photographie que de ses principes en critique d’art –en particulier ceux de Jeanne Rozerot et de leur fille Denise. Ces photographies mettent en effet en évidence une proximité de l’appareil; et pourtant, ces images reflètent des poses peu naturelles et réalistes ainsi qu’un regard absent, détaché de l’angle de l’objectif, et donc de l’œil du photographe, alors que la technique de cette époque ne nécessite plus une telle fixité.
Au-delà de la mise en scène, ces clichés zoliens s’éloignent ainsi d’un moment vivant et vrai pour le spectateur –or le spectateur de ces images est… Zola lui-même. La question du corps semble aller encore plus loin lorsque les photographies sont plus intimes, sans véritable costume. Massin remarque d’ailleurs que Zola a développé des portraits dans des «plans de trois quarts arrière, rares à cette époque» (1979: 147). Ceci implique en conséquence une création visuelle très personnelle, que Derain, par exemple, peindra vingt ans plus tard.
Le visage de Denise, morcelé et évanescent, disparaît dans le noir qui l’entoure derrière et devant elle. Cette magnifique image semble uniquement laisser un fragment étincelant qui s’enfuit sous nos yeux. Le corps de Jeanne est quant à lui fragmenté sans le moindre découpage de la peau. La blancheur éclatante de son dos dans la lumière ressort du sombre qui l’entoure. Cet angle réussit également à absorber les autres parties du corps dans le noir, qui auraient pu sans cela détourner notre regard. Dans ces deux disparitions, les regards et les lèvres ne peuvent exprimer un quelconque sentiment ou une pensée sur la scène: elles suppriment ainsi tout moment précis et présent, et rendent ces corps éternels. Zola semble dès cette époque sentir le terrible «ça-a-été» de Roland Barthes dans la photographie, en tentant de ne pas fixer une image réelle «en chair et en os» dans un instant vivant, qui ne vit déjà plus dans l’immobilité de cette saisie d’une seconde passée (Barthes, 1980). Ces clichés zoliens pourraient même illustrer la dépréciation dans cette technique du «hic et nunc» chez Walter Benjamin. Cette reproduction en série entraîne à la fois de l’admiration et de l’horreur, car elle parvient à rendre présent un parfait substitut de la chose, mais lui ôte par là même son essence, son «aura» quasi-cultuel: «multipliant les exemplaires, elle substitue à son occurrence unique son existence en série» et «parvient à standardiser l’unique11».
Cette sensation que semblait ressentir également Zola lui offrait malgré tout un pis-aller de l’incapacité de donner la vie à un corps en littérature. La réponse de l’écrivain, dans une enquête du Mercure de France en 1898 sur les romans illustrés en photographie, n’est donc bien qu’en apparence étonnante: «J’aurais préféré ne pas répondre, car je ne crois guère au bon emploi ni au bon résultat de ce procédé. On tombera tout de suite dans le nu.» (Ibels, 1898: 115) Ce photographe passionné dissocie clairement les clichés de la littérature, car les mots ne relèvent pas du même rapport au temps et à l’image. Son évocation finale du «nu» souligne au-delà de la pornographie la valeur peu féconde de ces images du corps, en ôtant toute leur vie dans notre imagination12. L’impossible création d’un corps en chair dans tout art provoque un désespoir de Zola, constat commun chez Rodenbach, qui en tire cependant une rivalité entre la photographie et la littérature.
Rodenbach face au corps vivant inatteignable: la domination de l’écriture symboliste sur le réel illusoire de la photographie
Bien qu’il soit conscient de l’incapacité de créer une vraie chair vivante, Rodenbach s’en affranchit. L’auteur fait de ce dilemme le sujet-même de Bruges-la-Morte, devenant la mise en abyme d’un combat stylistique entre l’écriture et les photographies dans ce roman. Lors de l’enquête du Mercure de France sur les illustrations, Rodenbach estime que celles-ci sont «ingénieus[es]» (1892 :113); cependant, il ajoute des propos plus proches de Mallarmé en indiquant une exception: «un lecteur un peu subtil aima toujours s’imaginer lui-même les personnages puisqu’un livre n’est qu’un point de départ, un prétexte et un canevas à rêves.» Il estime que «dans les romans de vie moderne, ce sera un élément de réalité, un document de plus». Or, en quelques mots, l’écrivain démontre par la suite le cas particulier des corps photographiés. En effet, le plaisir ne proviendrait pas d’un corps entier dans une scène immobile, mais uniquement de fragments plus ou moins cachés, créant alors des songes chimériques:
Si le sujet est galant, les illustrations représentatives d’attitudes et de gestes intimes, il y aura une secrète excitation à savoir que tels beaux bras, tel visage voluptueux, telle gorge entrevue, existent réellement quelque part… Et, en résumé, tout dépendra des photographies et dépendra des lecteurs.
Bien que la suite relève d’une boutade, la conclusion de Rodenbach sur sa propre lecture introduit d’emblée un combat entre l’art littéraire et la photographie: «Quant à moi, vous comprendrez que je m’intéresse principalement au texte, surtout quand il est de vous.» Et en effet, les illustrations tirées de cartes postales dans Bruges-la-Morte représentent la ville sans êtres humains. Elles utilisent ainsi des reflets de l’eau sans vague des canaux de Bruges, une dominance des bâtiments en pierre, voire un gros plan d’un monument, notamment des églises. Cet ensemble entraîne une réalité, certes, mais une réalité sans la moindre illusion d’un quelconque mouvement.
Deux exceptions dans les trente-cinq illustrations ne cachent pas la présence de personnes vivantes nettement visibles, qui deviennent cependant de simples «i», si inexistants qu’ils confirment presque ainsi la négation de la vie dans ces illustrations choisies. L’apparent contre-exemple du «i» ne pourrait en réalité mieux démontrer la disparition des êtres humains: le contraste noir-blanc souligné, la raideur de la personne, son rôle de perspective aux côtés de la ligne du chemin, son écho de la statue… L’ensemble ne pourrait mieux renforcer l’immobilité d’un mannequin chez cet homme. Dans le second contre-exemple, un homme s’avère au départ invisible bien qu’il soit au plus gros plan. Un pêcheur échappe à notre premier regard: situé à la limite de l’image, accolé au cadre, dans une tenue claire, les lignes de son corps se perdent dans celles de la barrière. Cette perspective vers la ville entraîne également le mouvement de notre regard, laissant de côté cet homme. Ces deux êtres signalent finalement plus que tout la disparition humaine dans ces images.
On pourrait voir une contradiction dans un dernier exemple comprenant des nonnes qui se rendent à l’église. Pour la première fois, des corps sont vus de près, dans une image toutefois perturbante. Entièrement recouverts, ils laissent uniquement voir des visages relativement proches saisis lors d’un mouvement, et pourtant… Cette image possède une profondeur de champ trop précise et nette; et paradoxalement, être moins exact aurait rendu ce cliché plus naturel. Cette illustration semble dès lors moins réelle que les autres photographies sans vie, et ressemble plus à un tableau de Muenier qu’à un vrai moment dans la ville13. Xavier Fontaine a récemment confirmé cette impression en ayant trouvé la source de cette copie, le tableau de Louis Tytgadt (Fontaine, 2015), cas unique dans ce livre. Ces corps ne peuvent en aucun cas nous donner l’impression d’un vivant face à l’appareil photo.
À cette absence d’humanité et de rythme s’ajoute la mise en retrait de la nature par une raréfaction des arbres qui sont soit cantonnés dans les angles, soit situés au loin, devenant de simples lignes et taches en noir et blanc. Deux clichés se différencient toutefois en mettant ces arbres plus en avant, mais les faisant uniquement devenir le cadre de l’image située derrière. Cette nature utilisée devient un simple encadrement situé en tête du livre, comme si ce roman était en réalité le sujet à représenter allégoriquement. Bien que l’organisation de ces images en collaboration avec Rodenbach ne soit pas prouvée, celle-ci indique un fort lien entre la photographie et la littérature chez lui: la tonalité des paysages de Bruges, les teintes en noir et blanc, le silence14, mais sans vie. Le malaise zolien face à la représentation du corps trouve donc des échos dans ce roman de Rodenbach, mais celui-ci ne lance pas de tentative pour substituer les portraits photographiques à l’échec littéraire. Au contraire, les clichés deviennent un outil subordonné soulignant l’écriture même du roman. L’auteur lui-même confirme cette idée dans l’avant-propos de Bruges-la-Morte, en évoquant les images comme décor reproduit: une «ombre des hautes tours allongée sur le texte.» (Rodenbach, 1892: II) Ces lignes architecturales ne sont que des lettres qui créent tout. Un double de cette mise en abyme commandée par l’écriture est celle de la disparition des êtres: les photographies sans vivant imitent ainsi le thème central du roman.
Dans Bruges-la-Morte, l’obsession d’Hugues Vian pour le corps de sa femme défunte restreint celle-ci à un simple fragment, sa tresse de cheveux. Cette dépouille est plus importante que tout portrait car elle laisse l’illusion d’une métonymie vivante de son épouse. L’idéalisation de ce fragment du corps sans chair permet au héros d’espérer faire renaître sa femme à travers la jeune danseuse, Jane, en raison d’une surprenante gémellité. Celle-ci ne devrait dès lors être qu’une copie immobile et silencieuse de l’autre femme. Or, face à cet échec de création d’un double vivant, le fragment de la chevelure devient donc plus vrai, plus vivant que la reproduction d’une femme trop vulgaire, qui semble ainsi moins réelle. Dans le goût du fragment de ce roman, entre réel et symbolisme, l’inconscient du héros semble rejoindre spéculairement la difficulté de tout écrivain face aux images du corps.
Hugues Vian est en effet enfermé dans son deuil, en dehors du monde dans son appartement aux fenêtres recouvertes par rideaux de crêpe. La vénération de sa femme sans vie, mais aussi sans nom, s’exprime également dans une création d’écrin. Nouveau miroir de l’enfermement, cette salle de recueil contient le plus grand «trésor» allant au-delà des portraits peints ou photographiés de l’épouse étant pourtant «comme des reliquaires» (Rodenbach, 1892: 88-90): une natte coupée de sa chevelure «jaune d’ambre». La servante, Barbe, unique présence dans l’appartement, ne peut la toucher. Cette partie du corps devient ainsi à elle seule le visage et l’identité métonymiques de la morte. Or, ce fragment n’est pas de chair, ce qui lui permet de dépasser la disparation de la vie, d’où sa puissance. La chevelure parvient dès lors à ouvrir des rêves hors du temps et dépasse tout dessin, toute image, car l’écriture engendre une imagination débridée15. Comme démonstration de cette idée dans Bruges-la-Morte, le fragment du corps n’était pas, volontairement, dans un «coffret obscur» (Rodenbach, 1892: 11), Hugues ayant peur d’enfermer à nouveau sa femme dans un tombeau. Le choix presque systématique de mots féminins, «chevelure», «natte» ou «tresse», en arrive quant à lui à faire se confondre le fragment et la femme sans nom dans les pronoms personnels «elle». Et pourtant, l’échec de cette illusion d’une reproduction du corps dans la «vraie vie» arrive très tôt.
Pour protéger cette tresse, Hugues prévoit de la «mettre sous verre, écrin transparent, boîte de cristal». (Rodenbach, 1892: 12) Cet enchâssement ajoute une nouvelle multiplication des cadres: fragment emprisonné dans un écrin lui-même enfermé dans la pièce interdite aux autres dans un appartement solitaire, installé dans un immeuble situé dans une ville contenant des cloîtres de nonnes recouvertes et séparées du monde –Bruges étant elle-même une forteresse enclavée par des canaux. Cette mise à distance permanente du corps se retrouve dans deux illustrations. Celles-ci semblent devenir le mimétisme de cette écriture en accentuant à la fin du roman son jeu de poupées russes: l’existence du rien à l’intérieur des multiples écrins. Le cliché de la châsse de Sainte-Ursule de la ville comporte elle-même sa propre «illustration» dans la peinture de Memling. Or, ce thème pictural est consacré lui aussi à un objet sacré… Encore un double, elle est l’image même de l’écriture du roman. De manière identique, le cliché de la châsse du Saint-Sang de Bruges semble encore un écho de cette idée. Le mot «sang» exprime à lui seul une allégorie oxymorique entre la vie et l’écoulement de la vie en dehors du corps. La dénomination «Saint-Sang» du Christ reprend la croyance de l’éternité; mais cette châsse symbolise dès lors la relique de la femme que son mari place involontairement dans une tombe –le coffret contenant des fragments du corps. Comme l’épouse, les deux fragments présents dans ces châsses sont séparés du monde extérieur et enfermés dans un coffret orné en métal ou en bois. Le reliquaire du Saint-Sang superpose également un cadre supplémentaire, puisque sa boîte contenant le fragment est ensachée à nouveau dans un baldaquin. Ces châsses photographiées multiplient donc les cadres en gigogne du roman, en ajoutant ces nouveaux cercles à l’intérieur d’autres cadres: une reproduction photographique située dans le cadre de la feuille, que l’auteur désigne lui-même «intercal[ée] entre les pages» (Rodenbach, 1892: II), elle-même enfermée à l’intérieur du livre: cet infini troublant fait disparaître toute chair, désincarnation sans fin dans toute création.
La photographie ne dépasse donc pas l’écriture littéraire mais la seconde dans le roman, en devenant elle aussi une frontière entre la chair vivante et son immatérialité dans l’art. Les deux objets sacrés semblent conçus pour illustrer à l’avance la fin du roman. Ces pendants dupliquent le contenu saint de la vie de l’épouse dans le coffret, et permettent dès lors à Hugues d’ouvrir les yeux sur son erreur de vouloir transformer lui-même sa défunte en un vrai être vivant, à travers Jane. Comme dans un reliquaire, cette femme idolâtrée est invisible, inatteignable; elle ne peut qu’être re-présentée comme le fait Memling avec la sainte Ursule, et non recréée –illusion qui mènera Claude Lantier à la mort chez Zola.
Cette reproduction physique entretenue par Hugues rencontre les premiers «morcellements» de sa chimère, annonçant l’explicit du roman. En pouvant enfin pénétrer pour la première fois dans l’appartement, la danseuse entre dans le monde construit de la défunte, refuse de porter les vêtements de la défunte tout en découvrant son utilité de copie dans les images de cette dernière. De même, lorsqu’elle réussit à ouvrir la fenêtre de ce cloître pour assister à la procession de Saint-Sang portant la châsse dans toute la ville, ce spectacle offre à Hugues une image spéculaire de son propre subterfuge. En effet, des jeunes gens «incarnent» dans la rue des êtres disparus, les saints, chose qui fait apparaître dans les yeux du héros le sens originaire d’une «incarnation»: «On aurait dit que s’étaient faits chair et animés par un miracle.» (Rodenbach, 1892: 210) Cette procession lui offre donc enfin la conscience de son erreur, car celle-ci est bien une re-présentation et non l’action de faire re-vivre un être disparu, car elle n’est qu’une mise en scène, comme la sienne avec Jane. Cette confusion entraîne alors la destruction du corps vivant, moins vrai que le fragment d’un corps décédé, la tresse, car le fétiche permet toujours, lui, de créer sa propre existence chimérique:
Les deux femmes s’étaient identifiées en une seule. Si ressemblantes dans la vie, plus ressemblantes dans la mort qui les avait faites de la même pâleur, il ne les distingua plus l’une de l’autre –unique visage de son amour. (Rodenbach, 1892: 220)
Dans la fin du roman, la chevelure fétichiste ne pouvait dès lors qu’être l’arme de l’étranglement de l’être vivant, Jane. Cette impossibilité de créer chez Hugues se confond ainsi spéculairement avec celle de toute œuvre d’art. Les images textuelles et photographiques de cette création littéraire mettent clairement en scène la conscience esthétique de Rodenbach du corps évanoui dans l’art. Elle entraîne alors un retournement du réalisme vers le symbolisme, démontrant la force du rêve face à la vraie vie. L’auteur développera cette idée en 1895:
Tel que la fille de Dibutade arrêtant le profil du fiancé parti, nous nous mîmes comme machinalement à tracer des mots, des rythmes, des images, des livres qui fussent la ressemblance de la petite patrie, cette petite patrie de la Flandre que nous n’avons recréée et ressuscitée pour nous, dans le mensonge de l’art […]. On n’aime bien que ce qu’on n’a plus. Le propre d’un art un peu noble, c’est le rêve, et ce rêve ne va qu’à ce qui est loin, absent, disparu, hors d’atteinte. (Rodenbach: 138)
Or, l’auteur avait composé, après le décès de ses sœurs et de son père, un poème en hommage à sa mère, intitulé «Le coffret». L’ode nous apprend qu’elle garde dans un «tiroir secret de sa commode», un «petit coffre en fer rouillé» qu’elle ne lui a «fait voir que deux fois». Elle devient le double prémonitoire d’Hugues Vian, en y déposant des fragments décharnés comme souvenirs, allégorisant les êtres morts: «comme un cercueil, la boîte est funèbre et massive,/Et contient les cheveux de ses parents défunts.» (Rodenbach, 1879: 9-10) Rodenbach réalise étonnamment lui aussi son propre coffret, tout comme sa mère et Hugues Vian; et pourtant, ses proches défunts ainsi que sa mère encore vivante, sont incrustés à l’intérieur d’un coffret irréel et dématérialisé: la clôture du poème contient des mots, des êtres sans corps, éternels dans l’esprit de tout lecteur, à savoir le pouvoir de l’écriture.
Les fragments des corps soulignent aussi bien chez Zola et que chez Rodenbach l’impossibilité de créer littérairement un véritable être vivant. Tout désir de la chair n’est nécessairement qu’un «aperçu», imaginé et non réel –d’où ces rapports ambigus avec la photographie. Ce dilemme aboutit chez l’un à se replier sur les morcellements, quand l’autre s’y confronte en les faisant s’envoler du réel. Comme nous l’avons vu, le malheur conscient de l’impénétrabilité de la vraie chair vivante envenime les représentations zoliennes de corps détachés, aussi bien dans Les Rougon-Macquart que dans sa critique d’art et sa pratique photographique. Au contraire, Rodenbach transforme l’hermétisme du réel en chair et en os en objet de création virevoltant, mettant l’écriture face à elle-même.
Bibliographie
Barthes, Roland. 1980. La chambre claire: Notes sur la photographie. Paris : Gallimard, « Le Seuil », 192 pages p.
Benjamin, Walter. 1935. L'oeuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. Oeuvres II.
Bertrand, Jean-Pierre et Daniel Grojnowski. 1998. « Présentation », dans Bruges-la-Morte, Rodenbach, George. Paris : GF-Flammarion, p. 7-44.
Borderie, Régine. 2005. « Pièces détachées: à propos du personnage dans "Au Bonheur des dames" », dans Vincent Jouve et Pagès, Alain (dir.), Les Lieux du réalisme. Pour Philippe Hamon. Paris : Éditions L’improviste-Presses de la Sorbonne nouvelle, p. 249-260.
Cnockaert, Véronique. 1998. « Dans l'ombre de l'oeuvre: "L'enfant mort" ». Cahiers naturalistes, 72, p. 351-361.
Delmas, Julie. 2012. À l’épreuve du réel. Les peintres et la photographie au XIXe siècle. Lyon : Éditions Fage, 182 p.
Diderot, Denis. 1763. « Salon de 1763 », dans Michel Delon (dir.), Salons, Delon, Michel. Paris : Gallimard, « Folio classique », p. 608.
Diderot, Denis. 1765. « Salon de 1765 », dans Michel Delon (dir.), Salons, Delon, Michel. Paris : Gallimard, « Folio classique », p. 608.
Edwards, Paul. 2008. Soleil noir. Photographie et littérature des origines au surréalisme. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 565 p.
Émile-Zola, François et Robert Massin. 1979. Zola photographe. Paris : Denoël.
Fontaine, Xavier. 2015. « La photo mystère de Bruges-la-Morte », dans Jean-Pierre Montier (dir.), Transactions photolittéraires. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, p. 137-157.
Fried, Michael. 1996. « Le modernisme de Manet ou Le visage de la peinture dans les années 1860 », dans Esthétique et origines de la peinture moderne,. Paris : Gallimard, « NRF Essais », t. 3, p. 414.
Grivel, Charles. 1999. « Le Roman mis à nu par la photographie, même ». Romantisme, 105, p. 145-155.
Grivel, Charles. 2004. « Zola photogénèse ». Études photographiques, 15, p. 31-60.
Hamon, Philippe. 1983. Le Personnel du roman: Le système des personnages dans les "Rougon-Macquart" d'Émile Zola. Genève : Droz.
Hamon, Philippe. 1989. Expositions: littérature et architecture au XIXe siècle. Paris : José Corti, 200 p.
Ibels, André. 1898. « Enquête sur le roman illustré par la photographie ». Mercure de France, vol. XXV, p. 97-115.
Lupien, Jocelyne. 1993. « Le corps morcelé: l’enveloppe épidermique et le vêtement comme forme d’érotisation dans l’art ». Espace: Art actuel, vol. 23, p. 25-29.
Piton-Foucault, Émilie. 2015. Zola ou la Fenêtre condamnée. La crise de la représentation dans "Les Rougon-Macquart". Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 1064 p.
Reverzy, Éléonore. 1999. « Nana, ou l’inexistence. D’une écriture allégorique ». Cahiers naturalistes, 73, p. 167-180.
Reverzy, Éléonore. 2007. La Chair de l’idée. Poétique de l’allégorie dans "Les Rougon-Macquart". Genève : Droz, 264 p.
Rodenbach, Georges. 1879. Les Tristesses. Poésies. Paris : Alphonse Lemerre, 122 p.
Rodenbach, Georges. 1892. Bruges-la-Morte. Paris : Flammarion.
Rodenbach, Georges. 1895 [04/1895apr. J.-C.]. « Paris et les petites patries ». La Revue, supplément de La Revue encyclopédique , p. 137-138.
Schor, Naomi. 1976. « Le sourire du sphinx: Zola et l'énigme de la féminité ». Romantisme, 13-14, p. 183-196.
Zola, Émile. 1867. « Édouard Manet, étude biographique et critique », dans Jean-Pierre Leduc-Adine (dir.), Écrits sur l'art. Paris : Gallimard, « Tel », p. 523.
Zola, Émile. 1873. Le Ventre de Paris. Paris : Gallimard, 470 p.
Zola, Émile. 1880. Nana. Paris : Fasquelle , 469 p.
Zola, Émile. 1883. Au bonheur des dames. Paris : Gallimard, 244 p.
Zola, Émile. 1886. L’Œuvre. Paris : Pocket, 492 p.
- 1. Consulter les ouvrages de Philippe Hamon, Le Personnel du roman. Le système des personnages dans Les Rougon-Macquart d’Émile Zola et Expositions. Littérature et architecture au dix-neuvième siècle. (Hamon, 1998;1989)
- 2. Voir sur ce point l’article de Naomi Schor, «Le sourire du sphinx: Zola et l’énigme de la féminité» (Schor, 1976).
- 3. Nous vous renvoyons sur ce point aux travaux d’Éléonore Reverzy dans La Chair de l’idée. Poétique de l’allégorie dans Les Rougon-Macquart, et l’article «Nana, ou l’inexistence. D’une écriture allégorique.» (Reverzy, 2007;1999)
- 4. Sauf mention contraire, nous ajoutons les séquences soulignées ou en italique dans les citations.
- 5. Zola, 1960: 800-801. Voir l’analyse picturale de cette charcuterie dans notre ouvrage Zola ou la fenêtre condamnée. La crise de la représentation dans Les Rougon-Macquart. (Piton-Foucault, 2015: 926-929
- 6. «Tiens, là, sous le sein gauche, eh bien! c’est joli comme tout. Il y a des petites veines qui bleuissent, qui donnent à la peau une délicatesse de ton exquise… Et là, au renflement de la hanche, cette fossette où l’ombre se dore, un régal!… Et là, sous le modelé si gras du ventre, ce trait pur des aines, une pointe à peine de carmin dans de l’or pâle…» (Zola, 1966: 241)
- 7. Voir, concernant cette question picturale du fils, l’article de Véronique Cnockaert, «Dans l’ombre de l’oeuvre: L’enfant mort» (Cnockaert, 1998)
- 8. Cette tête cachée peut en effet nous faire penser au film La Sentinelle réalisé par Arnaud Desplechin, un personnage envoûté par un paquet qu'il n'ouvre pas, bien qu'il le sente contenir une tête humaine momifiée.
- 9. Étapes du récit: la découverte du corps de Christine dans l'incipit; l'embryon de la naissance d'un grand tableau, avorté; l'autre embryon épuisé dès sa naissance, son fils allant déjà vers la mort; le corps de Claude qui le rejoint comme ses oeuvres disparues (explicit).
- 10. Ces derniers propos utilisés expriment encore des expressions figées issues du corps lorsque Bongrand et Sandoz évoquent leur désespoir: le premier considère que cette impossibilité artistique les tuerait s’ils «ne ten[aient] pas si fort à [leur] peaux», quand le second déplore qu’ils ne puissent rien créer en n’étant que «des reproducteurs débiles, autant vaudrait-il [se] casser la tête tout de suite.»
- 11. Cette citation provient de la dernière version L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, en 1939. (Benjamin, 2000: 276, 279; W. B. souligne)
- 12. Nous nous associons sur ce point avec la belle réflexion de Charles Grivel sur le rapport ambigu de Zola avec la photographie, y compris dans cette enquête: «il sait donc de quoi il parle et met le doigt à la fois sur une réalité qu’il accomplit littérairement et sur une réalité photographique qu’il récuse: le “nu” signe l’acquiescement de l’esprit à l’imprégnation malheureuse qui lui vient du réel.» (Grivel, 2004: 31-60; voir également Grivel, 1999)
- 13. Jules-Alexis Muenier appartient au «mouvement naturaliste» de la fin du XIXe siècle –peinture que Zola goûtait peu. Ce peintre réalisait des œuvres troublantes réalisées à partir de mises en scène photographiques. Cet art cherchait à rivaliser avec leur exactitude, sans grand changement dans le tableau. Voir sur ce point l’ouvrage issu d’une exposition du musée Courbet, À l’épreuve du réel. Les peintres et la photographie au XIXe siècle. (Delmas, 2012)
- 14. Voir par exemple la présentation de Jean-Pierre Bertrand et Daniel Grojnowski dans leur édition critique de Bruges-la-Morte (Bertrand et Grojnowski, 1998). Paul Edwards analyse quant à lui les symboles de ces illustrations dans Soleil noir. Photographie et littérature des origines au surréalisme. (Edwards, 2008: 33-56)
- 15. L’imagination fétichiste des cheveux s’avère célèbre dans la littérature du XIXe siècle, par exemple chez Maupassant et Baudelaire. Sa présence dans des chroniques de presse –en particulier celles de Félix Fénéon au début du XXe siècle– a d’ailleurs inspiré l’art photographique de Delphine Balley. Cette image de la force de la littérature à l’inverse d’images photographiques avait d’ailleurs été évoquée par Rodenbach sur sa lecture dans l’enquête du Mercure de France. (Ibels, 1898: 113)