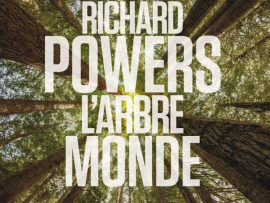OBSERVATOIRE DE L'IMAGINAIRE CONTEMPORAIN
L’arbre au centre de l’œuvre littéraire: charge émotionnelle, éveil écologique et méditation philosophique
L'affect peut ouvrir l'esprit sur la réalité. Je veux que les gens se disent qu'ils regardent leur présent en lisant mon livre. Si on raconte une histoire qui implique les gens de façon personnelle et émotionnelle, alors la révolution commence.
Richard Powers, 2018
Dans le roman L’Arbre-Monde, primé par le Pulitzer de la fiction en avril 2019, l’écrivain américain Richard Powers offre un récit qui soulève une interrogation résolument actuelle: comment se défaire d’un schéma de pensée anthropocentré afin d’éveiller une sensibilité écologique? Dans un entrelacs de présences végétales et de parcours humains et en plaçant les arbres au centre de la dramaturgie, l’auteur aspire et parvient à réajuster notre regard et à repenser nos actes. Matière élémentaire unissant les destins des personnages, le végétal est mis en lumière comme pilier fondateur de l’existence et partie intégrante de l’écosystème sans cesse en mouvement. Un rapport intime, un lien indéfectible relie les arbres à l’Homme, et cela n’est pas sans rappeler la valeur de l’arbre, son symbole politique et sa portée philosophique soulevés notamment par Alain Corbin dans son ouvrage La douceur de l’ombre: L’arbre, source d’émotions, de l’Antiquité à nos jours (2013).
En nous appuyant sur le postulat de Gilles Clément développé autour de la notion de Tiers Paysage1, nous tâcherons de faire résonner arbres et jardins ou plus précisément les paroles d’arbres et les histoires de jardins en croisant le geste de l’écrivain et l’acte de lecture.
Le prisme littéraire est, dans l’œuvre de Powers, mis en exergue par l’entremise de la figure de l’arbre-monde et les questions d’espaces et de limites. Au travers d’une fresque humaine et botanique se dessine en effet une éco-fiction qui saisit le lecteur et l’amène à se questionner sur un nouveau rapport sensible à la terre puisque, comme Gilles Clément, Richard Powers réussit à créer «un espace privilégié [un Tiers Paysage] au sein duquel la diversité biologique foisonne». (2006: 23)
Autour de faits scientifiques et écologiques réels explorés par le biais du personnage de la botaniste Patricia Westerford –à savoir la communication entre les arbres et l’extinction des forêts primaires sur le territoire américain– gravitent huit autres destins de personnages aux parcours variés. Chacun intimement relié à un arbre par l’histoire familiale, ils empruntent des chemins de vie qui convergent vers une quête commune (l’empêchement de la destruction massive d’une forêt de séquoias en Californie) et octroient au récit des dimensions symphoniques, signes de la nécessité d’agir pour redresser et préserver l’équilibre entre la nature et la culture.
La place centrale du végétal dans le roman actionne les mécanismes d’une lecture consciente et attentive, et c’est ce que nous tâcherons de relever. Dans cette optique, la fiction, ancrée dans un territoire et témoin d’une époque, nous offre un terrain d’études et de réflexions propice au champ de la géopoétique. Emprunter une attitude géopoétique conduit à combiner investigation, intuition et étude de la poétique2, et permet d’appréhender l’œuvre de Richard Powers dans sa globalité: tout comme l’écrivain, c’est à la croisée des discours littéraires et scientifiques que nous nous situons dans le but d’interroger le végétal. Les frontières entre l’humain et le végétal se veulent abolies pour repenser le rapport entre l’Homme et la Terre. (Powers et Broué, 2018) Richard Powers choisit en conséquence une posture éclairée, celle de l’écrivain, pour faire émerger un monde3 par et autour du végétal, pour composer un «arbre-monde» qui questionne le rapport entre l’esprit et la terre et suscite trois dimensions à fortes résonances: les dimensions émotionnelle, écologique et philosophique.
L’arbre au centre de l’œuvre littéraire: charge émotionnelle
Page après page, l’Arbre-Monde surgit, les esprits s’éveillent et la terre s’anime. Dans la lignée des écrivains, essayistes, philosophes et poètes américains Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau, Richard Powers orchestre un roman symphonique où la Nature et plus précisément les arbres transcendent la fiction. Cela se ressent dans les parcours et les récits des personnages: ils évoquent l’exposition au Dehors, à la Nature primaire, l’altérité et la wilderness. Les histoires familiales, professionnelles ou d’ordre privé conduisent l’écrivain et le lecteur à traverser des continents, des territoires, des plaines, des forêts et des jardins suite à un bouleversement, une quête, une construction identitaire, une errance émotionnelle.
Des racines au tronc, de la cime aux graines, le récit est dense et soulevant, oppressant et encourageant, criant de messages, témoin de l’urgence écologique que le monde actuel réclame.
L’arbre-racine, ancrage de l’habitat
La Terre gronde. Nous nous enfonçons dans des profondeurs abyssales et frôlons des hauteurs magistrales. Une à une, les racines traversent les pages, la terre, et se répandent, car une racine est une histoire, une vie, un arbre. Plusieurs vies, une généalogie. Neuf destins, neuf radicelles et autant de souches végétales qui prennent naissance dans le jardin familial: Nicholas Hoel et le châtaigner; Mimi Ma et le mûrier; Adam Appich et l’érable; Ray Brinkman et Dorothy Cazaly, le chêne et le tilleul; Douglas Pavlicek et le sapin; Neelay Mehta et le figuier; Patricia Westerford et le hêtre; Olivia Vandergriff et le tremble. Nous parcourons des continents –l’Europe (Norvège, Irlande), l’Asie (Chine, Vietnam, Thaïlande, Inde (provinces du Rajasthan et du Gujarat), l’Amérique du Nord (États-Unis) où se déroule le roman– en remontant les lignées et histoires de chacun des personnages. Nous croisons plusieurs générations et diverses professions.
L’héritage de l’arbre familial (raconté dans chaque «racine») tantôt transplanté, replanté, semé ou invoqué, sécrète une perspective historique liée à la notion d’habitat et la problématique de la domestication de la puissance végétale dans la culture et l’imaginaire occidental (Harrison, 2010), et offre une première entrée en matière vers des réflexions politiques et écologiques. Facteurs d’identité, de résidence, d’enracinement et porteur de lien et de lieu dans le récit, l’arbre et le véritable écosystème qu’est «l’arbre-monde» semblent incarner une figure d’expression de cette notion évolutive d’habitat. En effet, l’enjeu écologique entourant les forêts nourrit le drame et la fiction remet en jeu la perception de notre habitat en «dénonçant notre manière destructrice d’être dans le monde aujourd’hui» (Harrison, 2010: 285).
Tant par la forme de l’œuvre que son contenu, le végétal tisse silencieusement sa trame pour guider le lecteur, les personnages et l’intrigue. Une fois les racines installées dans une horizontalité paradoxalement nécrosée puisque arbres primaires et ancêtres s’éteignent un à un, le récit s’élève en une seule et même entité, le tronc, et mène vers des échappées activistes. Fragilisés par la vie –décès brutaux de proches, accidents, maladie, disparition, traumatismes et blessures de guerre, expérience de mort imminente–, les protagonistes ne sont pourtant pas laissés seuls face à leur souffrance. Ils sont soulevés par une autre bien plus grande: celle de la planète Terre, de la Nature, qui, malgré ses lésions et ses morts, perdure, appelle à agir avec conscience et rassemble.
Surgissement de la nature: communication entre les arbres
Afin d’expliquer cette idée de surgissement de la nature et de renversements des rapports, nous nous concentrerons notamment sur deux personnages-clés, Patricia Westerford et Nicholas Hoel. La première, botaniste, et le deuxième, artiste plasticien, illustrent l’équilibre des discours littéraires et scientifiques mis en place au sein de ce roman plaidoyer. Patricia nous entraîne dans la science, les organismes vivants et les connexions microrhizales. Nicholas, quant à lui, nous projette dans les motifs et la matérialité de l’art.
Un phénomène de convergence entre les différents personnages transparaît et confère à l’Arbre-Monde sa portée. L’écrivain instille pour ce faire quelques explications quoique mystérieuses et proches de la prémonition au cœur de sa septième racine. Patricia Westerford, docteure en botanique, joue un rôle central dans la composition de ce roman choral. Travaillant sur l’intelligence du végétal et la communication entre les arbres, elle fait de sa quête professionnelle une quête personnelle qui résonne à une plus grande échelle. Un extrait, placé dans le premier tiers du roman, témoigne de ce retentissement entre les racines et l’agencement de la fiction. Le passé, le présent ou l’avenir de chacun des personnages y sont évoqués du point de vue de Patricia. Et si Neelay Mehta, Douglas Pavlicek, Mimi Ma ou encore Olivia Vandergriff ont tous un arbre différent qui ancre leurs histoires personnelles, un point commun inattendu les relie et nous est dévoilé grâce aux connaissances scientifiques de Patricia: un tremble. Personne ne peut faire ce lien si précis jusque-là –nous, lecteurs, y compris– mais la présence du végétal instillé dès le démarrage du récit et les facultés de la botaniste à considérer le langage des plantes permettent à Richard Powers de réunir les neufs destins. Comme avec le tremble, aucune correspondance réelle n’est palpable entre les arbres et les personnages: à défaut d’un échange explicite, c’est un jeu de présence qui s’établit, une question d’essence et de vie qui pointe la nature même de l’existence de l’homme:
Tous ces gens ne représentent rien pour Patty la plante. Et pourtant, leurs vies sont reliées depuis longtemps, très loin sous terre. Leur parenté va se déployer comme un livre. Le passé devient toujours plus clair, à l’avenir. (...) Tout le drame du monde se concentre sous terre, en chœurs symphoniques massifs que Patricia compte bien entendre un jour avant de mourir. (150-151)
L’arc narratif se trace alors lentement, en pointillés, par la suggestion d’un réseau de communication entre les arbres, entre les trembles. Ces arbres immobiles migrent, ils se propagent par la racine et prolifèrent (Powers: 150), tout comme les intrigues qui pullulent au sein du roman et alimentent la puissance du drame écologique.
L’arbre au centre de l’œuvre littéraire: éveil écologique
Du jardin et de l’exploitation agricole familiale à la forêt, chaque arbre est donc un point d’ancrage, un point de départ d’une démarche personnelle et citoyenne pour l’ensemble des personnages et le devient également pour les lecteurs, même si cela s’implante en premier lieu dans l’inconscient, car l’auteur ne cesse de le rappeler en confrontant ses protagonistes à un même fait:
Personne ne voit les arbres. Nous voyons des fruits, nous voyons des noix, nous voyons du bois, nous voyons de l’ombre. Nous voyons des ornements ou les jolies couleurs de l’automne. Des obstacles qui bloquent la route ou qui obstruent la piste de ski. Des lieux sombres et menaçants qu’il faut défricher. Nous voyons des branches qui risquent de crever notre toit. Nous voyons une poule aux œufs d’or. Mais les arbres... les arbres sont invisibles. (2018: 449)
Quelques pages après, la déficience, voire l’absence de la vue chez l’Homme sont plus encore mises en évidence.
L’appel au vert: de l’arbre invisible à l’éveil
Le lecteur est concrètement pris à parti par l’emploi du pronom personnel «nous», et cela s’opère au travers d’une couleur évocatrice: le vert. Si nous pouvions voir le vert, si nous voyions le vert, notre vision, notre compréhension et notre usage du monde et de l’univers en seraient changés
Associée au monde végétal, symbole de nature et de liberté, d’harmonie, de stabilité et d’équilibre, la couleur verte est riche de significations et porteuse d’un fort héritage culturel: elle endosse bien souvent le rôle de l’ailleurs, de l’étrangeté et du fantastique –couleur des êtres étranges comme les fées, sorcières, lutins, génies des bois, ou encore les super-héros et les Martiens, entre autres. Également couleur de l’espérance, de la chance, ou, à l’inverse et en contexte négatif, représentative d’infortune et d’échec, le vert n’en finit pas de nourrir l’imaginaire. (Pastoureau, 2013)
Les représentations mentales liées au pouvoir signifiant de la couleur verte ne cessent de s’accroître au fil de la lecture. En effet, la narration, tissée autour d’une privation sensorielle, la vue, agit sur les fonctions cognitives et perceptives et ouvre une capacité à embrasser la présence végétale tel un besoin vital. Cette pratique de création choisie par l’écrivain n’est pas anodine puisqu’elle fait écho à une méthode thérapeutique qui était avant tout utilisée comme torture psychologique –technique mise au point par la CIA dans les années 50 et que l’un des personnages de Powers, Douglas Pavlicek, subit dans le cadre d’une expérimentation rémunérée. Cette première expérience modifie le comportement de Douglas et teinte son développement. Déconnecté du monde pendant un temps –six jours, une durée qui lui paraît impossible tellement le cauchemar est insupportable (132)– une rage d’être à l’air libre va le tenir dès sa sortie. Et s’il continue à s’exclure de la société en empruntant un parcours marginal, cela le conduit finalement à nourrir une attitude consciente et engagée qui participe à son éveil écologique: «Une grande vérité lui apparaît: Les arbres s’abattent dans un fracas spectaculaire. Mais le semis est silencieux, la croissance invisible.» (Powers: 104) Il s’acharnera alors à replanter des clairières décimées par les industries forestières et en viendra à s’enchaîner à des arbres pour empêcher les abattages.
C’est un éveil que le lecteur est libre à son tour de manifester. En effet, tout au long du roman, le souffle créé par la dramaturgie humaine peut délibérément entraîner à continuer de poser un regard borgne et d’écarter les passages consacrés aux végétaux. Pourtant, ce mécanisme inhérent à une vision anthropocentrée et ancré dans nos schémas de pensées, une fois reconnu, pointe la puissance du discours littéraire.
Richard Powers rythme ses pages d’une respiration verte et accorde son écriture et notre lecture au temps végétal. Densité de l’intrigue, lenteur et temporalité étirée sur plusieurs décennies cultivent au fur et à mesure un éloge du regard et une méditation du temps et des événements. De cette manière, l’écrivain nous entraîne – nous et ses racines – dans un mur inévitable face à la situation écologique actuelle. Ce réveil implicite installé dans la fiction prend la forme concrète d’un «Manifeste de l’échec» rédigé par Douglas Pavlicek:
Le stylo court; les idées se forment, comme guidées par un esprit. Quelque chose resplendit, une vérité si évidente que les mots se dictent tout seuls. On encaisse un milliard d’années de bons d’épargne planétaires et on claque le fric en pacotille bling-bling. Et ce que Douglas Pavlicek voudrait savoir, c’est pourquoi il est si facile de s’en rendre compte quand on est tout seul dans une cabane à flanc de colline, et presque impossible à croire dès qu’on sort de la maison pour rejoindre plusieurs milliards de gens repliés sur le statu quo. (2018: 410)
Une respiration verte, la puissance de l’éco-fiction
Richard Powers installe ici une mise en abîme au travers du prisme littéraire. Un à un, les personnages sont amenés à changer de regard. Suite à des drames personnels, leurs mondes et environnements respectifs sont détruits, leurs habitudes sont déconstruites. Sous forme de résilience, ils se tournent vers la terre, enfin à son écoute, et se mettent en marche, armés de convictions et d’intentions qui les dépassent. L’élagage sans raison valable d’un parc municipal placé en face du bureau de Mimi Ma lui fait quitter son poste tant convoité d’ingénieure. Bordé de pins ponderosas dont émane l’essence de térébenthine, le bosquet rappelle à la jeune femme de précieux souvenirs de vacances et de son défunt père. Mimi ne peut effacer le passé et empêcher son père de s’ôter la vie, mais elle s’opposera coûte que coûte à des abattages scandaleux.
En ce sens, par l’intermédiaire de chacun des personnages et de l’incarnation d’un livre en arbre, nos rapports au monde fictionnel et au monde réel se fondent et se croisent. Surgissent, de part et d’autre, prises de conscience et mises en action de la parole et du geste éco-citoyen.
Par ailleurs, en jouant sur une verticalité propre à l’arbre lors de l’installation du récit, le romancier ouvre une porte propice à la déconstruction de codes et de valeurs. Du sol jusqu’au ciel, l’arbre s’élance et habite l’espace littéraire. L’horizontalité s’insère pleinement dans cet axe et permet à Powers de déployer la force de son écofiction. Encore une fois, et toujours dans le but de provoquer chez l’être humain un changement de lunette sur le monde et la nature, les frontières sont abolies. Les calques horizontaux et verticaux se superposent pour instituer un «Arbre-Monde», un «Jardin en mouvement» mis en récit.
D’un drame qui se joue sous terre, des proliférations par les racines, nous accédons à de nouveaux paliers –le tronc, la cime et les graines– qui inscrivent la fiction dans un courant de pensée écologique et un contexte bien réel à l’heure de l’écriture de ce roman, celui du territoire américain pris en étau par l’administration Trump.
Les histoires de jardins, prémisse de chaque racine-personnage, permettent au récit de s’élever vers des paroles d’arbres. Pour aller plus loin dans le sens de mouvement et de paroles, nous pouvons concevoir l’arbre comme la figure du seuil. Nous nous appuyons dans ce sens sur la poétique des images de Gaston Bachelard et la poétique des jardins de Jean-Pierre Le Dantec pour établir un parallèle avec la figure de l’arbre qui nous préoccupe. De plus, notre réflexion autour de la figure du seuil s’inscrit dans le prolongement de celle élaborée par Rachel Bouvet sur les espaces interstitiels du végétal. En démontrant que «l’analyse des parcours et des frontières met en évidence la tension entre immobilité (de l’arbre) et mouvement (des personnages, des feuilles, de la sève, de la laque…)» (à paraître), Rachel Bouvet met l’emphase sur une clé de lecture importante quant au rayonnement de l’éco-fiction.
En effet, étymologiquement, le mot «seuil» vient du latin limen et partage la racine limes avec les mots «limite» et «frontière». Quand il s’agit de territoires et de jardins comme évoqués ci-dessus, des questions d’agencement de l’espace et de délimitation se posent. «Créer un jardin, c’est établir une partition dans l’espace: un dedans au sein d’un dehors» note Jean-Pierre Le Dantec dans son essai consacré à la notion de clôture, condition même du jardin (2011: 29). Le jardin est vu dans L’Arbre-Monde comme l’ancrage géographique de l’histoire intime des personnages. L’arbre, implanté dans le jardin familial ou dans l’environnement proche de chaque protagoniste et créé par l’écrivain-jardinier, devient une porte vers le monde extérieur. Par sa représentation, un franchissement s’opère. Le châtaigner de Nicholas Hoel, trace de l’histoire familiale et canevas de son parcours artistique, illustre l’idée de ce «dedans au sein d’un dehors». D’abord composante du jardin, d’un espace clos rattaché au passé des Hoel, la figure de l’arbre devient la source d’inspiration et le pilier fondateur de l’engagement artistique du personnage dans le monde extérieur, au dehors. La flamme créatrice, allumée par un «projet photo transgénérationnel» (Powers, 2018: 29), «des photos en noir et blanc, prises image par image, du châtaigner qu’avait planté son arrière-arrière-arrière-grand-père gitan-norvégien, cent vingt ans plus tôt» (31), ne cessera de grandir et poussera Nicholas Hoel vers un activisme déterminé. La multiplication des images, telle que considérée par Gaston Bachelard, complète alors cette vision et rejoint l’exemple choisi. En effet, dans notre lecture, la multiplication des images artistiques entrouvre une rêverie incarnée par la figure de l’arbre-seuil, et «aide le poète à sensibiliser le monde prochain, à affiner les symboles de la vie courante» (Bachelard, 1957: 250).
Le végétal, constamment présent, suscite une brèche, un seuil, par lesquels la nature s’infiltre et surgit. Le drame écologique transite depuis les histoires intimes vers l’histoire du monde, le mouvement des idées est en action.
L’arbre au centre de l’œuvre littéraire: méditation philosophique
La figure de l’Arbre-Monde, véritable arbre-seuil donc, endosse un rôle de relais entre la mémoire individuelle et la mémoire collective, et revêt même une position de passeur. Pour entériner cette lecture de l’œuvre et souligner les fondements scientifiques de la fiction orchestrées par Powers, nous pouvons également faire un lien avec l’essai philosophique d’Emanuele Coccia, intitulé La vie des plantes, une métaphysique du mélange. En effet, «les plantes (...) représentent la seule brèche dans l’autoréférentialité du vivant» (2016: 20) énonce l’auteur dans son prologue, avant d’ajouter que:
Les plantes sont les vrais médiateurs: elles sont les premiers yeux qui se sont posés et ouverts sur le monde, elles sont le regard qui arrive à le percevoir sous toutes ses formes. Le monde est avant tout ce que les plantes ont su en faire. Ce sont elles qui ont fait notre monde, même si le statut de ce faire est bien différent de celui de toute autre activité des vivants. (2016: 36)
L’arbre-médiateur, source d’émotions
En plaçant l’arbre au centre de l’œuvre, la brèche est ouverte, la vérité, alarmante, sur l’état du monde s’infiltre peu à peu dans les consciences.
L’urgence de réagir face à ce climat dystopique est palpable. Contrairement à Thoreau qui «présente, dans son Journal, la douceur des émotions éprouvées par les feuilles mourant de leur chute automnale» (Corbin, 170), Powers, à l’inverse, accentue la force et la dureté des émotions en pointant la violence du monde afin de mettre l’emphase sur l’extinction du vivant.
L’accent mis sur la charge émotionnelle, moteur du changement qui touche le cœur de l’humanité, confère à l’arbre une place centrale et originelle. L’arbre, source d’émotions, nous atteint en activant des réminiscences de l’enfance et du vécu familial et en endossant les figures d’interlocuteur, de vecteur d’un activisme écologique et de témoin de l’égarement dans le monde – en l’occurrence le monde urbain, le monde de la finance, le monde numérique, le monde de performance.
L’idée d’une analogie, d’un processus d’individualisation entre les espèces humaines et le végétal dans l’œuvre de Powers, méthodes de raisonnements générateurs d’émotions, est particulièrement à souligner, comme peut l’expliquer Alain Corbin:
Il s’agit, ici, d’autres émotions et d’autres sentiments: ceux qui ressortent à la conscience d’une relation occulte, d’une parenté, d’une affinité, d’une sympathie primitive, laquelle induit un désir de familiarité, d’intimité, d’harmonie voire de fusion; élan qui peut même se muer en rêve de devenir arbre, de transposition de l’humain dans l’être végétal. (2013: 179)
Abolition des frontières, expérience du vivant
C’est alors à l’expérience des personnages Olivia et Nick que nous pensons, et à leurs dix mois de vie passés en Californie en haut d’un séquoia pour protester et empêcher les abattages massifs. En partant à la rencontre de l’altérité radicale
Arbres et personnages ne font plus qu’un. Nick apprivoise cette mutation d’habitat et manière d’être-au-monde par l’art. Il observe, explore, dessine ou peint et devient son motif. Nous pouvons percevoir ici un prolongement de ce qu’Emerson pouvait traduire en ces termes et que Richard Powers glisse en incipit de son roman:
Le plus grand plaisir que délivrent les champs et les bois, c’est la suggestion d’une relation occulte entre l’homme et le végétal. Je ne suis pas seul et ignoré. Ils me saluent, et je les salue en retour. L’agitation des branches sous l’orage est nouvelle pour moi, et ancienne. Elle me prend par surprise, et pourtant ne m’est pas inconnue. Son effet est celui d’une pensée plus haute ou d’une émotion plus noble qui me saisit quand je croyais penser juste ou agir. (Emerson, 1836).
Une fois la surprise passée, les personnages de Powers vivent une réelle transformation. Les perspectives, les sensations et les mouvements ne sont plus perçus à hauteur d’homme, ils sont vécus à la dimension du végétal:
[Nick] voit ses yeux, leur céladon, ce vert en roue libre. [Olivia] surfe sur les vagues folles, souple, comme si cette tempête n’était rien. Au bout de quelques mesures, il comprend que c’est le cas. Pour un séquoia, ce n’est rien. Des milliers de tempêtes semblables ont agité ces frondaisons, des dizaines de milliers, et tout ce que Mimas a eu à faire, c’est d’y céder.
Il s’abandonne à la fureur comme cet arbre l’a fait durant un millénaire d’orages assassins. Comme Sempervirens l’a fait depuis cent quatre-vingts millions d’années. Certes, une tempête a écimé l’arbre, il y a des siècles. Certes, les tempêtes peuvent abattre des arbres aussi grands. Mais pas ce soir. Aucun risque. Ce soir, le sommet d’un séquoia est le plus sûr des abris contre ce grain. Il suffit de plier, d’accompagner.
Un hululement transperce le vent alourdi de grêle. Il hulule en retour. Leurs cris se muent en rires de déments. Ils crissent en duo jusqu’à ce que tous les cris de guerre, tous les cris de bête deviennent action de grâces. Bien après l’heure où ses poings crispés auraient capitulé, ils hululent leur plain-chant à l’orage. (2018: 318)
Au-delà de l’expérimentation, la fusion opère, des alter ego émergent. Psychologie et symbolisme de l’Homme et du végétal alimentent sans fin la création et l’analyse du récit. De l’animisme, «attitude consistant à attribuer aux choses une âme analogue à l’être humain»
L’Arbre-monde: philosophie écologique, littérature consciente
Les arbres silencieux et invisibles occupent désormais tout l’espace. Le tronc composé de récits successifs –consacrés aux différents personnages et chaque fois séparés d’un pictogramme de coupe de tronc– laisse place à la cime. Un saut de vingt ans marque l’avancée de l’humanité et ses écueils, l’étouffement et le combat de la Nature. Les récits se font plus courts et ne sont séparés que d’une interligne. Les destins se croisent et se distancient à la fois. Les personnages prennent parfois des routes séparées, d’autres fois rapprochées, dans tous les cas, la communication, le lien suggéré et formé par le végétal et les connexions microrhizales demeurent. Le vivant émerge de l’ombre, de la mort. Nous voyons ce que nous ne voyions pas, entendons ce que nous n’entendions pas. Les dénouements sont proches mais restent en suspens. Arrivent les graines:
La graine est l’espace métaphysique où la forme ne définit plus une pure apparence ou l’objet de la vision, ni le simple accident d’une substance mais d’un destin: à la fois l’horizon spécifique –mais intégral et absolu– de l’existence de tel ou tel individu, et aussi ce qui permet de comprendre son existence et tous les événements dont elle se compose comme des faits cosmiques et non purement subjectifs. (Coccia, 2016: 29)
Cette hypothèse développée par Emanuele Coccia ne peut que donner sens à la dernière partie de l’œuvre de Powers. Le discours se réduit, la fin d’un cycle et l’ouverture d’une nouvelle ère, d’une vérité, se font pressentir.
Conclusion
En proposant un cheminement impliquant des dimensions émotionnelles et philosophiques, L’Arbre-Monde éveille le lecteur et appelle à une responsabilisation de l’homme, être conscient, sur son rôle de garant du Jardin Planétaire
En se clôturant par un appel artistique lancé par Veilleur, le drame laisse la porte ouverte à l’espoir. Dans une dimension devenue cosmique à ce stade de la fiction, Richard Powers offre un espace de représentation imaginaire assez large pour que l’écofiction sème ses graines engagées et bienveillantes auprès des lecteurs. Nicholas Hoel obtient son nom d’arbre pour les qualités du végétal auquel il est associé: «observateur, témoin. Protecteur éventuel» (Powers, 2018: 236). Le romancier ne pouvait trouver arbre plus adéquat que l’amandier, arbre des veilleurs selon une symbolique biblique, pour interroger le végétal dans la littérature et transcrire une vie silencieuse, rendre lisible et visible l’invisible.
Bibliographie
Bachelard, Gaston. 1957. La poétique de l'espace. Paris : P.U.F, 224 p.
Bouvet, Rachel. 2011. « Les paysages sylvestres et la dynamique de l’altérité dans "Hélier fils des bois" de Marie Le Franc ». Voix & Images, 30, p. 21-35. <http://www.erudit.org/revue/vi/2011/v36/n3/1005121ar.html?vue=resume>.
Bouvet, Rachel. 2018 [22 novembre 2018apr. J.-C.]. « Les espaces interstitiels du végétal: le flamboyant et le sumac au seuil des habitations chez Marie NDiaye et Olivier Bleys ». Colloque «Zones, passages, habitations: les espaces contemporains à l'aune de la littérature», Bruxelles, Centre Prospéro. Langage, image, connaissance (Université Saint-Louis Bruxelles).
Clément, Gilles. 2006. La sagesse du jardinier. Paris : Jean-Claude Béhar, 109 p.
Clément, Gilles et Louisa Jones. 2006. Gilles Clément, une écologie humaniste. Genève : Aubanel, 271 p.
Coccia, Emmanuele. 2016. La vie des plantes. Paris : Payot & Rivages, 191 p.
Corbin, Alain. 2013. La douceur de l'ombre. L'arbre, source d'émotions, de l'Antiquité à nos jours. Paris : Fayard, « Fayard », 364 p.
Deleuze, Gilles et Félix Guattari. 1980. Mille plateaux. Paris : Éditions de Minuit, 645 p.
Emerson, Ralph Waldo. 1836. La Nature. Paris : Éditions Allia, 96 p.
Harrison, Robert. 1992. Forêts. Essai sur l'imaginaire occidental. Paris : Flammarion, « Champs essais ».
Le Dantec, Jean-Pierre. 2011. Poétique des jardins. Arles : Actes Sud, 182 p.
Pastoureau, Michel. 2013. Vert. Histoire d'une couleur. Paris : Éditions du Seuil, 240 p.
Pastoureau, Michel et Juliette Cerf. 2013. « Entretien: Le vert, aux origines d’une couleur rebelle ». Télérama. <https://www.telerama.fr/idees/le-vert-aux-origines-d-une-couleur-rebelle....
Powers, Richard. 2018. L'Arbre-Monde. Paris : Cherche-Midi, 550 p.
Powers, Richard et Caroline Broué. 2020. « L’invité culture: Richard Powers, réconcilier l’Homme et la nature ». France Culture. <https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-culture/richard-powers-re....
White, Kenneth. 1994. Le plateau de l'albatros. Introduction à la géopoétique. Paris : Grasset, 362 p.
White, Kenneth. 2010. Géopoétique et sciences humaines. Bruxelles : L'Atelier du héron, « Latitudes », t. 6, 50 p.
- 1. La notion de Tiers Paysage élaborée par Gilles Clément est une prolongation de ses concepts et principes de «Jardin en Mouvement», mouvement étant entendu comme «manifestation de la vie» (2006: 236) et de «Jardin Planétaire», «manière de considérer l’écologie en intégrant l’homme, le jardinier, dans le monde de ses espaces». (2006: 22)
- 2. Selon une des définitions du terme de «géopoéticien» (2010: 31) établie par Kenneth White, poète-penseur instigateur du courant géopoétique.
- 3. Le terme «monde» est ici entendu et employé comme l’entend Kenneth White, c’est-à-dire «ce qui émerge du rapport entre l’esprit et la terre». (1994: 25)