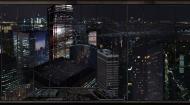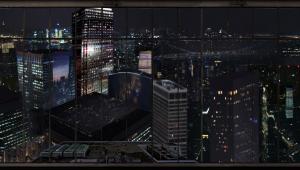OBSERVATOIRE DE L'IMAGINAIRE CONTEMPORAIN
Performances: de la «sphère globale» à l’«écume»
Pour aborder la question de la représentation du corps dans son rapport avec l’espace, j’analyserai d’une part des œuvres choisies dans les années 1960-1970 et d’autre part des œuvres postérieures à 2000, essentiellement dans le domaine de la performance, en complétant ponctuellement mon argumentaire de pratiques autres afin d’étayer mon propos. De cette approche, je déduirai l’hypothèse suivante, qui sans doute devra être amendée ou nuancée: la relation du corps à l’espace dont rendent compte ces pratiques a subi des modifications dans lesquelles je serais tentée de voir le symptôme d’un changement de la perception –de l’imaginaire– de ce qui nous entoure (personnes et espaces). Pour le dire rapidement, nous serions passés, entre les années 1960 et aujourd’hui, de la nécessité d’exposer un contact très étroit à l’autre et à notre environnement, à des modalités plus séparées et plus aléatoires. Sans entrer dans les concepts philosophiques discutés par Peter Sloterdijk sur la fin de la métaphysique, je me servirai de ses métaphores de la sphère, de la bulle et de l’écume pour traduire en images le type de représentation des rapports du corps à l’espace que j’extrairai des analyses.
Si l’on situe aujourd’hui l’origine de la performance1 dans les présentations des poèmes futuristes et les premières séances du Cabaret Voltaire, ce mode artistique ne prend véritablement son essor qu’à partir de 1959 à New York dans l’enthousiasme suscité par les premiers happenings. L’apparition de ce type de pratique, qui demande, comme au théâtre, la co-présence de corps –corps d’artistes et corps des spectateurs (les deux étant souvent interchangeables dans les premières manifestations)– dans un champ de l’art dominé par la peinture et la sculpture, me semble déclarer un besoin de la société que ce mode artistique saurait interpréter ou rappeler. Ce besoin concerne donc manifestement la place accordée au corps. C’est le corps qui ainsi se désigne à l’attention pendant une période spécifique, les années 1960-1970, alors qu’on a vu les êtres humains traités comme des animaux ou des choses dans les camps de la mort, que le souvenir et la culpabilité en sont vifs, que la reprise économique s’effectue par une consommation qui passe par la reproductibilité et l’envahissement des objets et que la mécanisation des corps issue de la taylorisation ne s’estompe pas. On l’a souvent montré depuis, l’enjeu du corps dans la performance est politique. Car ce corps est nécessairement situé –par rapport à son sexe, à sa situation sociale, aux spectateurs, aux spectatrices, par rapport à l’espace qui l’entoure. La performance est donc un bon facteur d’analyse du rapport du corps à l’espace. On peut penser que dans ce mode le corps est à ce point mis en avant qu’il ne représente rien de particulier, tant il se présente. Le terme de représentation implique qu’il y ait un décalage intrinsèque entre la personne corporelle que nous voyons et ce pour quoi elle est devant nous: le corps d’une personnalité politique, administrative, enseignante représente la république, l’Etat, l’éducation. Au théâtre, nous aimons reconnaître une actrice, un acteur, dans leur corps particulier, mais en même temps nous savons que celle-ci ou celui-ci représente: le commissaire, la jeune fille, le méchant, etc. À l’opposé de ce double jeu de la représentation, Marina Abramović affirme au journal le Guardian en 2010:
Pour être une artiste de la performance, il faut haïr le théâtre. Le théâtre est faux; il y a une boîte noire, vous payez votre ticket et vous vous asseyez dans le noir et vous voyez quelqu’un jouer la vie de quelqu’un d’autre. Le couteau n’est pas réel, le sang n’est pas réel et les émotions ne sont pas réelles. La performance, c’est exactement le contraire: le couteau est réel, le sang est réel, et les émotions sont réelles. C’est un concept très différent. C’est à propos de la vraie réalité. (Abramović citée dans Wilkinson, 2010)
Au-delà de cette affirmation qui demeure un point important, toute œuvre s’offre à la spéculation de ses spectateurs, aux interprétations qui font d’une donnée phénoménologique un éventail de significations. Ainsi les corps dans la «vraie réalité» des performances se présentent et représentent. La performance des années 1960-1970 représente l’une des façons dont la société envisage son rapport au corps en partie par l’espace qu’elle crée autour d’elle ou qu’elle qualifie. Aujourd’hui, la façon dont l’espace de la performance est géré a sensiblement changé. La performance est devenue depuis une dizaine d’années une pratique courante pour inaugurer une exposition. Elle prend quelquefois la forme de conférences. Elle est très investie par les chorégraphes et les danseurs qui renouvellent les conquêtes de la Post-modern Dance. La question du corps y demeure substantielle mais nous verrons que l’image vient glisser un filtre dans son espace.
Les années 1960-1970 et l’espace du contact
Un an avant de concevoir 18 happenings in six parts en octobre 1959, Alan Kaprow2 écrit un article, «L’héritage de Pollock» (1958), dont un passage est resté célèbre tant il énonce la transformation de la peinture en d’autres pratiques:
Pollock, comme je le vois, nous a laissés au point où nous devons nous préoccuper, et même être éblouis par l’espace et les objets de notre vie quotidienne, que ce soient nos corps, nos vêtements, les pièces où l’on vit, ou, si le besoin s’en fait sentir, par le caractère grandiose de la 42ème rue. (38-39)
Ce passage se réfère manifestement aux photographies de Pollock prises par Hans Namuth dans son atelier, et ce qui ressort du texte, c’est la valorisation de l’«environment», un terme qui devient référentiel en art au cours de ces années (Reiss, 1999). La référence pollockienne nous donne l’image de l’immersion d’un corps humain singulier (celui de l’artiste) dans cet environnement, cet espace que Kaprow fait habiter par des corps et des «objets de la vie quotidienne». Cependant c’est d’abord la référence à Cage qui transparaît dans 18 happenings in six parts, selon ce qui en a été rapporté et ce que l’on peut en deviner sur les deux seules archives photographiques. Car la réalisation s’adresse à un petit collectif, sans effet d’immersion totale des participants, même si les «happenings», réalisés dans trois petits espaces enclos par des bâches de matière plastique transparente, isolent, pour chaque «partie», quelques personnes exécutant une «partition» écrite sur un petit carton. Les «happenings» suivant de Kaprow, plus simples, laissent davantage de liberté au hasard tout en amenant les participants à se frayer du corps un chemin dans une installation de papiers et de cartons (An Apple Shrine, 1960) ou de pneus (Yard, 1961), ce qui implique un contact très étroit entre chaque individu et ce qui l’entoure. Au cours des premières années de la même décennie, le happening s’est répandu dans New York. Il demeure peu de photos de ces manifestations qui avaient une certaine spontanéité (ce qui correspond au sens de «happening», la «performance» étant davantage réglée par l’artiste, qui en est volontiers le protagoniste). Mais dans les rares images, celle d’American Moon de Robert Whitman (1960) par exemple, les spectateurs nombreux sont si serrés qu’ils se tiennent étroitement en contact. Claes Oldenburg participe aux happenings de Kaprow et crée lui aussi des événements, par exemple la série de scènes qu’il intitule Snapshots in the city (1960-61), dans laquelle il se présente tel un clochard s’abandonnant dans un ensemble bricolé de papier et de peinture. Oldenburg a rapporté plusieurs fois que ce sont ces manifestations –où les gens étaient pressés les uns contre les autres, où des tissus peints et bourrés de papier, comme La Ville à l’envers, tombaient sur le visage des gens– qui lui ont donné l’idée des sculptures molles (Walker Art Center, 2010).
Avec celles-ci, l’étroite proximité manifestement chaleureuse des happenings cède la place à une distance plus traditionnelle entre le spectateur et l’œuvre. Mais il demeure que ces sculptures offrent le plus souvent une forte tactilité et favorisent une identification entre leur qualité de volumes rembourrés et soumis à leur poids et le corps du spectateur ou de la spectatrice. En prenant de façon exagérée la forme d’objets du quotidien selon une apparence molle qui invite à y voir en même temps des corps un peu flasques ou s’affaissant, ces sculptures d’Oldenburg opèrent une contraction entre le corps humain et son environnement proche, quotidien: nourriture, arts ménagers, automobile, tous objet appelant une manipulation, voire une ingestion; un sachet de frites agrandi se renversant devient une jupe de femme, un moteur d’automobile une partie d’anatomie un peu pathétique. Ce contact si étroit qu’il est au point de compression est désormais aussi une représentation. L’environnement spatial des happenings, qui était plein du collectif des autres corps, est devenu un espace investi d’objets-corps. En d’autres termes, la représentation offerte par ce type d’œuvres est celle d’un être humain dont l’environnement d’objets déborde sur le corps au point d’y pénétrer et de le transformer.
L’approche culturelle de Yoko Ono est sans doute très distincte de celle de Kaprow ou d’Oldenburg, mais sa familiarité avec John Cage l’amène également à des démarches participatives. Dans sa performance célébrissime Cut piece, exécutée la première fois au Japon3, en 1964, ensuite au Carnegie Hall de New York, le 21 mars 1965, le corps singulier de l’artiste est central. L’espace autour d’elle doit être franchi par les spectateurs pour aller à son contact. La distance est montrée par l’invitation à la rompre, avec toutes les conséquences sociales concernant les interdits qu’implique la mise en lumière publique du contact entre individus. L’espace devient sensible: sans doute l’oublie-t-on pour se focaliser sur les pointes des ciseaux coupant le vêtement, mais cet espace de franchissement est, on n’en doute pas, intensément vécu par le spectateur décidant d’être participant. A posteriori, nous pouvons comprendre dans cet espace une valeur de représentation des conventions et des affects de la société dans ses relations aux femmes.
De l’autre côté de l’Atlantique, Beuys insiste lui aussi sur le contact entre corps et objet quotidien lorsqu’il propose, à la galerie Zwirner où Kaprow était invité à faire une conférence le 18 juillet 1963, sa fameuse chaise de graisse. Tous les Coins et Angles de graisse, comme les couvertures de feutre, affichent la nécessité de resouder le corps avec ce qui l’entoure, au moyen de protections qui traduisent de l’intimement organique ou de l’enveloppant. Les Coins de graisse représentent une jonction entre ce qui d’une part structure l’habitat humain et circonscrit l’espace de vie –les murs– et d’autre part une matière représentant la substance thermique du corps. La même année, 1965, Bruce Nauman fait une performance qu’il répète dans une vidéo de 60’ à passer en boucle. Elle se nomme Wall-Floor positions: allongé, courbé, accroupi, assis, Nauman se donne pour contrainte de trouver toutes les positions possibles où son corps touchera à la fois le sol et le mur. C’est l’artiste lui-même qui fait de son corps le véhicule des rapports espace/structure architecturale.
L’espace n’est pas un vide neutre, c’est «l’espace littéral» que partagent le regardeur et l’objet sans socle.
On peut opposer à cette hypothèse d’une volonté de contact étroit entre un corps et ce qui l’entoure –comme si l’artiste devait comprendre le monde en le vérifiant du corps, en s’y frottant– le fait qu’elle est représentée par peu d’exemples. Le Pop Art, si important alors, adopte majoritairement des formes traditionnelles. Mais le minimalisme, comme le GRAV en France, tout en utilisant au départ des ensembles assignables à la peinture et à la sculpture, empruntent assez rapidement des modes qui sont les avant-courriers de l’installation, et questionnent –c’est devenu un topos– le rapport du corps à l’espace. Il suffit de rappeler la désormais célébrissime Column de Robert Morris, parallélépipède de contre-plaqué de 240 cm x 60 cm x 60 cm refait en 1971, mais conçu en 1961, et à ce titre préfigurant de quelques années le mouvement minimaliste. En 1961, l’artiste était censé, lors d’une performance, se tenir à l’intérieur et la faire ainsi tomber au bout de 3’30. On peut saisir ici à quel point le rapport du corps de l’artiste à l’espace et à la limite qui le confine est étroit. Quelques années après, lorsque Morris présente ses différents polyèdres minimalistes qui réclament une distance de regard, il explicite ainsi ses réflexions dans ses Notes on sculpture: «Il y a deux termes distincts, la constante connue et l’expérience variable» (1966: 225); et plus loin: «une poutre posée sur son extrémité n’est pas la même que cette même poutre posée sur un de ses côtés» (225). Ainsi la colonne a-t-elle une constante de forme, mais sera interprétée différemment si le regardeur la voit à l’horizontale ou à la verticale. Dans la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty mentionne ainsi la «position» de l’objet distincte de sa «situation», et commence l’approche de l’espace par notre expérience du haut et du bas (1945: 282). Robert Morris ajoute en substance que l’expérience de l’objet s’accomplit plus efficacement avec un volume d’assez fortes dimensions. C’est ce qui entraine nécessairement un certain recul du regardeur, et fait intervenir un espace entre celui-ci et l’objet. «Cependant, précise l’artiste, c’est justement cette distance entre l’objet et le sujet qui crée une situation telle que la participation physique devient nécessaire4» (Battcock, 1995: 234-235). L’espace autour de la sculpture, souligné par les vecteurs verticaux et horizontaux, devient une zone active pour le regardeur. Il saisit les «relations» (Battcock, 1995: 235) qui, sans idée préalable à l’«expérience», s’établissent de son corps à l’objet, comme l’analyse Rosalind Krauss (Krauss, 1993: 49-54). L’espace n’est pas un vide neutre, c’est «l’espace littéral» que partagent le regardeur et l’objet sans socle. Morris s’est senti obligé d’ajouter: «Le fait que l’espace de la pièce prenne une telle importance ne veut pas dire qu’une situation environnementale est établie» (Battcock, 1995: 233). Il se défend donc contre une critique qui voit dans l’art minimal une façon d’englober le spectateur dans l’espace entre les objets spécifiques et les murs, bien que les lignes géométriques, les verticales et les horizontales, fassent écho à l’architecture de la pièce où sont exposées les œuvres. Plus tard, Morris admettra toutefois que ses polyèdres avaient été pensés en fonction de l’architecture du lieu d’exposition qui en est de fait la limite environnementale. L’activation de l’espace entre le sujet expérimentant et l’objet expérimenté a des résonances évidentes avec la Phénoménologiede Merleau Ponty, et cela vaut largement pour l’approche de la plupart des œuvres de Judd, Andre, ou Richard Serra qui favorisent une expérience où tout le corps est impliqué. Il faut rappeler au demeurant le succès qu’a eu auprès des artistes américains la traduction, en 1962, de l’ouvrage du philosophe5. Comme on sait, ce dernier oppose à «la spatialité homogène et isotrope», ou à «un éther dans lequel baigneraient les choses», un espace pensé «comme la puissance universelle de leurs connexions», «comme le système indivisible des actes de liaison qu’accomplit un esprit constituant» (Merleau-Ponty, 1945: 281-282). En regard des happenings et des exemples performatifs précédents, ce ne sont plus des objets qui touchent le corps, c’est la densité de l’espace qui vient se faire sentir comme contact. À la même époque, en 1966 précisément, Edward T. Hall publie The Hidden Dimension, traduit en français dès 1971 sous le titre La dimension cachée. Dans cet ouvrage qui a eu un succès retentissant, Hall met en lumière la notion de proxémie, dans une recherche où la culture anglo-saxonne ressort comme peu encline à une distance étroite entre les corps dans la vie quotidienne. Comme les minimalistes, il rend sensible la distance entre un corps et un autre, avec une critique impliquant la nécessité pour l’individu de repenser sa perception spatiale en société. En 1967, l’article de Michael Fried «Art et objectité» (Battcock, 1995: 116-147) dénonçait la «théâtralité» du minimalisme, car l’auteur y saisissait précisément une «présence» dans un espace, et non une pure abstraction. À travers ces différents points, nous pouvons déduire qu’une représentation plus tangible, quasi substantielle, de l’espace autour des corps se fait jour. Merleau-Ponty propose une réflexion générale sur l’homme et sa perception de ce qui l’entoure; Hall montre le malaise du contact, et les œuvres si connues des minimalistes ou de Beuys induisent que la représentation du corps à l’espace est tributaire des structures architecturales, horizontales, verticales, et que celles-ci sont omniprésentes, protectrices ou contraignantes, voire oppressantes. La liberté que procure ensuite le land art s’avère en ce sens une respiration (mais implique également un type de contact, environnemental, que nous ne développerons pas ici).
L’extérieur est à l’intérieur
C’est peut-être Lygia Clark, qui, au Brésil et en partie en France, a réalisé le plus grand écart entre une peinture géométrique accrochée au mur, c’est-à-dire pour regardeur (bien qu’elle l’ait pensé très vite en termes de perception sensorielle globale) et une œuvre tactile requérant donc de la part de l’ex-spectateur une participation de son corps. Dès la série des Bichos, en 1962, Lygia Clark fait appel au contact physique de la part du spectateur, et les œuvres suivantes ne font qu’accentuer le rapport participatif; ainsi ses actions performatives sont-elles plutôt des protocoles ou des objets qu’elle expérimente ou fait expérimenter. Pour résumer, ses œuvres opèrent une réduction de l’espace des corps entre eux, comme entre corps et objets, et ainsi que nous allons le voir, entre corps et architecture. En 1968, pour le pavillon brésilien qu’elle occupe à la Biennale de Venise, l’artiste crée A casa e o corpo, [la Maison est le corps], une installation participative architecturée, composée de plusieurs structures géométriques accolées, comportant chacune des éléments différents tels que des ballons ou des tendeurs de caoutchouc ou de peluche, exigeant des visiteurs qu’ils se forcent un passage à travers eux.
Le sous-titre donne une représentation à l’expérience éventuellement angoissante que fait le visiteur lorsque, par exemple, il peine à traverser, dans le noir complet, une structure totalement remplie de ballons gonflés: «Pénétration, ovulation, germination, expulsion». Ce titre nous indique le désir de l’artiste de faire naître le visiteur à ses sensations physiques comme s’il revivait son propre enfantement. En dehors de cette signification précisée, il apparaît que l’œuvre là encore désigne –lorsqu’on la traverse– la quasi disparition d’un espace intermédiaire entre corps et architecture (la maison est le corps), avec effet oppressant (mais aussi ludique).
La même année, 1968, Günter Brus s’entaille la peau, une action qui peut s’interpréter comme la désignation de la limite sensible et douloureuse entre l’intérieur de l’individu et l’espace extérieur. Comme les autres actionnistes viennois, Brus a été marqué par les photographies de Pollock par Namuth (Loers et Schwarz, 1988: 126). Auparavant, en 1964, il a réalisé l’Aktion Ana (du nom de sa compagne) pour laquelle il avait peint totalement la pièce dans laquelle il intervenait ensuite au moyen d’une gestuelle expressionniste, mêlant son corps à la peinture. L’année suivante il réitérait le processus dans un atelier prêté par un autre artiste. Il peint alors en blanc tout l’espace y compris sa tête (Selbstbemalung,1965); il ajoute sur celle-ci une ligne noire qu’il prolonge jusqu’à son avant-bras. Il établit donc le contact entre son corps et ce qui l’entoure par l’union qu’en opère la peinture. Ce geste préfigure Wiener Spaziergang [promenade viennoise], la sortie de Brus dans l’espace de la ville, le 6 juillet 1965. L’artiste est alors totalement peint en blanc à l’exception d’une ligne noire qui le scinde du sommet du crâne jusqu’au bout du pied droit, comme si son corps se fendait. L’espace du dedans plein de l’intériorisation des pressions qui se concentrent dans l’individu transperce la limite du corps jusqu’à l’espace public. C’est cette ouverture du corps sur l’espace du dehors qui déborde au cours de la 30ème action, intitulée Der helle Wannsinn –Die Architektur des hellen Wannsinns [Folie Totale –Architecture de la folie totale]6 par plusieurs passages vers l’extérieur, puisque l’artiste pisse, défèque et fend sa peau à l’aide d’une lame de rasoir.
Ainsi la peau devient-elle le lieu d’incidence entre l’espace extérieur, chargé des contraintes sociales qui forcent les individus à les intérioriser, et l’espace ressenti du corps. C’est le sens que donne Gina Pane à ses actions lorsqu’elle-même «ouvre» son corps peu après à la lame de rasoir. Dans Blessure théorique, en février 1970, elle utilise la lame pour fendre un papier, puis un tissu, puis son doigt: elle démontre sur trois photographies du geste la limite sensible entre deux espaces, qui devient sur la troisième image celle de l’extérieur et de l’intérieur de son corps. Et si la blessure est une ouverture à l’«Autre» humain et non à l’espace, les actions qui désignent le corps de l’artiste comme le lieu de contact privilégié à l’espace naturel ou architectural ne manquent pas. Ainsi, en 1972, à Bruges, pour l’action Je, c’est son corps d’artiste qui devient la jointure entre deux espaces. Pane reste deux heures et demie accrochée au parapet d’une fenêtre au deuxième étage d’une maison, désignant ainsi la limite entre l’espace public de la rue et l’espace privé comme un lieu de contact sensible à l’abri mais ouvert au danger.
D’autres exemples pris chez Acconci ou chez Marina Abramović montreraient également la limite de la peau comme le lieu de contact du moi avec l’espace du dehors, chargé de pressions sociales. C’est aussi l’époque où le matériel vidéo devient accessible à plusieurs artistes. Au départ l’instrument, un peu lourd, fait découvrir à ceux-ci de nouvelles relations au corps qui garde une proximité imposée par le renvoi de l’image au moniteur avec une qualité presque tactile. Cette relation de découverte associant des corps à un espace restreint est bien exemplifiée par l’œuvre de Dan Graham Body Press (1972): dans un cylindre fermé et doublé à l’intérieur d’un miroir se côtoient un homme et une femme nus tenant chacun une caméra; ils filment en spirale de haut en bas et de bas en haut leur corps. Les dimensions du cylindre ne sont pas précisées, mais les documents d’origine montrent que les deux corps n’ont qu’un peu d’espace pour leurs mouvements. Le titre est au demeurant explicite du travail très rapproché de la caméra, quasi au contact de la peau. À la même époque, Peter Campus de son côté montrait des croisements et va-et-vient depuis la caméra, le visage ou le corps, et l’image du corps projeté sur un écran. Lors de son exposition rétrospective du 13 février au 28 mai 2017 au Musée du Jeu de Paume à Paris, on pouvait lire des extraits d’entretiens de l’artiste. L’un résumait son expérience du rapport étroit corps/espace architecturé. Mais un autre texte témoignait de la modification qui va s’opérer à partir de la fin des années 1970. «Quand j’étais jeune» dit-il dans le premier texte, «je me suis moi-même fait prisonnier de ma chambre. Elle est devenue une partie de moi, une extension de mon être. Ses murs étaient ma coquille. En tant que contenant la chambre est apparentée à l’espace imaginaire qui est enclos dans le moniteur.» L’autre citation est datée de 1978: «Le grand changement dans mon esthétique est opéré à partir du moment où j’ai cessé de regarder “l’intérieur” pour tourner mon regard vers “l’extérieur”».
Vers une autre représentation du rapport du corps à l’espace
Ce regard de Peter Campus, tourné vers «l’extérieur» n’est pas celui du land art, cette recherche du contact avec l’espace de la nature, antithèse du monde quadrillé et géométrisé. Il témoigne ici d’un changement que l’artiste ne précise pas davantage. Il est opéré par un individu singulier, mais concomitant d’un autre changement, progressif sans doute, qui voit la fin de toutes les transformations artistiques qui s’étaient succédées depuis 1960. À la même époque, Vito Acconci ou Gina Pane abandonnent la performance. Au cours des années 1980 cette forme, quoiqu’encore pratiquée notoirement par Marina Abramović et Ulay, perd de son importance. Les interventions de Laurie Anderson deviennent des spectacles. Les «néo-avant-gardes» des années 1960-70 cèdent la place au retour de la peinture et de la sculpture, où à quelques installations remarquables (Buren, Gary Hill, Bill Viola). Les performances reviennent au cours des années 1990, en même temps qu’un art participatif qui s’en distingue (l’art relationnel). Elles se développent surtout depuis une dizaine d’années, le plus souvent par des artistes qui ont d’autres pratiques: installation, dessin... La performance participe de la séduction opérée auprès des collectionneurs présents ou en puissance le jour du vernissage d’une exposition. Elle s’est banalisée mais peu d’artistes en font leur domaine principal, mis à part les chorégraphes qui investissent ainsi le champ des arts plastiques en renouvelant et leur pratique et la place faite au corps.
Autrement dit, l’image médiatique s’est interposée ou imposée entre le corps de l’artiste et quelque chose qui n’est peut-être plus de l’espace (plus le même).
Parmi les non-chorégraphes, Marina Abramović a conquis une notoriété sans commune mesure avec son statut précédent pourtant déjà bien établi. Si l’on en croit Jean-Pierre Cometti dans La nouvelle aura, «l’importance de l’image s’est accrue avec le développement des pratiques qui, comme la performance, sont subordonnées à une expérience temporelle […]. La photographie ou la vidéo ont [alors] acquis un rôle qui […] participe étroitement à la relation particulière de l’artiste performeur à son public et à son succès, comme le cas de Marina Abramovićen témoigne» (Cometti, 2016: 166). Autrement dit, l’image médiatique s’est interposée ou imposée entre le corps de l’artiste et quelque chose qui n’est peut-être plus de l’espace (plus le même). Abramović au demeurant a acquis grâce à ces médias une maîtrise exceptionnelle de son image. Privilégiant la vue frontale ou un profil exact et une simplicité unitaire du vêtement, elle laisse accompagner son image de quelques lignes narratives (lisibles sur plusieurs sites internet) qui accrochent l’attention: «Marina est restée 700 heures…, elle a pleuré en voyant Ulay… Elle a fait de sa personne corporelle une icône…» Avec The artist is present, en 2010, elle a réussi à proposer un corps sanctifié non pas à la façon dont l’animal, substitut du corps humain pour Hermann Nitsch, est censé délivrer des interdits par son sacrifice, mais plein de l’aura de celle qui a traversé des épreuves et qui pratique une règle de vie quasi inaccessible au commun. Elle assume ainsi une forme de thaumaturgie spirituelle auprès de son public, comme l’assurent de nombreux témoignages.
Le succès retentissant de The Artist is present inscrit cette performance comme révélatrice d’une certaine forme de rapport entre corps et espace. L’artiste est sur une chaise à une distance calculée d’une table carrée de l’autre côté de laquelle vient se placer, à la même distance, tour à tour, une personne sur qui l’artiste, très concentrée, fixe son regard. À l’exception notoire d’Ulay auquel elle tend les mains, Marina Abramović est immobile et la rencontre est visuelle, de regard à regard. L’artiste parvient à isoler la personne qui lui fait face par sa concentration, alors même que le public nombreux, plutôt bruyant, est maintenu hors du périmètre central par un câble peu visible et, on le présume, des gardiens attentifs. La performance établit donc la puissance du regard comme suffisante. La présence du corps de l’artiste atteste de sa vérité, mais il garde sa distance d’image. Il en est ainsi des médias numériques qui dressent entre corps et image un espace d’intouchabilité tandis que l’écran n’offre qu’une lisse uniformisation de l’expérience du contact.
Peu d’artistes aujourd’hui se dédient uniquement à la performance. Abraham Poincheval, pour qui elle est pourtant centrale, montre ses dessins préparatoires ou fait fabriquer des dispositifs qui sont à la fois des sculptures et des témoins de performances. Au cours de l’année 2017, du 3 février au 8 mai, il les expose au Palais de Tokyo à Paris et inscrit deux performances pendant ce laps de temps. La plus frappante renoue apparemment avec les actions les plus dures des années 1970. Elle s’intitule Pierre. Une grande masse de calcaire taillé est présentée avant et après la performance ouverte en deux parties, au milieu desquelles est creusée la silhouette assise de l’artiste, avec la place pour ses bras, ainsi qu’un peu d’espace permettant la présence de matériel de survie. Du 22 février au 1er mars 2017, soit pendant une semaine complète, la pierre est refermée sur l’artiste. Il s’agissait d’un défi éprouvant, bien qu’Abraham Poincheval ait auparavant accompli plusieurs fois des démarches d’isolement dans des contextes beaucoup moins médiatisés7.
Ce type de défi consistant à demeurer enfermé dans une pierre a été opéré antérieurement, en 1978, par un artiste allemand, Timm Ulrichs, pendant 10 heures, dans une démarche que nous rattacherons aux années 1960-1970. La photographie diffusée qui en témoigne montre une pierre ouverte au milieu de laquelle Ulrichs est allongé en position mi-fœtale, tandis que le couvercle semble taillé de façon à épouser étroitement son corps. La photographie suggère une immersion, celle du corps dans la pierre, celle de la pierre dans la nature (les spectateurs ne sont pas visibles). L’ensemble évoque le nid autant que la fossilisation du vivant. Dans le cadre du Palais de Tokyo, en 2017, la pierre est devenue un artefact indépendant de la nature, et en cela elle ne fait que signaler à quel point le naturel est devenu pour nous de l’artefact. Elle est une sculpture dans une institution. Close, elle sépare l’artiste des spectateurs, sans manifester explicitement une immersion de celui-là avec la pierre même si Abraham Poincheval souhaite «épouser son temps minéral». La performance mène vers autre chose: elle signale d’une part un désir de se tenir hors du bruit et des images du monde, cet ensemble qui réduit considérablement aujourd’hui nos capacités d’attention et de concentration, comme l’a si bien analysé Jonathan Crary (2014). Abraham Poincheval se met ainsi temporairement hors de l’espace partagé, y compris celui des ondes de transmission opérant 24 h/24. Mais en même temps, la performance ne cache en rien à quel point nos conditions humaines occidentales actuelles modifient toute expérience. Elle le souligne. Car comme un cosmonaute ou bien un spéléologue isolé pour des raisons scientifiques, l’artiste dispose d’un ensemble d’aménagements conçus pour de telles séquences8 (nourriture spécifique, toilettes, etc.) et il est suivi médicalement. Surtout, une caméra infra-rouge est sans cesse branchée sur lui: la proximité de l’autre par regard mais sans contact ne fait jamais relâche. Son intimité, son espace privé est considérablement aminci, possible seulement pendant une partie des heures de fermeture du lieu. Lorsqu’à la fin l’artiste sort de la pierre, un service médical le soutient mais il est bien sûr tenu à distance du public. Plus tard, après un assez long repos, Poincheval commence la deuxième performance prévue pour l’exposition: il passe alors plus de 21 jours à couver des œufs dont beaucoup vont éclore. Comme précédemment, il lui est possible d’entendre le public mais il est séparé de celui-ci, car pour maintenir la température, il reste dans un vivarium, une grande cage de verre, à la vue de tous mais sans contact. Un sas spatial l’isole, sous le regard d’autrui.
Corps et chorégraphie
Au contraire des performances particulièrement immobiles que nous venons d’aborder, les chorégraphes pensent le déplacement dans et avec l’espace. En cela ils vont à l’encontre du statisme requis par la pratique des selfies, la consultation d’internet, le travail à l’ordinateur. Les chorégraphes sont sans doute aujourd’hui les artistes les plus enclins à revendiquer la performance, et dans un sens nouveau, qui ne cherche plus à tester les limites physiques du corps en vue d’une approche phénoménologique de celui-ci et de l’espace immédiat. Un certain nombre de ces performances opérées par des danseurs, des danseuses ou des chorégraphes impriment, malgré la reprise de gestes n’exhibant aucune virtuosité, une distance par rapport au public par le fait même que ces artistes ont une formation physique supérieure au spectateur ordinaire. Certes, plusieurs chorégraphes choisissent de montrer des corps non préparés à la danse, ou de pratique amateur ou bien encore mêlent tous les âges et tous les genres, un impensable de la danse classique. C’est le cas en particulier de Jérôme Bel dans Gala (2015) qui reprend d’une certaine façon, en choisissant des «chorégraphes et des danseurs qui ne sont pas identifiés», ce qu’avait inauguré Pina Bausch. Ne pouvant lui-même travailler avec ces personnes qui «ne sont pas des outils performants», il laisse leur subjectivité et leur imaginaire s’exprimer (Hofman, 2015). Dans Gala, les hommes et les femmes se présentent individuellement ou ensemble dans ce qui seraient les dernières minutes d’un spectacle, avec leur désir intense d’accomplir une pirouette impeccable, leur grâce maladroite à la réaliser, leur fragilité. Mais si le New York Times écrit que cela «suggère que le théâtre est une communauté, sur scène et en coulisses4» (Burke, 2016), il est patent que cette «communauté» est celle de désirs qui se rejoignent, mais non celle manifestée par le contact des corps: un tel contact paraîtrait au demeurant obsolète. C’est qu’un tel désir de rapprochement collectif intime s’est socialement défait. Bel l’a montré tout particulièrement en 2001 avec Show must go on, un spectacle où chacun des 20 participants est isolé par ses écouteurs et chante ou danse individuellement sur une musique populaire récente. Dans Gala, l’isolement est moins patent, parce que les imaginaires de chaque protagoniste montrent une proximité entre les rêves de danse de chacun, mais chaque «amateur» vient bien faire son spectacle individuellement. En montrant des rapprochements d’imaginaire, celui des amateurs de la danse, Bel fait apparaître une communauté de petites «sphères» qui, sans le spectacle, ne «transfèrent» pas nécessairement leurs affects les unes vers les autres, ou n’en sont pas conscientes. Les communautés existent, elles sont faites de corps fragiles et touchants se constituant en «écumes», en rassemblements de bulles individuelles qui s’agrègent et se défont –pour reprendre le vocabulaire employé par Peter Sloterdijk (2005: 19-20, 724)9.
Tino Sehgal a été l’un des danseurs de Jérôme Bel et de Xavier Le Roy, et comme on sait, il est l’un des représentants les plus connus de formes performatives récentes. À la façon des chorégraphes, il propose des mises en scène, et, s’il ne choisit pas nécessairement des professionnels de la danse ou du théâtre, il prend un soin particulier pour le casting de ses protagonistes. D’autant plus que certains d’entre eux s’adresseront directement au public à partir de leur propre expérience ou de leurs propres désirs de communication. Avec Kissen 2002, qui est la reprise, au musée, de baisers artistiques célèbres (Rodin, Brancusi…) par des couples vivants, Sehgal avait montré que la fusion physique du baiser fabrique une bulle tenant à distance les spectateurs amusés ou légèrement gênés. Les scénographies les plus récentes, dont celles, en partie rétrospectives, qui se sont déroulées au Palais de Tokyo à Paris entre le 12 octobre et le 18 décembre 2016, semblent avoir pour but de rétablir un contact à travers le langage. Comme chez les minimalistes, Sehgal prend en compte l’espace. Ainsi, l’étage inférieur du Palais de Tokyo était totalement vidé de cimaises de sorte que la structure architecturale baignée de lumière se lise d’emblée. Cette structure faisait surgir la figure de la «serre», pour reprendre un autre terme utilisé par Sloterdijk pour donner l’image de l’espace climatisé et immunitaire que prône et construit autour d’elle la société humaine, et que représente métaphoriquement ici le musée d’art contemporain (Sloterdijk, 2006). Ce qui était troublant pour le spectateur, c’était de se promener dans ce vaste espace sans savoir qui était le public ou qui était acteur. À un signal souvent inaperçu, une partie des personnes occupant le lieu se mettait en mouvement, ou bien un chant s’élevait, tandis que l’on comprenait soudain que l’autre, à côté de soi, était engagé dans une activité que l’on ne pouvait partager. Les circulations d’un groupe de protagonistes levaient des images furtives et des bribes de narration, comme si l’on était dans une séance de répétition d’un film, sans le costume ni le décor final. Lorsque par exemple se précisait l’avancée silencieuse et lente d’une trentaine de personnes, des réminiscences du film La Nuit des morts-vivants pouvaient flotter à la mémoire des spectateurs. Les protagonistes reculant à un autre moment et c’est un rembobinage de film qui apparaissait. Une personne vient vous parler, vous entamez une conversation presque intime, et soudain votre interlocuteur disparaît, s’évanouissant dans la foule des autres spectateurs en vous laissant frustré d’une discussion interrompue. Il n’y a pas de centre, mais des mouvements dont on s’aperçoit après coup qu’ils sont organisés. Attiré.e par des chants, vous vous dirigez vers un espace dissimulé, et vous êtes alors si totalement dans le noir que vous cherchez le contact d’une main amie. Le lieu devient une grotte ancienne où des chants rituels restituent une atmosphère tribale, tandis que peu à peu cet espace ancestral retrouvé se mue en night-club, qui s’en déclare la continuité. Dans tous les cas, les espaces se modifient en prenant des tonalités différentes selon l’action insensiblement narrative et conjuguée des performeurs. Dans ces espaces, des écumes se rassemblent et se dissolvent.
Conclusions
Ces quelques exemples artistiques, pris dans les années 1960-1970 puis dans les années 2000, ne peuvent bien entendu être conclusifs sur le type de représentation que la société occidentale se fait du rapport entre corps et espace. Nous avons seulement voulu suggérer que cette représentation, accompagnée de ses désirs et de ses manifestations, s’était modifiée entre ces deux périodes a priori peu éloignées. Le choix d’œuvres très connues des années 1960, dont on peut donc supposer que leur réception est due à un partage sensible, montre l’insistance d’une recherche de contact qui supprimerait l’espace intermédiaire entre les corps, ou bien ferait de l’espace une substance tangible (on aurait pu ajouter des exemples pris dans la Post-Modern Dance, tel Huddle de Simone Forti en 1961). La constante du contact suggère une forme d’urgence à cet égard qui correspond sociologiquement à un moment d’émancipation des corps en Occident. Nous avons vu aussi que ces contacts impliquaient la pression ou la prise de connaissance des objets et de l’architecture. L’espace est plein: des autres corps, de la matérialité de l’air, de nos productions envahissantes. D’une façon générale, par rapport aux exemples des années 2000-2010, les œuvres supposent une universalité de leur propos: si l’on accepte la valeur représentative des images utilisées par Sloterdijk, le contact désigné entre corps et environnement manifeste une continuité qui englobe le moi et le tout. Il s’agirait d’une conception totalisante, matérielle (les corps, les objets, la matière de l’air), insistante peut-être parce qu’elle est sur le point de se dissoudre. Au contraire Abraham Poincheval, et même Abramović, tout en indiquant une proximité entre leur corps et ce qui les entoure, instaurent des distances, des écrans, forment des bulles d’attraction à l’intérieur de la «super-installation» qu’est l’expanded museum (Sloterdijk, 2005: 720), métaphore spatiale du monde. Jérôme Bel comme Tino Sehgal en revanche montrent l’éventail de communautés qui se côtoient. Leur mouvement est celui d’une infinité de bulles, une écume d’espaces individuels capables de s’agréger à d’autres, d’amorcer des communications, mais aussi de se diluer.
Bibliographie
Battcock, Gregory. 1995. Minimal Art, A critical Anthology. Berkeley : University of California Press, 454 p.
Brouwer, Marianne, Markus Müller et Thierry de Duve. 2001. Graham Dan, œuvres 1965-2000. Paris : Paris-Musées, 419 p.
Burke, Siobhan. 2016 [18 octobre 2016apr. J.-C.]. « An Experimental Choreographer Who Isn’t Afraid of Failure ». The New York Times. <https://www.nytimes.com/2016/10/19/arts/dance/jerome-bell-crossing-the-l....
Cometti, Jean-Pierre. 2016. La nouvelle aura. Économies de l’art et de la culture. Paris : Questions théoriques, 248 p.
Crary, Jonathan. 2014. 24/7 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7: le capitalisme à l'assaut du sommeil. Paris : La Découverte, 144 p.
Hall, Edward T. 1971. La dimension cachée. Paris : Seuil, 256 p.
Hofman, Pierre-Philippe (réal.). 2015. Gala / Jérôme Bel / Kunstenfestivaldesarts 2015. Bruxelles : Kunstenfestivaldesarts, vidéo youtube, 2.43 min min. <https://www.youtube.com/watch?v=OOGyT5mkn38>.
Kaprow, Allan. 1996. « L’héritage de Pollock », dans Jeff Kelley et Donguy, Jacques (dir.), L’art et la vie confondus. Paris : Éditions du Centre Pompidou, p. 38-39.
Krauss, Rosalind. 1993. « Sens et sensibilité. Réflexions sur la sculpture de la fin des années soixante », dans Jean-Pierre Criqui (dir.), L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes. Paris : Macula, p. 31-59.
Loers, Veit et Dieter Schwarz. 1988. Von der Aktionmalerei zum Aktionnismus: Wien 1960-1965. Klagenfurt : Ritter Verlag, 358 p.
Merleau-Ponty, Maurice. 1945. Phénoménologie de la perception. Paris : Gallimard, 537 p.
Morris, Robert. 1966. « Notes on Sculpture, part II », dans Robert Morris. Paris : Éditions du Centre Pompidou, p. 225.
Palais de Tokyo,. 2017. « Abraham Poincheval ». Site officiel du Palais de Tokyo, 4 juin 2019. <https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement2/abraham-poincheval>.
Reiss, Julie H. 1999. From Margin to Center. The Spaces of Installation Art. Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 182 p.
Sloterdijk, Peter. 2011. Bulles. Sphères 1. Paris : Hachette Littératures.
Sloterdijk, Peter. 2011. Globes. Sphères II. Paris : Hachette Littératures.
Sloterdijk, Peter. 2005. Sphères - Tome 3, Ecumes, Sphérologie plurielle. Paris : Hachette littérature, 785 p.
Sloterdijk, Peter. 2006. Le Palais de Cristal. A l’intérieur du capitalisme planétaire. Paris : Libella Maren Sell, 384 p.
Walker Art Center, (réal.). 2010. Upside Down City (1962) by Claes Oldenburg. Minneapolis : Walker Art Center, vidéo youtube, 3.34 min min. <https://walkerart.org/magazine/upside-down-city>.
Wilkinson, Chris. 2010 [20 juillet 2010apr. J.-C.]. « Noises off: What's the difference between performance art and theatre? ». The Guardian. <https://www.theguardian.com/stage/theatreblog/2010/jul/20/noises-off-per....
- 1. J’utilise ici le terme de performance dans son sens artistique le plus général. Ses diverses formes –happening, action, art-action– seront spécifiées selon les exemples choisis.
- 2. Kaprow avait été l’élève de John Dewey, et avait suivi les cours de John Cage à la New School for Social Research.
- 3. Au Yamaichi Concert Hall de Kyoto puis au Sogetsu Art Center de Tokyo en août 1964.
- 4. a. b. Ma traduction.
- 5. «Tous les artistes lisaient Merleau-Ponty» est-il écrit dans la «biographie en bande dessinée de Fumihiro Nonomura et Ken Tanimoto de Dan Graham», (Brouwer, 2001: 388).
- 6. Elle se déroule au Reiff Museum d’Aix-la -Chapelle, le 6 février 1968.
- 7. Il a notamment passé une semaine dans un trou creusé dans le sol d’une librairie à Marseille: 604800‘ en 2012 et refait cette retraite à Tours sous le sol de la place de la Mairie, en 2013. En 2014, il est resté 13 jours dans un ours empaillé au Musée de la Chasse à Paris.
- 8. «Une lampe frontale, de l’eau, de la nourriture en brique, un peu de lecture, un téléphone de secours, pas de montre. Un conduit d’aération assure la bonne oxygénation de l’espace et une boîte hermétique sert de toilettes. Abraham Poincheval n’a aucune intimité car il est filmé 24 heures sur 24. Le public peut regarder ses faits et gestes, limités, via un écran situé à côté du roc. Les visiteurs peuvent également lui parler mais l’artiste n’est pas vraiment certain de tout entendre.» (Poincheval, 2017).
- 9. Dans cet article, la référence exacte à l'ouvrage est: Sloterdijk, Peter. 2005. Sphères III. Ecumes, sphérologie plurielle, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni. Paris : Maren Sell Editeurs, 790 p.