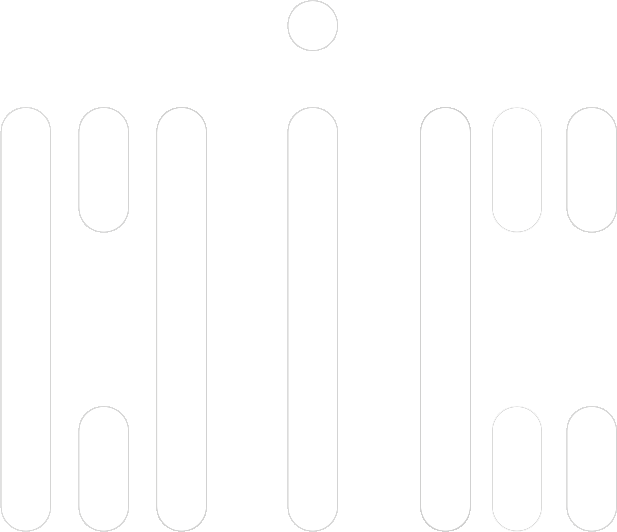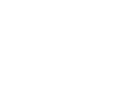La vie secrète des événements
Auteur·e·s:
1- Une rue, la nuit
Nous marchions sur Sainte-Catherine, Vincent et moi, en route vers le Comptoir 21 qui sert les meilleurs fish and chips en ville, du moins de ce côté-ci de Saint-Laurent. Il faisait froid, très froid, sous les vingt degrés, avec un vent du nord-ouest, de ces vents d’hiver qu’il ne sert à rien de combattre. On s’emmitoufle, foulard noué autour du cou, tuque enfoncée jusqu’aux sourcils, et on marche les yeux baissés.
On s’était donné rendez-vous par texto quelques minutes plus tôt: Lunches-tu? Je suis à l’uni, je mangerais bien un fish and chips. / Je suis en rendez-vous. / Allo? / Allo! / Tu viens manger? / Ok. Je descends te chercher dans 5 min. / On se retrouve à la sortie Sainte-Catherine et Berri. / Ok à 12h55, je passe au p’tit coin et je descends.
On marchait vers Amherst. Je voulais le taquiner sur sa nouvelle voiture, dont il devait prendre possession dans une semaine. Attends, m’a-t-il dit, il faut que je te raconte! Hier soir, il devait être une heure moins quart, on dormait pas encore. On était au lit et on entend un bruit, plus qu’un bruit, une série de chocs. Puis, ça se met crier. Je me lève. Par la porte, je vois une voiture en plein milieu de la rue, mais de travers. À 90 degrés. Je mets mon manteau et je sors. Une femme crie, un homme s'extrait de la voiture et s’enfuit. Comme ça. Sa voiture bloque la rue et sa portière est ouverte. On est en pleine pente entre Sherbrooke et Hochelaga, la voiture peut pas rester là. Je m’approche. Le moteur tourne toujours et tout le devant, côté passager, est démoli. Je regarde autour, et merde!, c'est un hit and run. Il a dû frapper quatre ou cinq voitures stationnées. Il y en a une dont tout le côté est tordu. De la ferraille. Les autres sont guère mieux. Les policiers arrivent. Je finis par comprendre que le conducteur avait fait un accident sur Sherbrooke et pris la première rue pour s’enfuir. Comme il conduisait une auto volée, il ne pouvait pas rester sur les lieux, alors il a pris notre rue dans le sens contraire, puis il a perdu le contrôle de son véhicule qui a frappé des voitures stationnées. Je suis sorti au moment où il retrouvait ses esprits, la femme devait avoir vu la scène en rentrant à la maison, elle a tenté de l’interpeller, il s’est montré violent avant de prendre la fuite. Et le plus incroyable, c’est que ma voiture était juste là. Il a frappé celles qui étaient en avant et d’autres qui se trouvaient derrière, mais il n’a pas touché à la mienne. Ou à peine, une légère égratignure au pare-choc et c’est tout. Tu te rends compte, les chances? Rien. Les autres sont bonnes pour des réparations majeures et la mienne en est sortie miraculeusement indemne. Je viens juste de la vendre pour acheter la nouvelle. J’ai été vraiment chanceux.
Le hasard, le chaos, les lois de la complexité. Je venais de relire pour mon cours au bac Vente à la criée du Lot 49 de Thomas Pynchon, et j’avais encore en tête l’étonnante scène qui se déroule dans le hall de l’hôtel où Œdipa, l’héroïne, descend vers la fin du roman. C’est une convention de sourds-muets. Rien que ça. Quand elle revient à l’hôtel après vingt-quatre heures d’errance dans la baie de San Francisco, une proto-déambulation géopoétique où les hasards n’ont cessé de se multiplier, les sourds-muets dansent dans la salle de banquet, les uns le charleston, les autres le rock & roll, la bossa nova, une valse, sans jamais jamais se toucher. Ils n’entendent rien, dansent dans le désordre et, pourtant, ils réussissent à s’éviter. Un sourd-muet entraîne même Œdipa dans sa danse et elle assiste médusée au spectacle des corps qui virevoltent et se désarticulent sans se frapper. Sans jamais se frapper.
Ce que Vincent venait de me raconter était, de la même façon, un bel exemple de la vie secrète des événements. Quand on laisse aller le monde, au lieu de tenter de le contrôler, on assiste parfois à des spectacles inattendus, des micro-événements qui semblent montés à notre intention, des sourds-muets qui circulent comme des électrons, des voitures qui ressortent indemnes d’un accident, des portes qui se mettent à se répondre. C’est là où je voulais en venir. Les portes. Le jeu des portes qui se complètent au-delà de leur proximité. J’ai écouté Vincent me raconter son anecdote et je suis allé vivre la mienne. Rien d’important. Pas de tôle froissée ou de sang versé, un événement de rien du tout, à l’image de la vie elle-même.
2- Les portes
On a mangé notre fish and chips au comptoir. Les plats étaient servis dans des paniers en plastique recouverts d’un papier ciré à damier vert et blanc, comme dans mon enfance. On a vidé nos assiettes en discutant de tout et de rien.
Vincent devait partir, une réunion l’attendait, je suis resté quelques instants de plus, à boire mon café. Le resto était désert. La serveuse faisait sa caisse, le cuisinier nettoyait ses grilles. J’ai commandé une cheesecake framboise et chocolat. C’était lourd, mais réconfortant. J’ai sorti mon iPad et, comme je le fais souvent avant de partir en déambulation, je me suis mis à écrire, histoire de me rendre disponible, de m’ouvrir à l’espace et au musement. C’est une des étapes de ma préparation à une sortie, je médite sur mes projets d’écriture, sur mes propres modalités d’insertion dans un lieu que je ne connais guère.
"Une étrange géographie imaginaire, ai-je écrit, se déploie au fur et à mesure que je flâne dans Hochelaga. Sous les rues du quartier, à la manière d’un palimpseste, se profilent les rues d'un autre quartier, Centre-Sud. Je n’y ai jamais habité, mais c'était le quartier de mon père, lorsqu'il était enfant et il a continué à le fréquenter parce son commerce s'y trouvait, commerce hérité de son propre père, Gervais Express Limité de père en fils. Sur leurs traces, j'ai sillonné les rues de Centre-Sud dans les années 70 quand je travaillais sur les camions de la compagnie au mois de mai. Les familles sur le BS avaient le droit de déménager une fois aux cinq ans aux frais de l’état, et les gens ne se gênaient pas pour le faire. On appelait ça: "changer le mal de place". Une famille pouvait, par exemple, partir d’un troisième étage miteux sur Parthenais pour aller dans un autre troisième étage tout aussi crasseux sur Alexandre-de-Sève. Troquer Wolfe pour Montcalm, Plessis pour Panet. Passer du nord d’Ontario au sud de Sainte-Catherine. Les familles moins chanceuses étaient évincées ou perdaient au jeu de la chaise musicale et devaient laisser leurs meubles et affaires sur le trottoir, entassés pêle-mêle. Dans les camions, on parcourait le quartier à ramasser des ménages et à les déposer quelques rues plus loin. Les électroménagers étaient graisseux, les armoires, poussiéreuses, et les vêtements, jetés dans des sacs à ordure déjà déchirés. Après quelques années, je connaissais le quartier par cœur.
Déambuler maintenant dans Hochelaga, dans ce quartier qui ressemble à mon souvenir de Centre-Sud, me conduit à écraser l’un sur l’autre ces lieux, le passé et le présent, l’imaginaire et l'actuel. Je fais se croiser les lignes, celles de mes souvenirs, fantasques et associatives, celles de mes pérégrinations, impulsives et circulaires."
J’ai déposé mon iPad, payé l’addition, enfilé mon survêtement, mon manteau et mes gants et je suis sorti affronter le froid. À marcher vers l’est, j’étais chanceux, j’avais le vent dans le dos, mais le froid restait intense. J’ai quitté Centre-Sud, passant sous le pont Jacques-Cartier et j’ai pénétré dans ce no man’s land qui s’étend à ses pieds.
Mon premier moment géopoétique, mon deuxième si on compte l’anecdote de Vincent, est survenu peu de temps après, quand j’ai repéré une superbe porte bleue, finement travaillée par le temps et les intempéries. Une porte poussiéreuse, à la peinture écaillée d’un bleu légèrement délavé, qui devait donner sur un escalier sombre et étroit. J’ai toujours aimé photographier les portes, je le fais depuis des années. Je pourrais même en faire un livre, si ça n’avait été fait mille fois. J’ai sorti mon iPhone et, malgré mes doigts engourdis, j’ai pris un cliché. La photo était mal cadrée, mais le bleu ressortait bien et la vieille boîte à lettres donnait à l’ensemble un air démodé. Il était facile d’imaginer une vie derrière cette porte, des générations de locataires, de plus en plus excentriques comme le quartier se dégradait, des cris, des pleurs, des mots de bienvenue aussi.
Je suis reparti, heureux de ma découverte. Un porte de plus à ajouter à ma collection. J’avais aussi le sentiment que ma déambulation venait vraiment de commencer. Je n’étais plus un simple badaud caché dans son manteau, mais un flâneur attentif au texte de la ville.
Je ne sais trop quoi dire de ma déambulation de l’après-midi. J’ai suivi Sainte-Catherine jusqu'après Bercy. Je suis allé explorer les dessous du viaduc, prenant quelques photos des graffitis qui ornent les poutres de ciment. J’ai été tenté de franchir la clôture et de rejoindre les rails, mais j’ai rebroussé chemin. Le froid rend craintif. J’ai ensuite franchi le viaduc, sans m’arrêter sauf pour un rapide cliché des wagons immobilisés sur les rails. De retour sur la terre ferme, j’ai pris à gauche sur Préfontaine, puis à droite sur Adam et à gauche sur Saint-Germain. Je laissais mes pas me guider, ou est-ce plutôt le vent, toujours vigoureux, je ne sais plus. À cette température, on n’explore pas un quartier, on expérimente le froid: les effets du froid sur le corps, les contrecoups du froid sur les appareils électroniques, la morsure du froid sur les joues et le front, son impact sur les neurones.
J’ai aperçu du coin de l’œil des drapeaux de prières tibétains, des fenêtres brisées, des chaises berçantes recouvertes de neige, une école dont toutes les ouvertures, portes et fenêtres, ont été placardées, une marionnette sortie à l’Halloween et oubliée là, dans le froid et la neige, une vieille télévision jetée aux ordures, des sommiers, trois sommiers en fait, défoncés, un double et deux simples, comme si le lundi était la journée des sommiers vétustes, des sommiers sans matelas. J’ai assisté à des mouvements aléatoires et désordonnés. Des rues traversées à toute allure. Des dames glisser sur les trottoirs glacés. J’ai remarqué une voiture le capot ouvert, le moteur sûrement noyé, des bicyclettes attachées à des grilles et à des arbres, rouillées et inutilisables. Sur une porte, j’ai lu un ordre de cesser les travaux. Plus loin, ce fut un avis de transformation d’un immeuble à logements en une copropriété indivise. Des graffitis contre le capitalisme sauvage. Des petites annonces agrafées à des poteaux de téléphone. Un chat perdu. Des locaux vides. Des baies vitrées vandalisés. Des commerces abandonnés.
Il y a toujours, dans le quartier, un chat qui est perdu. Pas perdu en soi, mais perdu pour son propriétaire qui placarde ses affiches sur des poteaux.
Pendant trente minutes, j’ai combattu une envie de pisser, diffuse dans les premiers temps, puis de plus en plus intense et qui a fini par occuper toutes mes pensées. Mon café au Comptoir 21. Un café filtre noir. Et un refill. Quelle idée avant de partir en déambulation! Persistante, lancinante, pénible. Non, tu ne feras pas pipi dans la ruelle; non, tu ne feras pas pipi contre le mur de l’usine, derrière le banc de neige non plus, contre le poteau de téléphone, derrière le camion, à côté de la poubelle, dans le petit parc. Mais où donc vais-je pouvoir faire pipi? Non, pas derrière l’église. Une église quand même, n’y pense même pas. Il a fallu que j’arrive au Salon de quilles Darling sur Ontario pour que je puisse enfin penser à autre chose. Les dames âgées qui attendaient leur tour assises sur des chaises d’église en plastique m’ont à peine dévisagé quand je suis passé. Je savais où se trouvaient les toilettes, j’ai eu l’air d’un gars de la place.
Et je n’ai rien écrit, tout ce temps, parce qu'il faisait trop froid. J’ai utilisé plutôt le logiciel de prise de note de mon téléphone intelligent. On presse longuement sur le bouton central, on demande de «rédiger une note» et SIRI, c’est comme ça qu’elle s’appelle, répond «Que voulez-vous prendre en note? » Et la dictée se transforme presque miraculeusement en texte. Je dis presque parce que les ratées sont nombreuses.
"Ce que j'apprécie le plus de mes grandes données du lundi après-midi Nanche Lagotte c'est le fait que je te déteste toi décrocher complètement de mon horaire pour pouvoir me libérer alors entre le trop-plein d'activités tout à coup je me mets à avoir droit à une Flandry moment béni malgré le très grand froid de la journée."
Sûrement l’impact du froid sur les circuits électroniques.
J’ai monté et descendu quelques rues, de Sainte-Catherine à Hochelaga, à la recherche de détails intéressants. Mais il n’y avait rien de très sexy. Les gens étaient encabanés, les enfants, toujours à l’école, et les ados se cachaient pour fumer. Il n’y avait que des passants pressés de retourner à la maison et des techniciens dans des camionnettes.
Sur Joliette pourtant, juste en retrait de Sainte-Catherine, j’ai fini par découvrir un magnifique tas d’objets délaissés. On aurait dit le contenu complet d’un trois et demi, appareils électroménagers exclus. Déménagement subit? Rupture tumultueuse? Éviction? Il y avait des chaises, des tiroirs de commode, des meubles éventrés, des sacs noirs et des sacs roses, une imprimante, un traîneau en mousse, un pot de mayonnaise et, sur le coup j’ai été intrigué, mais oui deux cadres en carton, des passe-partout blancs enchâssant des photos reproduites sur du papier de mauvaise qualité. J’ai pris une photographie du tas, en pensant aux camions de mon père, et me suis emparé de ces deux cadres de fortune. Je les ai transportés un peu plus loin dans la ruelle, les ai déposés sur la neige pour quelques clichés, puis ai retiré les photos des passe-partout et me suis sauvé, les deux clichés enroulés et coincés dans mon sac à dos.
Il était temps que je rejoigne l'Atomic Café sur Ontario où nous nous étions donné rendez-vous. Marjolaine et Marion étaient déjà attablées. Les deux seules du groupe en fait. Les autres ne s’étaient pas pointé le bout du nez. Trop froid peut-être. Mes lunettes étaient embuées, mes mains, frigorifiées. J’ai pris un autre café, plus par réflexe qu’autre chose, et je me suis assis. Nous avons échangé sur nos parcours respectifs. Sur le froid, sur la lumière, sur la difficulté d’explorer quand la température glaciale réduit les déplacements au strict minimum et tronque les perspectives. Denise est arrivée par la suite. Toute en noir, sauf pour ses joues rouges. J’ai montré mes deux photos, comme un gamin fier de son dernier mauvais coup, et c’est là que la coïncidence m'est apparue avec toute sa force. C’étaient des photos de portes! Deux photos de portes, des reproductions de clichés d’un photographe britannique, un dénommé Joseph Eta. London Doors I et London Doors II de Joseph Eta, imprimés aux États-Unis, Félix Rosentiel’s Widow and Son limited. Des portes très classiques, l’une ornée de pierres peintes en blanc et dessinant un soleil enfantin, l’autre surplombée d’un toit comme s’il s’agissait d’un temple grec.
Des portes. Des portes anglaises en plein Hochelaga. Qui met des portes sur ses murs? Quelqu’un qui rêve d’une vraie maison? Ou qui veut toujours avoir une porte de sortie à sa portée? Imaginaire, évidemment.
C’était presque miraculeux comme hasard. Ma randonnée qui avait commencé avec une photo de porte, prise un peu au hasard, parce qu’il fallait bien commencer quelque part et que les portes font de merveilleuses entrées en matière, se terminait sur des photos de portes. D'une porte dans Centre-Sud à des clichés de portes dans Hochelaga, le trajet était complet. Le palimpseste reprenait ses droits, réunissant deux quartiers séparés par des décennies de vie.
Plus tard, de retour à l'appartement, en faisant des recherches sur Internet, j'ai réalisé, légèrement dépité, que les deux photos de portes avaient été achetées chez Ikea. Elles se vendaient en séries de trois avec leur passe-partout. Bild Fjällsta, 14$ pour un set. C’étaient des photos sans valeur, achetées dans une grande surface, de la culture préfabriquée, raisons pour lesquelles évidemment elles avaient été abandonnées sur le bord de la rue.
Elles sentaient la fumée de cigarette et l’humidité.
Ma déception a été de courte durée, car je me suis rendu compte qu'il en manquait une. La troisième. Ce n’était pas un hasard. C’est moi qui l’avais. Moi qui l’avais prise au 2393, rue Sainte-Catherine. La troisième porte de l’ensemble, c’était tout simplement la mienne. Ma déambulation n'avait servi qu’à ça: compléter un parcours dont j’avais choisi sans le savoir les bornes. Ma longue marche dans le froid et mes souvenirs animés par un subtil jeu d’écrans et de réflexions avait servi à redonner à un ensemble sa totalité. Elle avait reconstitué une triade. Et ce faisant, elle avait jeté un pont entre deux univers, entre deux histoires, mais à rebours, dans le sens contraire du temps, le présent rejoignant le passé pour le dévoiler miraculeusement indemne. Sans une égratignure, ou à peine.
C’est quand on s’y attend le moins que le monde se rappelle à nous dans sa complexité. La vie secrète des événements, ce n’est pas une voiture qui en emboutit une demi-douzaine sur une rue en plein milieu de la nuit, c’est sa propre voiture qui en ressort sans égratignure; et c’est une photo de porte prise spontanément à laquelle répondent deux heures plus tard des photos de portes abandonnées au coin d’une ruelle.
Modalités du parcours:

/index.png)