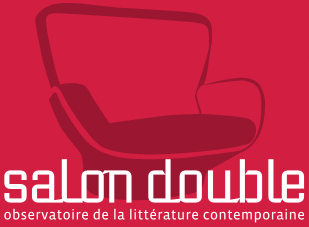Lectures
Salon double publie des textes appelés "lectures" pour leur caractère hybride se situant entre critique journalistique et la critique spécialisée de type universitaires. Ces lectures peuvent porter sur n'importe quel genre littéraire (roman, théâtre, poésie, oeuvre hypermédiatique, bande dessinée, blogue littéraire).
|
Exercice de style en dix-huit crimes Le lecteur ne peut définir exactement le style de Thomas Clerc et cependant se doit de relier les modes d’écriture choisis par l’auteur aux crimes qu’il décrit. La nouvelle inaugurale est des plus troublantes en la matière. Les jeux de mots grivois, le style très oralisé, les descriptions crues, utilisés par l’auteur semblent en totale opposition avec l’univers intellectuel que l’on associe à Roland Barthes. Toute la nouvelle est focalisée à la première personne du singulier sur le futur meurtrier du célèbre essayiste. |
par Guilet, Anaïs 26 jui |
|
Seul contre tous Les essais de Richard Millet, du Dernier écrivain (2005) au Désenchantement de la littérature (2007), semblent, depuis quelques années, se fermer à toute entreprise herméneutique, en développant une posture auctoriale particulièrement complexe. L'Opprobre (2008), son dernier livre, confirme cette tendance. Désir honnête et scrupuleux de restituer à son lecteur les grossièretés critiques qui ont accompagné son dernier texte? Ou plaisir malsain de ressasser en ricanant ce qui a définitivement fâché? Les premières pages de L'Opprobre dressent la liste, longue et laborieuse, mais finalement —n'est-ce pas aussi ce que cette énumération suggère?— éminemment consensuelle, des qualificatifs qu'une certaine critique littéraire a cru bon d'attribuer à l'auteur du Désenchantement de la littérature. Avec L'Opprobre, Millet s'arroge donc le droit légitime de répondre à ses contempteurs qui, pour l'occasion, deviennent, dans son imaginaire profondément empreint de manichéisme, des «ennemis» à abattre, des «agents du Démon» à neutraliser dans des phrases assassines. |
par Hébert, Sophie 13 jui |
|
La plus petite unité de temps C’est du délicat balancement entre intime et collectif que naît la singularité du livre, impossible à réduire à une catégorie générique. Pas de personnages, pas de récit, plutôt une collection de fragments bruts, déversés sans aucun pathos, qui mettent côte à côte des souvenirs de voyage et des scènes de films, des échos de la rumeur publique et des rappels historiques. Dispersés de 1940 à la fin des années 2000, ils dressent ensemble le portrait d’une génération, exprimé à travers le «elle», le «on» et le «nous», jamais le «je». Ce qui aurait pu se transformer en une suite de lieux communs et d’anecdotes sans grand intérêt sur différentes époques est récupéré par la volonté de l’auteure de se compromettre pour révéler le corps nu de chacune de ces années, d’exposer son expérience intime pour la perdre dans une réalité plus vaste. |
par Côté-Fournier, Laurence 05 jui |
|
La lecture coupable Volupté, envie, plaisir, luxure, désir. Autant de mots qui auraient pu traduire en français le titre allemand de ce roman de Jelinek que l’on a finalement laissé intact, par souci d’en préserver la polysémie. Lust se voulait initialement un contre-projet à L’Histoire de l’œil de Georges Bataille, mais Jelinek s’est révélée incapable de construire une esthétique pornographique selon une perspective féminine. Ainsi explique-t-elle son «échec»: «il ne PEUT y avoir de langue spécifiquement féminine du plaisir et de l’obscénité, parce que l’objet de la pornographie ne peut développer de langue qui lui soit propre». Selon l’auteure, la seule option qui s’offre aux femmes est de dénoncer le langage pornographique en le ridiculisant. C’est d’ailleurs un ton ironique qui domine toute la narration de ce roman. Lust met en scène, dans une villa bourgeoise, les ébats d’un couple auxquels assiste parfois leur jeune fils. L’homme, directeur d’une usine de papier, n’attend de sa femme qu’une seule chose: qu’elle soit toujours prête à satisfaire ses moindres pulsions sexuelles. |
par Larrivée, Stéphane 25 juin |
|
La rassurante présence des déclassés Dans les deux derniers romans de Virginie Despentes, Teen Spirit [2002] et Bye Bye Blondie [2004], les divisions de classe ne sont pourtant pas désuètes; elles sont bien au contraire au cœur des déchirements que vivent les personnages qu’ils mettent en scène. J’aimerais réfléchir à cette tension importante dans ces romans entre prolétaire et bourgeois afin de comprendre pourquoi Despentes juge pertinent d’utiliser ces nominatifs dans un contexte littéraire. Elle tire ces catégories de la culture politique punk de gauche radicale, qui s’est complètement réappropriée le vocabulaire marxiste. |
par Paquet, Amélie 17 juin |
|
Mourir de sa belle mort Le Journal de Marie Uguay, paru en 2005 chez Boréal, offre, comme d’autres avant lui — qu’on pense à ceux d’Hector de Saint-Denys Garneau et d’Hubert Aquin, pour ne nommer que ceux-là —, une proximité peu commune, non pas avec une représentation fabulée de l’auteur, mais bien avec l’auteure réelle elle-même. Le journal étant une trace contextualisée et temporelle d’une époque, d’une période, les écrits de Marie Uguay ne ressemblent donc pas à ceux des autres écrivains québécois, aussi diaristes (quoiqu’en disent les rumeurs). Marie Uguay ne partage pas le sacré et la préciosité de Garneau, ni la fougue violente, dense et tumultueuse d’Aquin. Il s’agit plus sûrement, dans le cas de Marie Uguay, d’une quête littéraire existentielle mue par des préoccupations esthétiques et sociales: la recherche d’une écriture affranchie de ses aliénations (comme Québécoise, comme femme, comme écrivaine) et d’une poésie prosaïque, élémentaire, qui s’élabore à partir du quotidien tangible, de ses manifestations matérielles. |
par Dufour, Geneviève 31 mai |