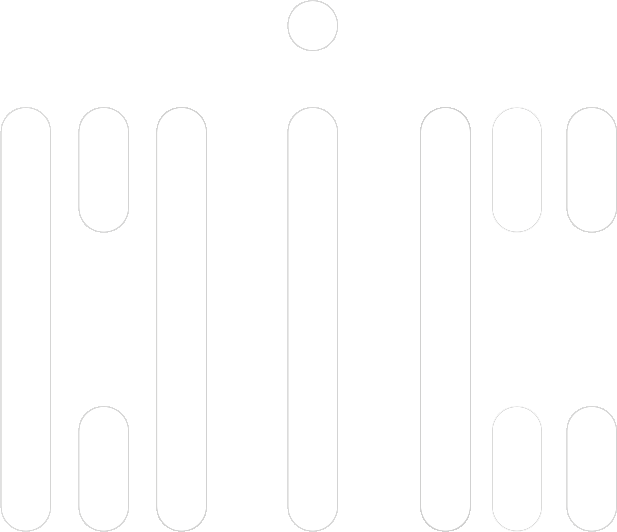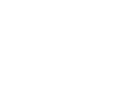Étrange intimité
Je ne sais pas lire dans les lignes de la main, ni dans celles des quartiers, mais je peux lire en moi ce que le quartier fait et dit, sous quelle forme il surgit. Au coin des rues, je croise souvenirs et pensées. Les images se superposent et je vois double; à la fois ce qui est là et ce qui n’est plus.
La place Valois, avec ses blocs lumineux, était autrefois un terrain vague rocailleux où passait une track de chemin de fer. Petite, j’y marchais avec ma grand-mère et la suivais en funambule, tentant de garder l’équilibre sur la barre de métal. Souvent, je demandais «où ça mène grand-maman?», et elle me répondait toujours «nulle part». J’imaginais le train courir comme un fou, au-dessus du fleuve, vers ce nulle part inconnu.
C’est l’hiver et j’éprouve l’impression d’une lutte d’appartements. À l’extérieur, tout est calme, mais je ressens ce combat silencieux qui se prépare, qui a déjà lieu et continue d’advenir entre les murs. Je repense à cet ami qui me disait toujours de chercher ce qui est mort dans le vivant, ce qui est vivant dans la mort. La question à cent piasses d’Adamus en tête, je marche, regrettant presque de n’avoir rien à fumer, pas de tabac, pas de papier. C’est un quartier qui s’observe bien en fumant, mieux qu’en faisant du jogging.
Debout face aux lieux de mon enfance, impossible d’oublier quoique ce soit. L’adolescence aussi passe entre les ruelles, elle y est à sa place.
Au 1407 Leclaire, je revois l’amie et ses lunettes écaillées. Au coin de la rue, le restaurant Le sommet où nous allions le vendredi soir. Deux gamines riaient alors des cheveux du cuisinier : quatre mèches placées sur son crâne pour tenter de cacher sa calvitie.
Sur Nicolet, les voisins de ma grand-mère étaient ce qu’on peut appeler des «white trash». L’été, la voisine de trois ans se promenait en bobettes sur le trottoir avec un deux litres de coca, et dans leur cour, aboyaient deux grands chiens effrayants. Pour moi, le monde tenait alors entre les seins d’Aline et en son cœur que j’écoutais battre attentivement; tic-tac, comme une horloge.
(Hochelaga comme une mémoire en mouvement qui mime la fixité.)
Les bonbons chez Oscar, la quête aux objets roses dans les friperies, puis ce moment où je me suis mise à déambuler seule, écouter Nirvana, porter du noir et beaucoup pleurer. Je m’achetais des canettes de peinture : graffitis sur les trains, les ruelles, partout.
Les graffitis étaient laids et naïfs; une black label et des gants troués suffisaient à me faire sentir bum. Il y avait la révolte et ses nombreuses découvertes; l’amour au féminin, bières flats et pots de peanuts, le mot anarchie et les déjeuners deux œufs bacon, détester les flics, aimer les flaques d’eau et le jour des poubelles. Faire de la photographie, de la poésie, et tomber en amour souvent avec des toxicomanes, brûleuses de condos, névrosés magnifiques et autres artistes du vivant. Aimer dans un quartier qui sent la sueur et le houblon, emmitouflés dans des couvertures de laine que l’on porte comme vêtements.
Je marche et pense à toutes ces fois où je suis rentrée chez moi entre soir et matin. Le calme entre deux tempêtes.
Odeur de mélasse et de tabac. Un paquet de Macdonalds bleu qu'on a laissé vide sur le trottoir. Les usines servent de points cardinaux et la piste cyclable se transforme la nuit en véritable forêt. J'ai encore la tristesse au coeur de ne pas pouvoir tremper mes pieds dans le fleuve, tout près.
Je ne sais pas si tous les coins de Montréal bougent autant, s’ils ont ce rythme-là. Il se passe dans Hochelaga quelque chose d’infiniment beau. Peut-être parce qu’on peut y sentir une tension : la beauté, le quotidien, le soleil comme ailleurs, mais aussi une certaine dureté qu’il est impossible de ne pas voir. L’adversité rend créatif ; l’adversité rend fou. On sent ici la vitalité des quartiers populaires (vampirisés un jour ou l’autre par les classes dominantes que le confort fige).
Oui, quand je marche ici, je marche en moi. Mais moi ce n’est rien de personnel. Au contraire, ça dépasse de partout, ça fuit dans tous les sens pour venir se souder aux gens que j’aime, que j’ai aimés, aux passants rencontrés et même à ceux que je ne croise pas.
Tout se déroule comme si le quartier était un texte s'écrivant sans cesse avec la voix, les gestes, bonheurs et souffrances de ses habitants. Habiter comme on écrit. Les murs craquent déjà de mots à partager. Peu importe la loi, les fautes, les façades trop propres; la langue est bien plus vivante lorsqu’on l’expose dans la rue. Dans ses ruelles, Hochelaga se prend pour un roman épique où s’affrontent les forces du bien et du mal.
On y croit encore un peu à la notion d’espace public et l'on a ce sentiment d’être au coeur d'un quartier-village.
Les regards s’accordent; j’ai toujours dit que nous avions ici une étrange intimité.

/index.png)