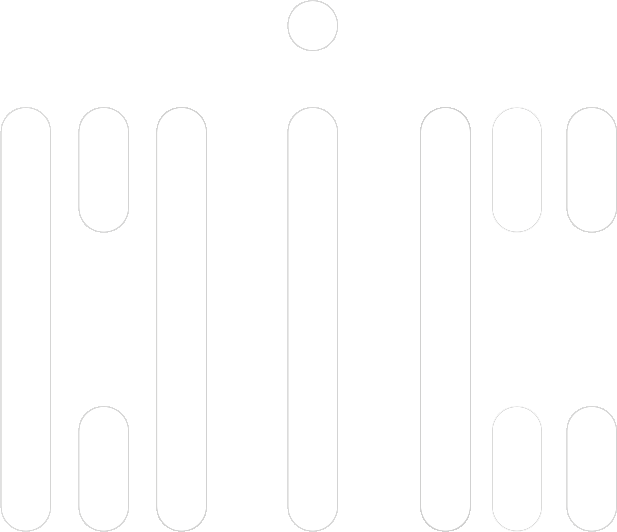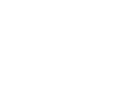De la poussière
« Tout se réduit, en fait, à la peur de la mort. »
E.M. Cioran
Sur les cimes du désespoir
J’y suis retourné après cinq ans.
C’était le 31 octobre, le soir. Un homme s’est approché de moi, a mis ses mains sur ma gorge, il a serré. Une femme a hurlé. Je me suis dégagé. J’ai arpenté le boulevard Pie-IX, désorienté, à la course, j’ai perdu le nord – je le suivais pourtant. J’ai traversé la rue Sherbrooke, n’y suis jamais revenu.
J’ai la mémoire des pas. Les rues ont changé et pourtant mon corps s’oriente de lui-même. Je reviens pour teinter mon regard de nuances plus claires. Lorsque j’entends « Hochelaga » je vois du noir, une ombre…
Je manque d’air.
Trouver une façon de disparaitre dans le décor; laisser le noir à la maison, porter le bleu, le gris, le vert passé, m’user d’avance, me rendre invisible : me fondre dans les mouvements de la rue, pour paraphraser les dires de Paul Auster. Afin de ne pas m’effondrer sous la peur de marcher là-bas, je m’imagine auteur, ou détective. Marcher et écrire ne sont pas deux activités aisément compatibles, il est particulièrement difficile d’écrire sans regarder la page; mais je ne peux pas m’arrêter, m’immobiliser, je dois marcher constamment, trouver une manière confortable d’écrire en mouvement, photographier à la course des images. J’ai donc décidé de poser le cahier contre ma hanche droite un peu à la manière d’une palette de peintre. Je revêts les mots d’Auster et m’engouffre dans cette partie interdite de ma ville : je passe la rue Sherbrooke, et descends vers le fleuve.
L’exercice est simple à première vue : flâner, écrire, saisir des parcelles d’Hochelaga. Et si j’ai décidé, d’entrée de jeu, de ne pas m’asseoir, j’ai changé – une fois sur place – les règles : tant que les mains ne me hantent pas, je peux m’arrêter.
Où que je sois je cherche l’église. Je regarde du haut des marches cette portion de la promenade où seulement quelques arbres poussent, bien enracinés dans l’asphalte de l’Est. Coin St-Germain et Ontario, trois femmes discutent; là où je suis je n’en vois qu’une. La vitrine du magasin sans adresse est bondée, un capharnaüm à l’image du quartier. L’ancien et le presque ancien – ou nouveau chic – coulent l’un dans l’autre. À quelques vitrines de là, un café-librairie. La terrasse est bondée de gens d’ailleurs – touristes du Plateau Mont-Royal – pour accentuer le contraste. Je suis moi aussi touriste dans ce nouvel Hochelaga; il est vrai que certaines choses ne changent pas, l’Église, le Salon de coiffure Chantilly… Une voix s’élève, elle vient de l’intérieur, une grosse femme mauve chante Janis Joplin. Deux jeunes femmes polonaises, tantôt assises sur le banc devant L’idée Fixe, se promènent vers l’ouest, juchées sur leurs talons hauts en résine blanche. Une porte apparaît, un couple en sort. Les trois femmes parlent toujours, l’une d’elles – la seule que je devine – ne cesse de tourner sa tête d’ouest en est. Mon regard glisse sur la vitrine d’à côté, le 3255, un ancien commerce dont je n’ai pas souvenir. L’espace est sans profondeur, la vitrine est bariolée de graffitis et... Une femme me déconcentre. Son regard vacant, la planche de bois immense qu’elle transporte, tout chez elle me force à la suivre des yeux; les deux Polonaises repassent. Je dois changer d’angle, rétrécir mon champ de vision, creuser les apparences. Les trois femmes ne parlent plus, elles se sont évaporées.
J’avance vers le lieu de la disparition. À mes pieds, les traces de la conversation : des mégots, des marques laissées par les chaises dessinées dans la poussière, des gouttes d’eau encore fraiches – possiblement du thé. Je regarde la vitrine; de petites affiches sont collées de l’intérieur, l’une d’elles m’apprend que certains produits sont « fait à la main par un artiste sculteur », alors qu’une autre raconte Les promenades d’un artiste sculpteur. Le sculteur et le sculpteur; juste au-dessous, une affichette annonçant une « bicyclette pour enfant presque neuf », pour enfant peu abimé. Une pancarte m’informe que le magasin est ouvert; une autre, posée sur le mur derrière, affiche « fermé ». Une vitrine pour un lieu approximatif, une boutique à deux portes, l’une close, l’autre affichant : « Danger, chien de garde, à vos risques ». Le non-lieu est sans adresse : « Pour plus d’information s’adresser au 3690 rue Ontario ». L’église d’en face s’y reflète comme sur un lac. Pour voir à l’intérieur, voir au-delà des mots, des affiches, de l’architecture romano-byzantine, je dois coller mon visage sur le verre éteint; enlever, du revers de la main, la couche de crasse. Une table, quatre chaises – empilées plus ou moins stratégiquement –, des fleurs de plastique, une lampe en céramique beige surmontée d’un abat-jour poussiéreux autrefois blanc. Le mur du fond est jaune moutarde, le plancher, lui, est bleu-gris. La lumière est presque absente, tout semble mort. Une couronne de gui est suspendue dans un coin; juste à côté, une grosse cloche rouge accrochée maladroitement à un ruban vert – probablement les vestiges d’un 24 décembre. Je fouille patiemment l’obscurité, des contours se dessinent. Une vieille étagère de presbytère perce la noirceur; derrière une de ses vitres, une ménagerie de verre et quelques petits livres, vraisemblablement du théâtre, peut-être du Tennessee Williams. Sur l’étagère du dessous, un gros bibelot mauve pastel en forme de main ou de corail, ce type de forme non indentifiable qu’on observe, enfant, pendant des heures chez sa grand-mère, et qui, le jour où elle nous le lègue, se retrouve à mille lieues au fond de la garde-robe, ou ici, derrière deux vitres, loin de la lumière. Juste à côté un trophée à vendre, si l’on en croit l’étiquette. Sur le mur, un cadre, un carré, dans un carré, dans un carré, derrière une vitre : Magritte peut-être… Puis un chapeau melon. Sur une petite table traîne un livre, Gabrielle Roy assurément, placé au centre du magasin comme une boîte en cristal remplie de pot-pourri. Le livre parfume l’endroit : l’odeur de la pauvreté.
C’est ici que se sentent les contrastes. Entre un salon de coiffure miteux et un bureau de change : le café-librairie. La table est faite de vieux bois, une planche épaisse, vernie comme dans les boutiques de la Main, la nouvelle Main. Partout autour de moi, des livres : je respire. J’ai tourné le dos à l’église, un jeune homme regarde à gauche, puis derrière. Un couple observe les œuvres accrochées aux murs, un regard sans intention, il regarde pour regarder : « C’est beau, qu’est-ce que tu fais ce week-end? ». Une jeune femme vêtue d’une longue robe victorienne écrit à la plume dans un cahier Moleskine, une autre écrit dans un cahier Clairefontaine; partout autour de moi des femmes écrivent. Les bruits de crayons se superposent à ceux du piano désaccordé. Je vois, posé en évidence sur une tablette, un roman de Tremblay, le premier tome des Chroniques du Plateau Mont-Royal – collection Babel. Les auteurs me suivent, m’accompagnent, je ne suis pas seul. Le bruit de fin de journée s’installe, il est cinq heures; je pense aux trois femmes d’avant, je vois un chat noir au fond du café : il n’est pas d’ici.
Je traverse le parc Préfontaine et m’adonne à un exercice de mémoire. Ici, je me suis fait offrir de la poudre à treize ans. Je ne savais pas ce que c’était à l’époque, mais je me souviendrai toujours du visage de l’homme égaré. « De la poudre », je trouvais ça presque beau; se faire offrir de la poussière. Puisqu’il est dit que l’éternel dieu forma l’homme de la poussière de la terre, qu’il souffla dans ses narines un souffle de vie, et que l’homme devint un être vivant, j’avais l’impression de me faire offrir les restes, ou la genèse d’un homme. Plus loin à gauche, derrière le conteneur à vidanges, j’ai vomi d’alcool pour la première fois. Je m’engage sur la rue Hochelaga, les souvenirs se bousculent : une sainte dorée, un geste violent, une bouche d’aération gigantesque sur laquelle j’aimais me coucher (le vent en sortait par grandes bourrasques du cœur de la ville). L’espace d’un instant l’odeur d’Hochelaga disparaissait, remplacée par celle du métro de Montréal. Je monte sur la bouche et marche sur la grille qui me sépare du vide, du noir. De là, je vois mon école secondaire, autrefois si sale de l’extérieur : les traces du lavage à pression, de l’effacement de la crasse – la poussière de ville –, du meurtre de l’histoire, sont encore visibles; les vitres sont nettes, impeccables : Le Vitrail a été nettoyé. Au coin de la rue Davidson, le petit restaurant de quartier a complètement disparu : les fenêtres n’y sont plus, la porte non plus (à moins que ma mémoire ne me fasse défaut), le briqueteur est passé. Je prends à gauche, dans la ruelle, toujours les mêmes maisons, la même automobile de collection turquoise; j’ai un frisson, c’est ici qu’un homme a posé la main sur une adolescente, mon amie, il y a huit ans. Je marche de ruelle en ruelle et j’arrive à la rue Adam. Je marche sur des pommes. Une femme, naturellement, passe à côté de moi. Je reviens sur mes pas, retrouve le Nord, et soudain : une école. Sans escalier, sans issue. J’imagine les enfants derrière les fenêtres barricadées, les écoles devraient être comme les églises, intouchables. Le soleil baisse. Je sens la mémoire des mains sur ma gorge. Je dois me remettre en route. Le cahier sur la hanche droite, je regarde devant, une fillette aux souliers rouges passe devant moi: « Suis toujours la route de briques grises », dit-elle. Le vent se lève, elle s’efface progressivement, retourne à la poussière d’où elle est née.
J’ai suivi la route de l’école sans fenêtre jusqu’à la grande place. Érigée au cœur du quartier Hochelaga, un village au sein d’un autre où les murs sont neufs et les fenêtres sont propres. Une ruelle bariolée de graffitis – un homme masqué avec une arme à feu tire des billets de banque sur le mot « Hochelaga » – borde la route de briques grises. Plus j’avance, plus les limites s’effacent; les gens changent, ne restent que des vestiges, quelques hommes égarés qui viennent de l’autre village, celui d’à côté : l’Hochelaga d’en bas – celui des pauvres – d’avant les nouveaux développements. L’architecture froide s’impose, même l’odeur d’Hochelaga ne s’aventure pas jusqu’ici, comme si elle savait qu’elle mourrait d’elle-même, qu’elle ne pourrait pas coller. Plus d’histoire, ou plutôt une nouvelle, construite sur un cimetière de pas à jamais recouverts. Au moment où je perds espoir, où je me vois grimper à la cime d’un arbre – voir l’église – pour respirer à nouveau, une porte s’ouvre sur une ancienne fonderie transformée en lieux d’habitation; restent les murs, les rouages, les fondations; ruines commémoratives à l’image d’une époque révolue. Je retourne sur mes pas, désorienté par toutes ces lignes trop droites, trop propres, puis j’aperçois sur un mur un trait noir irrégulier qui, au fur et à mesure que je m’approche, forme des mots : « Aura fallu reste l’irréel à toujours ». Quelqu’un crie, je regarde à mes pieds, j’étais sorti du droit chemin. Un homme apparaît. Il tend une main vers moi. Je quitte les lieux.
Je reviens quelques jours après; j’ai décidé, cette fois, de porter le noir, d’assumer le regard des autres. Mon cahier bien en évidence, je dépeins la place Valois : une fresque se dessine. Une femme danse sur un rythme qu’elle seule entend, un homme – parfaitement dessiné – pose fièrement sur la grande place, un pied sur un des blocs de marbre blanc, rappelant les chefs-d’œuvre de la sculpture : le David de la place Valois. Le chef-d’œuvre arrive directement du Renaissance; un sac accroché à son vélo – fidèle monture – le trahit. Il passe de bloc en bloc, réécrit inconsciemment l’histoire de la sculpture, du Kouros au Contrapposto. À quoi bon inventer des personnages?
Je quitte la grande place, marche quelques minutes, et m’engage sur la rue Dézéry; de balcon en balcon mon regard glisse, divague. Un morceau de parchemin gigantesque attire mon attention : « Là où le passé est au présent ». Sur le pas de la porte une chaise dorée sur laquelle une forme triangulaire, rappelant une pointe de flèche renversée, est gravée. Au centre du symbole : la lettre « P » en majuscule. Je monte les trois marches, parce que trois est un chiffre littéraire et que je n’ai pas pris la peine de compter, et m’engouffre dans le hall de l’appartement. Partout des centaines de costumes empilés les uns par-dessus les autres, j’ai peine à marcher. Une femme s’approche de moi et me donne une carte : « Tout n’est pas là, il manque beaucoup de choses! »… Il doit y avoir une convention dans le passé. Je croise mon regard dans le miroir, je passe de l’autre côté. Le « P » sur la chaise continue de me hanter, le mot « pléiade » surgit, comme pour donner plus de substance à l’entreprise, à la flânerie. Puis le mot « poussière » se dessine. Le vent se lève, le soleil tombe et, avec lui, les mots. La noirceur m’effraie, les mains, les griffes de l’homme du 31 octobre surgissent des profondeurs, je cours jusqu’au Square Dézéry. Le carré vient rétablir l’équilibre, une grande croix apparait peu à peu derrière les arbres : j’oublie les mains, la lettre… Dans la lumière du lampadaire, au milieu du carré, je vois David.
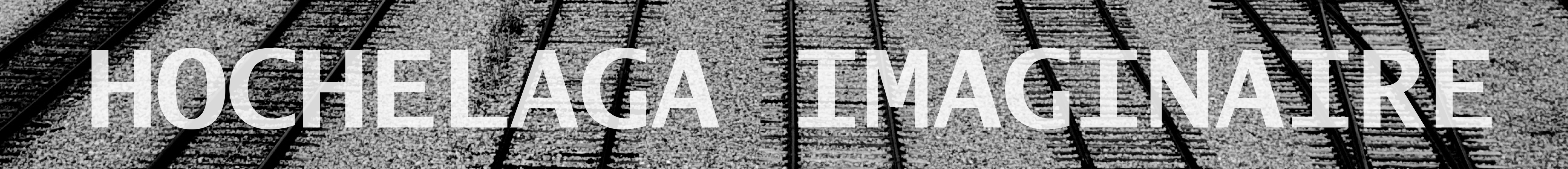
/index.png)