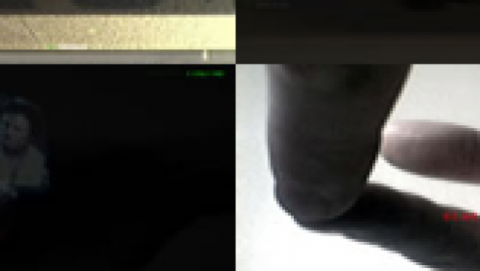
Non sans ironie, Nicolas Bonnal définit dans son essai Internet, la nouvelle voie initiatique, le ludique comme une « destinée de l’homme post-moderne et interactif; la philosophie en a toujours rêvé » 1. Cette remarque générale à l’endroit du vaste monde de l’Internet s’applique fort bien à la littérature hypermédiatique. Le ludique et l’interactivité littéraire constituent deux concepts intimement liés. L’imaginaire qui sous-tend le passage du texte à l’écran tient lui-même du ludique. Dans un article consacré à un CD-ROM sur l’œuvre de René Magritte, Nathalie Roelens cite un extrait de la pochette destiné à décrire le contenu de l’adaptation numérique : « Une aventure interactive : Jouez avec Magritte » 2. Le lien, dans cette phrase, est explicitement posé. L’incursion de l’interactivité par la transposition du texte vers l’écran connaît toujours, selon l’idéologie de l’informatique, une dimension ludique.
Littérature informatique et ludisme
Les premiers critiques de la littérature destinée à Internet soulignent cette jonction. Jean-Pierre Balpe signe en 1994 un manifeste sur la littérature électronique qui cherche à légitimer les générateurs de textes informatisés. Il soutient d'emblée que la littérature générative concrétise la liaison entre le jeu et le littéraire : « Elle [littérature informatique] veut concilier définitivement l'activité littéraire et l'activité ludique : détacher la littérature de la sphère de sérieux révérenciel et mortifère où l'enferme toute tradition ‘classique’ » 3. Jean Clément soutient aussi un discours similaire dans une étude qu’il voue aux hypertextes de fiction. Les textes littéraires créés pour Internet ne sont pas seulement en relation avec le ludique, ils encouragent le jeu au sein de la littérature : « L'hypertexte, en effet, n'est pas seulement un nouveau dispositif de publication, il est aussi indissolublement une technologie à la fois intellectuelle et énonciative qui rompt avec la linéarité du discours, introduit des ruptures, produit du désordre et du jeu dans les activités d'écriture et de lecture . » 4 L’argument de Clément, qui souligne cette jonction, se révèle toutefois assez discutable puisque ladite littérature traditionnelle connaissait déjà, et depuis longtemps, la notion de jeu. Elle n’a pas attendu le développement de l’Internet pour rompre avec la linéarité qu’on lui concède habituellement.
Idéologie du jeu
L’article de Bertrand Gervais et Nicolas Xanthos problématise davantage cette relation entretenue par le ludique et le littéraire. Ils rattachent l’aspect ludique de l’hypertexte non pas à l’absence de linéarité de ces textes mais plutôt à la façon dont l’internaute prend contact avec les œuvres informatisées : « On ne lit pas sérieusement les hypertextes fictionnels. On joue à les lire. Si déjà, aux dires des philosophes du langage, la fiction est un jeu de faire semblant, le lecteur simulant par voie de conventions implicites une référence, celle qui a cours avec les hypertextes exacerbe cette disposition, l’imposant comme régie unique » 5. La lecture des oeuvres littéraires sur Internet, qui constitue une pratique nouvelle pour les lecteurs, s’inscrit inévitablement sous le signe du jeu. Le passage du texte à l’écran perturbe le rapport que le lecteur entretient avec la textualité. L’Internet semble donc prendre part directement à la notion de ludisme. Bonnal argumente d’ailleurs que l’Internet a été créé à partir d’une forme particulière de jeu : le jeu de mots. Ainsi, écrit-il, « L’Internet tourne autour des jeux de mots» 6. L’idée de jeu se trouve au cœur du développement d’Internet et contamine de ce fait les œuvres de la littérature hypermédiatique.
Pratiques de la littérature hypermédiatique
Du point de vue de la forme, il apparaît d’emblée que les œuvres littéraires hypermédiatiques tiennent bien souvent davantage du jeu vidéo que de la littérature dite traditionnelle. Le jeu vidéo et l’œuvre de littérature hypermédiatique en viennent ainsi à se confondre. Puisque conceptuellement on remarque la reprise d’éléments formels propres à une certaine tradition ludique, il existerait donc un « ludomorphisme » qui se profile au sein de ces œuvres.
Iconographie ludique
Dans la majorité des œuvres de littérature hypermédiatique, on retrouve, de près ou de loin, des créations qui puisent au cœur d’un imaginaire ludique dominant. À des degrés divers, la réalisation d’œuvres littéraires informatisées prend à sa charge de multiples concepts ou manières de créer de l’interactivité liés au jeu. La première trace du ludique est d’abord purement iconographique. Par exemple, dans Perec, de Richard Barbeau 7, qui s’inspire déjà dans un imaginaire ludique tiré des explorations oulipiennes 8, il y a reprise d’une iconographie propre aux jeux de société, plus précisément du Scrabble. Une autre utilisation du jeu se trouve dans Récits Voisins 9 où l'accès aux textes du collectif universitaire d'Ovosite est rendu possible en cliquant sur une animation qui simule un lancer de dés. L’internaute entre ainsi d’emblée dans les œuvres à travers une iconicité qui s’inspire du ludisme
Détournement ludique des fonctionnalités d'Internet
Une autre modalité d’intégration du ludique dans la configuration d’œuvres hypermédiatiques se retrouve, cette fois, non plus au sein de la forme mais davantage au cœur du contenu. L’utilisation détournée d’une fonctionnalité d’Internet relève d’un deuxième degré de ludomorphisme. Les œuvres Alone 10 et Rumeur 11 de Nicolas Frespech ainsi que Tue-moi 12 d’Éric Sérandour parodient l’utilisation courante des courriels. Alone propose à l’internaute d’écrire un courriel sans connaître son destinataire. Le message sera ensuite envoyé à un autre internaute inscrit à la liste qui pourra prendre contact avec son correspondant. Dans Tue-Moi, il s’agit aussi d’envoyer un courriel, mais cette fois l’internaute doit transmettre un message qui a pour contenu « Tue-moi » à un destinataire de son choix. Pour participer à Rumeur, l’internaute est invité à colporter un potin à propos de l’auteur de l’œuvre, Nicolas Frespech. À la manière de Rumeur, la Biographie d’Edouard Boyer 13 reprend, quant à elle, de façon ludique la configuration d’un blog. Autour du personnage fictif d’Edouard Boyer, chaque internaute peut ajouter une entrée afin de décrire un nouveau moment de sa vie. Dans Explication de texte 14, Boris du Boullay explore aussi de façon parodique les liens hypertextuels explicatifs. Au fur et à mesure que l’internaute clique sur les liens pour obtenir des informations supplémentaires, le texte initial devient illisible. Profils perdus 15 de Hervé Graumann, en restituant des soi-disant profils perdus dans l’Internet, parodie à sa manière les sites de rencontre. Le détournement ludique apparaît à travers ces exemples comme une des actualisations courantes du jeu au sein d’une œuvre informatique
Performance de l'internaute par le biais d'un périphérique
Le troisième niveau de ludomorphisme lié à l’utilisation des périphériques informatiques trouve son origine au sein d’une tradition qui relève davantage du vidéoludique. En plus de devoir ouvrir des liens ou des fenêtres par le biais de la souris ou du clavier, certaines œuvres requièrent de l’internaute une habileté ou une précision particulière dans la manipulation des périphériques, très souvent de la souris. À ce titre, l'habileté manuelle demandée par l’oeuvre structure et modifie le degré de contact avec celle-ci. Il s’agit donc d’une performance dans la mesure où selon l'habileté ou la précision de l’internaute le contenu de l’œuvre sera activé différemment. Touche ma peau 16 de Philippe Zulaica ou le 5e homme 17 de KRN constituent de bons exemples de cette caractéristique puisqu’en tentant de reproduire grâce à l’informatique un toucher, ils appellent à une performance de l’internaute.
Dans l’hypertexte, tel que conçu entres autres par Eastgate 18, existe une notion de performance propre aux jeux d’aventure. Le texte devient un territoire de jeu dans lequel l’internaute doit évoluer au moyen d’un déplacement qui se module selon un principe d’essai et d’erreur. Entre le jeu vidéo et les hypertextes, la différence majeure est souvent que l’hypertexte ne fonctionne pas selon un mode d’emploi explicitement donné à l’internaute. Jean Clément note d’ailleurs cette absence de règles : « Et à la différence des jeux vidéos fondés sur un répertoire limité d'action et d'effets rapidement assimilés par le joueur, l'hyperfiction est souvent un jeu intellectuel dont le lecteur ne connaît pas les règles » 19. Il n’y a pas nécessairement de bons ou de mauvais parcours. Le déplacement n’étant pas généralement comptabilisé en terme de pointage, l’échec n’existe pas dans la majorité des cas. Ces œuvres requièrent toutefois de la part de l’internaute d’exécuter correctement une performance. Aux Côtres furtifs 20 et Scénario 21 de Michael Sellem constituent deux exemples flagrants de cette perte de repères totale dans laquelle l’internaute est plongé lorsqu’il tente d’appréhender les œuvres. Dans ces deux cas, la progression dans les œuvres demande à l’internaute de compléter correctement une certaine performance par le biais du périphérique sans donner de règles précises.
Déploiement d'univers vidéoludiques
Le quatrième degré de ludomorphisme s’apparente encore davantage aux jeux vidéo. Il s’agit d’œuvres qui s’inspirent largement d’une tradition vidéoludique et qui activent des codes typiquement liés à ces jeux. L’utilisation de la technologie VRML Corona a permit l’intégration au sein de plusieurs œuvres hypermédiatiques, notamment chez Grégory Chatonsky 22 et Ollivier Dyens 23, de déplacements dans un environnement en trois dimensions. Une forme d’immersion qui rappelle bien des jeux vidéo dans lequel le joueur explore un univers sans manipuler un avatar, comme le jeu bien connu Myst. L’œuvre Clues 24 de Robert Kendall ressemble, pour sa part, aux jeux d’aventure qui furent très populaires sur les premiers ordinateurs personnels, comme King Quest. L’œuvre possède un système de pointage qui témoigne de la progression de l’internaute au sein de l’enquête. Dans Inhabitants 25 de Marika Dermineur, on assiste au déploiement d’un univers que l’internaute doit prendre à sa charge pour créer de la narrativité. Un peu à la manière d’un jeu de rôles, les actions et les lieux sont proposés par l’interface de Inhabitants. Il n’en tient ensuite qu’à l’internaute de s’emparer de ces éléments afin de créer une histoire. L’œuvre hypermédiatique Live and die 26 de Hervé Graumann correspond à un "God game"27. En ouvrant l’œuvre, l'internaute engendre un personnage virtuel. Il suit ensuite sa vie éphémère qui dure environ de deux à soixante secondes. Après le décès d’un de ces personnages, il peut recréer d’autres êtres qui mourront sous ses yeux.
Le jeu Façade 28 est un des meilleurs exemples de la relation intime entretenue par la littérature informatique et le ludisme. Décrit par ses auteurs comme un "interactive drama", Façade déploie un univers vidéoludique et littéraire à part entière. L'internaute, aussi lecteur que joueur, connaît au sein de cette oeuvre de nouvelles formes d'interactivité. Bien que la structure formelle reprenne une longue tradition de jeux d'aventure ou de "text games" 29, le jeu ne requiert pas du joueur les mêmes compétences et le même type lecture. Dans Façade, il est invité à comprendre l'humain; un humain reproduit par une intelligence artificielle plutôt remarquable pour ce genre de jeux. Les conversations que le joueur entretient avec Grace et Trip achoppent sur des malentendus et des doubles contraintes. Il est amené par le scénario à prendre partie pour l'un ou l'autre des personnages 30. Un niveau d'interaction supérieure à celui proposé habituellement dans ce genre dans les jeux vidéo.
Dans le jeu de la fascination technologique
Le ludomorphisme est donc un « devenir jeu » qui se retrouve sous différentes modalités au sein de la littérature hypermédiatique. Gervais et Xanthos lient ce ludisme à une fascination face à la technologie : « l’attrait pour la technologie et ses possibilités continue à faire de cette production un jeu, une activité ludique » 31. Cette fascination mine, selon eux, la lecture effective des œuvres hypermédiatiques. Bonnal décrit, pour sa part, le miroir comme le « lieu de la fascination de soi mais surtout de la menace : on peut se vider par le miroir. Alice le franchit pour entrer dans le cyberespace; nous l’imitons quotidiennement en naviguant » 32. L’Internet est donc cet espace miroir où l’internaute se plonge, fasciné par une menace. La fascination, pour Maurice Blanchot dans L’espace littéraire, est une passion qui implique une perte des points de repères du sujet par rapport à un objet. L’image vue à distance est l’objet de la fascination. La fascination constitue un piège, qui est le simulacre d’une présence: « ce qui nous fascine, nous enlève le pouvoir de donner un sens, abandonne sa nature « sensible », abandonne le monde, se retire en deçà du monde et nous y attire, ne se révèle plus à nous et cependant s’affirme dans une présence étrangère au présent du temps et à la présence de l’espace » 33. La fascination pour la technologie entraîne donc une mise à distance de ces oeuvres contemporaines. Il semble en effet que le ludomorphisme rend difficile l'analyse des oeuvres hypermédiatiques, puisque le jeu perturbe l'interprétation de ces oeuvres. Un des premiers défis critiques pour les comprendre sera justement de percer les différentes modalités de ce ludomorphisme afin de distinguer ce qui se passe dans ces textes derrière le jeu.
[1] - Nicolas Bonnal, Internet, la nouvelle voie initiatique, Paris, Les belles lettres, 2000, p. 269.
[2] - Nathalie Roelens et Yves Jeanneret (dir.), L’imaginaire de l’écran / Screen Imaginary, Amsterdam/New York, Rodopi, 2004, p. 227.
[3] - Jean-Pierre Balpe, « Pour une littérature informatique : un manifeste… », [1994], http://www.uoc.edu/in3/hermeneia/sala_de_lectura/balpe_pour_une_litterature_informatiqu.htm
[4] - Jean Clément, « Hypertexte et fiction : la question du lien », dans The Future of Web Publishing. Hyper-Reading, Cybertexts and Meta-Publishing, 2003.
http://www.interdisciplines.org/defispublicationweb/papers/16.
[5] - Bertrand Gervais et Nicolas Xanthos, « L’Hypertexte : une lecture sans fin », 2003 [1999], http://www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe/articles/art0036.htm.
[6] - Nicolas Bonnal, op. cit., p. 16.
[7] - Richard Barbeau, Perec, http://abcdfghijklmnopqrstuvwxyz.com/Perec.
[8] - Les textes oulipiens constituent une source d’inspiration importante pour la littérature hypermédiatique en général. Une des manifestations les plus tangibles de ce lien est la multiplication d’adaptations du recueil de poésie de Raymond Queneau Cent mille milliards de poèmes. Je cite deux exemples : Florian Cramer, 1000000000000000 de poèmes, http://userpage.fu-berlin.de/~cantsin/permutations/queneau/poemes/poemes... ou Magnus Bodin, Cent mille milliards de poèmes, http://x42.com/active/queneau.html.
[9] - Ovosite, Récits voisins, http://hypermedia.univ-paris8.fr/ovosite/recits/navi.htm
[10] - Nicolas Frespech, Rumeur, http://www.frespech.com/rumeur/.
[11] - Nicolas Frespech, Alone, http://www.frespech.com/alone/.
[12] - Éric Sérandour, Tue-moi, http://www.serandour.com/tue-moi.htm
[13] - Édouard Boyer, Biographie d’Édouard Boyer, http://www.edouardboyer.net/.
[14] - Boris du Boullay, Explication de texte, http://www.lesfilmsminute.com/explication.html.
[15] - Hervé Graumann, Profils perdus, http://www.ave.ch/echo/graumann/docshockwave/profils_perdus2.html.
[16] - Philippe Zulaica, Touche ma peau, http://digitalbiotope.com/netart/touche%20ma%20peau2.swf.
[17] - KRN, Le 5e homme, http://incident.net/works/5ehomme/
[18] - Eastgate, http://www.eastgate.com/.
[19] - Jean Clément, loc. cit.
[20] - Aux côtres furtifs, http://www.cotres.net/
[21] - Micheal Sellam, Scénario, http://incident.net/works/scenario/
[22]- Terre, the Subnetwork, http://www.incident.net/works/sous-terre/, Gregory Chatonsky, Incident of the Last Century, http://incident.net/works/incident_of_the_last_century/ ou Reynald Drouhin et Gregory Chatonsky, Revenances, http://www.incident.net/works/revenances/.
[23] - Ollivier Dyens, Après les plus vieux vertiges, in Navigations technologiques, VLB éditeur, 2004, 145 p.
[24] - Robert Kendall, Clues, http://www.wordcircuits.com/clues/index.htm.
[25] - Marika Dermineur, Inhabitants, http://online.impakt.nl/database/inhabitants/
[26] - Hervé Graumann, Live and die, http://www.ave.ch/echo/graumann/ld/liveanddie.html.
[27] - Je renvoie à l'expression « God game » telle que décrite dans Wikiperdia, http://en.wikipedia.org/wiki/God_game. L'office québécois de la langue française propose l'expression « jeu de simulation divine » afin de traduire ce concept.
[28] - Micheal Mateas et Andrez Stern, Façade, http://www.interactivestory.net/.
[29] - Je renvoie à l'expression « text game » telle que décrite dans Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Text_game.
[30] - Façade est un jeu expérimental. Certains développements de ce type sont introduits dans les jeux commerciaux. Star Wars Knights of the Old Republic (2004) et Fable : The Lost Chapters (2005) constituent deux des plus connus exemples de jeux où le joueur est amené à prendre des décisions éthiques.
[31] - Bertrand Gervais et Nicolas Xanthos, loc. cit.
[32]- Nicolas Bonnal, op. cit., p. 229.
[33] - Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1973, p.29
