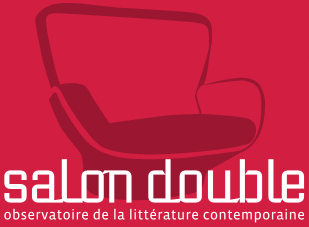dernières brèves
|
Notre dystopie Au-delà de la litanie de préjugés que vocifèrent vulgairement les trois monologues intercalés se développe en toile de fond un univers bureaucratique entropique, système suradministré où la tyrannie de l’organigramme déresponsabilise l’individu devenu remplaçable et impuissant. Chaque personnage dont le titre professionnel rappelle la novlangue orwellienne dénonce avec une condescendance hypocrite les travers des «fourreurs du système», tout en profitant eux-mêmes de ses largesses.
|
par Pierre-Paul Ferland 26 fév |
|
Leçons d’humilité. Studio de lecture #2 Comment ne pas voir dans ce premier texte un programme, une confession, une sorte de plan de l’ouvrage qui s’entame? J’ai donc lu Grande École comme le récit d’une découverte: celle de la littérature, que l’on devine à travers les arts visuels et l’étude de ceux-ci dans une prestigieuse école des beaux-arts. «Récits d’apprentissage», donc, mais non pas d’un apprentissage à la Bildungsroman; apprentissage de la littérature, plutôt, qui se cache au détour de l’œuvre et du concept. |
par Bélanger, David Landry, Pierre-Luc Schube-Coquereau, Phillip Voyer, Marie-Hélène 17 Jan |
|
Américains après tout Toute la prouesse d’Alain Beaulieu réside précisément dans ce refus de céder à la tentation du microcosme et de la métonymie. Ses personnages, aussi stéréotypés puissent-ils sembler, prennent une épaisseur inattendue en vertu de leur psychologie nuancée. L’Amérique de Beaulieu s’efface derrière ses personnages. Si certains peuvent justement voir dans l’indétermination géographique du titre et dans l’obsession de Beaulieu à ne jamais donner de toponymie claire à son histoire un vœu de «continentaliser» son roman, j’y vois plutôt, au contraire, un refus de thématiser à tout prix l’espace américain.
|
par Ferland, Pierre-Paul 08 Jan |
|
La guerre, menu détail
À force de rechercher la simplicité, le danger qui guette est de frôler la coquetterie. Défi ou déni? L’un ou l’autre, ou un peu des deux, aura poussé l’écrivain à raconter cet épisode des plus sanguinaires de l’histoire moderne sur un mode apparemment désengagé, en érigeant la factualité anecdotique au rang de matériau de prédilection. La Grande Guerre sert bien de cadre à son intrigue, pour peu qu’elle le soit, intrigante, mais tout porte à croire que le recours à cette époque sert davantage de prétexte pour décrire des objets du quotidien d’alors – meubles, costumes, le contenu du sac d’un soldat français – que pour revisiter le conflit d’un point de vue politique. |
par Levesque, Simon 19 déc |
|
Révolution(s) abandonnée(s) Thirlwell annonce un programme esthétique qu’il n’endosse pas entièrement, ou du moins pas jusqu’au bout. L’éclatement du texte est certes spectaculaire aux premiers abords, mais l’auteur ne met pas complètement son procédé au service de sa diégèse. Si, comme je l’ai mentionné plus tôt, certaines incises ont une motivation claire et qu’il emploie à l’occasion les ressources formelles des pages déployées avec brio, la plupart des incises ne font pas un usage bien motivé de la ressource, et la constante nécessité de retourner le livre dans tous les sens afin d’en lire des bribes conduit à l’agacement. L’auteur qui annonçait vouloir aller au bout de ses idées n’est pas parvenu à porter à bout de bras son projet. |
par Tremblay-Gaudette, Gabriel 25 nov |
|
Roadkill Je propose de retracer le processus identitaire du personnage de La foi du braconnier de Marc Séguin, qui rejette tour à tour le mode de vie à l’américaine et la religion catholique pour aboutir dans une sorte de néant identitaire dont la fuite constitue la seule issue. Même si l'oeuvre comporte plusieurs maladresses, imputables peut-être à l’inexpérience du romancier ou à la mode des «romans de quête masculin qui se développe dans les années 2000, il n’en demeure pas moins qu'elle illustre un malaise manifeste à l’égard des identifications nationales traditionnelles et un rapport de connivence envers la culture de masse américaine propre aux romans québécois contemporains. |
par Ferland, Pierre-Paul 20 nov |
|
La parole contre l’aliénation Toutefois, dans La guerre au ventre, Martin, l’un des fils Bédard, comprend que la fuite n’est pas la solution et qu’il doit concilier son lourd passé familial avec sa propre vie. Ici, la guerre devient le symbole du combat intérieur que livre Martin contre ses origines. |
par Guillois-Cardinal, Raphaëlle 16 nov |