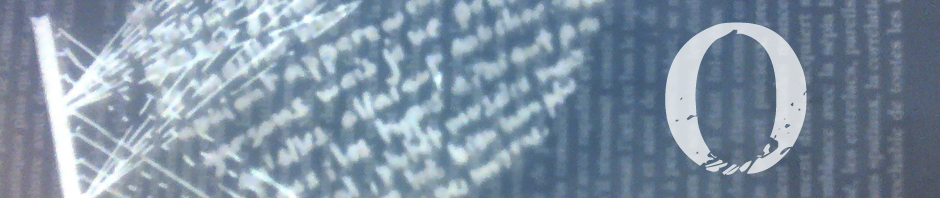In dialogue
Dans « Internet et la culture de la rupture » de notre recueil de textes du séminaire, Patrick J.Brunet développe l’idée d’une rupture, à la fois, communicationnelle et axiologique, induite par Internet. Quand bien même la pratique du web prétend instaurer la communication et l’interactivité à l’échelle mondiale, paradoxalement, elle provoque une rupture avec la linéarité, l’immédiateté et les représentations conventionnelles, soit nos repères. Il va sans dire que notre identité s’en trouve secouée, et par conséquent nos perceptions et notre rapport au monde passent désormais par le truchement des technologies et du virtuel. Ce cyber support instaure un rapport nouveau et différent au monde tout comme l’ère Gutenberg de l’imprimé avait produit une mutation de la conscience. Notre mode de pensée en est chamboulé ce qui favorise, à long terme, le développement d’une pensée globalisante, arborescente, procédant par association et évocation imagées, à l’opposé d’une pensée linéaire, déductive qui suit un processus logique et dialectique et qui est capable de démonstration. Bref, une culture asynchrone de la rupture.
Mais un mode de pensée par l’image, le son en supplément de l’écrit n’est-il pas également plus riche parce que multisensoriel, hybride et pluriel, à l’image de notre époque? Cette densité et épaisseur dialogique et polyphonique du cyber induit l’hypothèse d’une simultanéité multidimensionnelle qui joue, du coup, avec l’idée de la causalité. En effet, la rupture avec une pensée linéaire binaire, logique, consiste peut-être à proposer une nouvelle forme de pensée à plusieurs niveaux. Or, ceci implique un sérieux chamboulement du concept intangible de la causalité ; l’effet étant le résultat d’une cause. Alors que dans l’univers décentré asynchrone et rhizomique de la télé-présence, l’effet en vient, peut en venir, de façon rétrosimultanée, à s’identifier à la cause, l’effet peut-il même précéder la cause?
Pour tenter un dialogue imaginé entre Brunet et Macluhan, voilà ce qu’affirme ce dernier dans La Galaxie Gutenberg : « L’orientation extrêmement visuelle de cette notion de cause apparaît incongrue dans le monde de la simultanéité qu’est celui de l’électricité. » Puis plus loin, « Les sociétés orales ne connaissent pas cette visualisation séquentielle de la chronologie, d’ailleurs devenue désuète à l’âge de la transmission électronique de l’information. »
Mais, de quelle manière fait-il le lien entre la causalité comme perception et l’oralité comme transmission?: « L’écriture a pour effet de substituer aux dimensions acoustiques de l’expérience des dimensions visuelles.» Macluhan n’hésite pas à circuler entre les différents paradigmes (comme des hyperliens) et parle également de cette visualisation comme d’une « conscience tribale acoustique-tactile que l’écriture à l’ère Gutenberg aurait évacué et qui sommeille dans le collectif »
De la même manière, Brunet parle de patchworks d’images, de hip-hop en images, de juxtapositions rythmées et saccadées d’images récupérées, mais sans vraiment faire le lien avec la sonorité ou la voix. Ce que l’oralité a de significatif, c’est sa dimension multidirectionnelle et multidimensionnelle, soit arborescente, simultanée et acausale.
Macluhan multiplie les correspondances, avec par exemple, l’espace architectural et évoque l’orientation multidirectionnelle acoustique et auditive de l’igloo, puis en littérature, il cite John Ruskin (dans Modern Painters) qui explique que le grotesque gothique est le meilleur moyen de renverser le régime de la perspective conventionnelle et de la vision exclusive ancienne, c’est à dire du réalisme, régime instauré par la Renaissance. (Un beau grotesque exprime en un instant, par une suite de symboles enchevêtrés dans une connexité hardie et audacieuse des vérités qui auraient été fort longues à exprimer verbalement et dont la connexité doit être découverte), cette façon de concevoir la chose a profondément intéressé Rimbaud et Proust et a été massivement pratiquée par Joyce. C’est bien la technique des « painted slides », verres peints qui est adoptée par Rimbaud dans ses Illuminations et Joyce, dit, Macluhan admettait une perception simultané, sans point de vue, sans connexité linéaire ou séquentielle.» Bref, sans un fil de l’histoire.
Macluhan voit également la démarche des Symbolistes, à rebours, partant de l’effet vers la cause comme une réaction à la mécanisation de l’ère industrielle et à la production en masse impersonnelle, « les symbolistes ont commencé à façonner la production artistique à rebours en procédant de l’effet vers la cause, avant la champ sans borne du courant de conscience flow of conscience de Joyce et Woolf, ce qui renverse toutes le étapes de la chaîne de montage. »
Macluhan fait le lien constamment entre la révolution industrielle et la révolution technologique post-Gutenberg.
Le protagoniste de Houellebecq, Jed Martins dans La carte et le territoire opposera un art de type hyperréaliste socialiste de la série de Portraits puis des Métiers de France (la carte de l’idéologie néolibéraliste industrielle) à la pratique des superpositions de photographies traitées avec Photoshop (période plus territoire à perception simultanée et décentrée). Effets de mondialisation.
Encore une fois, ce que nous comprenons est que ce hip hop de la perception permet de s’évader de l’exclusivité de la vue causale.
Mais Brunet met en garde contre une possible dérive vers une illusion de puissance défiant le temps et l’espace, selon le concept cybernétique du anywhere, anytime.
Enfin, dans La Galaxie Reconfigurée, Macluhan cite le poète Blake qui explique que l’homme change quand les rapports des sens changent. « Et les rapports des sens changent quand l’un quelconque des sens ou des fonctions corporelles ou mentales se trouvent extériorisé sous forme technologique. Avec cette extériorisation, il existe une interaction globale des expériences. L’homme est alors obligé de regarder ce fragment de lui-même et il est obligé de devenir cette chose nouvelle qu’il aperçoit. »
Plus loin il dit : « Il semble assez normal que toute génération qui vit à la veille d’un changement profond doive plus tard paraître avoir été aveuglée devant les problèmes et les évènements qui la guettaient. Mais il est nécessaire de comprendre l’énergie des technologies et le pouvoir quelles ont d’isoler les sens et par conséquent d’hypnotiser la société. Un seul sens à la fois, telle est la formule de l’hypnotisme, il cite William Blake : elles devinrent ce qu’elles aperçurent (They became what they beheld) Toute nouvelle technologie diminue l’interaction des sens et la conscience, et particulièrement dans le domaine nouveau des innovations ou se produit une sorte d’identification du sujet et de l’objet. En se conformant comme un somnambule à la nouvelle forme ou à la nouvelle structure, le témoin est d’autant moins conscient de la dynamique de la révolution qu’il y est plongé plus profondément.(…) on s’imagine volontiers dans ces circonstances que l’avenir sera une version nouvelle du passé récent en plus grand et en beaucoup mieux. » Et il conclut avec cette pointe crépusculaire et prophétique : « Juste avant cette révolution, l’image de ce passé récent est nette et précise peut-être parce que c’est là le seul domaine d’interaction sensorielle libre d’identification obsessionnelle avec la nouvelle forme technologique. »
Finalement, qu’en est-il de cette question à savoir notre rapport logique et causal au monde en rupture par les technologies. À la « rupture »de Brunet, Macluhan avance l’idée d’un «jugement en suspens ».
Il affirme : « La mécanisation c’est la méthode du point de vue fixe, ou spécialisé selon laquelle la répétition est la pierre de touche de la vérité et du sens pratique. Aujourd’hui la science et la méthode qui sont les nôtres ne tendent pas vers un point de vue, mais s’efforcent plutôt de découvrir comment ne pas avoir de point de vues : ce n’est pas une méthode de bornage et de perspective, mais plutôt de champ ouvert et de jugement en suspens. Cette méthode est désormais la seule valide dans les conditions de mouvement simultané de l’information et d’interdépendance humaine totale que crée l’électricité. »
À méditer.