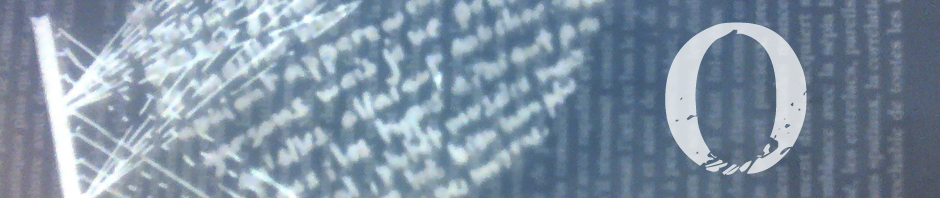L’oralité comme flux accéléré
L’oralité transmue le texte d’objet d’étude en flux et l’utilisateur expérimente une nouvelle conscience du texte, non pas comme objet statique qui s’offre au regard, mais comme mouvement et palimpseste de ce qui n’est déjà plus là. Et nous sommes toujours, un peu, comme spectateur d’une présence posthume, d’une spectralité.
– Mais encore quel rapport peut-on concevoir entre l’oralité et son support technologique; l’humain versus la machine? Dans son essai sur la Narrative Performance, Suman Gupta fait appelle a la célèbre métaphore de la caverne de Platon, il écrit dans son ouvrage intitulé Globalization and Literature : « Our familiarity with global electronic networks and virtual environments which characterizes the new millenium at the portal of which this novell appreared, is prefigured in the Cavern. Protagonists from different disciplines are invited to use this nascent space to realize their visions and advance their understanding of the world. »
Se pourrait-il que le réseau électronique, se présente tel un espace d’initiation rendu public; l’acte d’initiation ne comportant plus la spécificité d’un évènement secret et personnel restreint a un cercle (comme une sudation ou une initiation soufi) mais bien un spectacle d’hybridation et de mutation d’identité collective humain/machine inouï… ainsi nous serions tous des initiés du numérique en différentes phases dévolution (darwinisme?).
J’avance la possibilité de concevoir l’espace numérique en référence aux mythes. Comme à chaque fois que l’Homme est en présence de la nouveauté et de l’inconnu, ressurgissent les images archétypales liées aux origines et notamment à une symbolique archaïque telle que l’espace de la grotte ou l’allégorie de la caverne. L’individu qui intègre cet espace souterrain (utérin) en forme de matrice, berceau, tombe subit une initiation à l’issue de laquelle il acquiert les attributs de tout initié; maitrise des apparences et adéquation avec le flux, soit acceptation de la loi du changement. C’est donc le lieu des manifestations et du jeu des simulacres mort/renaissance, passages/métamorphoses, énigmes et rebus. Transposant la métaphore de la caverne à l’espace numérique, on peut constater la similitude des aspects tels que la virtualité du cyberspace, la perception altérée de l’espace-temps tel qu’il est généralement appréhendé, le sentiment de plénitude, l’affranchissement des limites et la déviance de la logique de la causalité. Ceci me semble-t-il induit des mutations réelles de la conscience et reconfigure une certaine perspective du réel qui m’a paru être en rapport direct avec l’intrusion de la machine dans le champ de ma conscience. Je ne peux faire autrement que me mettre moi-même dans mon champ d’observation, comme l’a si joliment dit Luis dans son commentaire, et j’ajouterai d’expérience. Par un effet visuel propre aux formes concaves (telle que la grotte) une forme holographique tierce semble se constituer dans l’espace cybernétique qui propose une réalité virtuelle à laquelle peuvent très bien adhérés les utilisateurs et de façon massive. Je cite un extrait : « Les prisonniers de la caverne ne se sentent pas prisonniers, ils pensent que leur mode de vie est la vraie vie, ce qu’ils voient constituent pour eux le réel, les ombres sont réelles (…) La délivrance de l’un des prisonniers lui permet de découvrir la vérité, une fois délivré il accède à la jouissance ». Par exemple, on a parlé du rôle prépondérant joué par les réseaux sociaux et l’espace cybernétique en général dans l’amplification puis la victoire des révolutions du printemps arabes ou des manifs du Carré rouge ou encore du mouvement des Indignés, leur impact a semble-t-il été fondamentale sur ces évènements. Des sentiments de désir de liberté, de vérité et d’élan de jouissance ont exalté les foules. Tout autant emportées par des aspects narcissiques, mimétiques et une volonté de puissance. Je pense que le même processus initiatique (ou on pourrait dire cathartique) se produit sur le plan individuel.
Les slogans scandés rendent comptent d’une parole vernaculaire, dans le sens de desinstitutionalisée, détachée du canon, populaire et matricielle puisque créative comme une polyphonie bakhtinienne parce que plurielle, cathartique, parodique et jouant de la performance et qui traverse le texte ou l’espace physique pour advenir dans l’espace numérique amplifié comme un futur prochain, se reflétant en myriades sur les parois de la caverne de glace.
La littérature nous permet, ainsi, d’entendre la réalité de nos voix posthumes, ce que nous avons été et ce que fut le monde. Ce qui advient ce sont les voix que nous avons hallucinées, les voix qui nous ont parlés dans leurs fréquences et leurs vibrations.
Peut-être est-il intéressant dans notre quête d’une connexion humain/machine d’évoquer ici, le flux deleuzien. Le flux charrie des strates qui sont reliées par des phénomènes de déterritorialisation et d’accélération, véritables nœuds articulés en rhizome. Capteurs de résonnances et d’emboitement d’univers, ces nœuds se comportent comme des carrefours de communication ou des hyperliens accélérateurs de flux électromagnétique lié au passé, mais déferlant vers le devenir, nous précédant comme des vagues sur lesquelles on surferait.
Le langage plonge, alors, dans toutes les strates jusqu’au minéral et à l’inorganique… se déterritorialise jusqu’à la machine.
Par sa trop prégnante présence l’oralité, ne faisant pas l’affaire des structuralistes, a été évacuée de leur domaine d’études. Mais pourquoi? Est-ce parce que la parole échappe à l’arbitraire du signe et défie toute scission entre le signifiant et le signifié, se comportant, du coup, comme un signe plein (sans médiation)? La parole ne se prête pas à l’analyse structuraliste de la langue, car elle constitue un usage subjectif que l’usager fait du langage. Je me demande si on peut faire le lien entre l’oralité comme fait de parole et comme fait de performance. La parole de l’artiste ou la parole politique (les slogans des manifs) sont-ils des faits de parole et de performance? Leur sens n’est-il pas davantage dans leur impact émotif et dans leur pouvoir d’identification?
Le danger qui guette le nouvel initié du cyberspace serait de se perdre dans les abysses du sens, sorte de mimesis numérique ou de démon de la tautologie induit par le pouvoir réflexif du langage et l’identification avec l’Autre (le locuteur).
L’accélération, la mise à distance et la vision kaléidoscopique de la conscience du temps, la déviance par rapport à la loi de causalité produisent le paradoxe suivant : l’ici/maintenant d’une communauté virtuel s’actualise comme évènement aléatoire et hypothétique d’un là-bas/futur d’une autre communauté. Ce phénomène est singulier, car il dit beaucoup de choses sur le réel et le pouvoir de l’écrit-oral que nous pratiquons sur le réseau. Si la parole-pensée-action que je produis ici/maintenant se réalise ou s’actualise entièrement ou comme conséquence, ailleurs, de façon contingente et aléatoire comment puis-je appréhender l’idée de responsabilité? Mais, encore, suis-je moi-même le produit d’une volonté virtuelle autre indépendante de moi? Suis-je le rêve de quelqu’un d’autre?
Une seconde altération de la conscience se produit; la sensation d’éternité du temps et de la présence, mais aussi d’une dualité du temps comme élément physique et réel, d’une part, et comme élément subjectif et de fiction, d’autre part. Et ces deux flux de temps sont comme réfractés l’un dans l’autre et interagissent en différé. Le réel semble en congruence avec le fictionnel; en rhizome; le jumeau voyageur rejoint son jumeau terrestre pour former une vision dédoublée.
Par accélération vertigineuse, ce que nous disons, lisons est déjà lu, dit, vu; seulement par instants fulgurants la sensation du déjà-vu transparait à travers les interstices; en fait c’est nous qui sommes lus et vus, qui sommes des déjà-vus, copies de nous-mêmes projetées dans le flux même de la vie et que nous pouvons parfois saisir comme Borges rencontrait dans Le livre de sable son double, le vieil homme qu’il adviendra.
Nous voici retourné à …. O… ceci est un décentrement, sans début ni fin, ceci est le centre – un vide holographique.
Dans cet espace rendu visible par le numérique, nous assisterons peut-être à des germinations virtuelles du réel induites par nos paroles et nos pensées numériques. Des germinations dans l’obscure du réel qui n’ont pas encore basculé en représentations. Si tel est le cas, la responsabilité de ce que nous transmettons, ce que nous laissons en germes d’un futur probable, ici ou ailleurs, pose également une question d’éthique et de conscience.