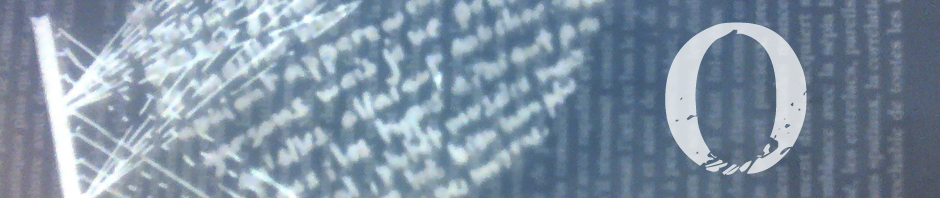Leibniz, la pensée sauvage et les nouvelles technologies
On imagine l’espace cybernétique comme un espace déterritorialisé et décentré, pourtant il est pris dans un dispositif algorithmique. Le langage algorithmique, mot qui vient du nom du mathématicien perse Al Khawarizmi, « père de l’algèbre », est un langage de permutation, combinatoire qui est à la base de tous les langages de programmation. En littérature, certains écrivains ont fait usage de structures linguistiques artificielles avec une approche mathématique et algorithmique, c’est l’expérience des oulipiens. Leur pratique n’a pas manqué de trouver des résonances avec les possibilités littéraires combinatoires qu’offrait le numérique. Quels liens peut-on observer entre le langage algorithmique et la contrainte oulipienne?
Je me pose cette question dans le cadre d’une réflexion sur les rapports que peuvent entretenir la littérature et les nouvelles technologies. Je pars d’une intuition qui me permet de faire l’hypothèse suivante : l’espace romanesque se base, également, sur une pensée algorithmique, donc computationnelle et par surcroît matérialiste. Une deuxième intuition me permet de dire que cette démarche qui parait être d’une grande scientificité, dans le sens où elle semble être régie par des lois générales et abstraites, est en fait une pensée de bricolage par excellence, à l’instar de la pensée sauvage de Claude Levy Strauss.
Je me propose, tout de suite, d’éclairer mon propos qui se base sur quelques lectures. Dans « Fictions, De l’introduction d’une méthode littéraire en philosophie » l’auteure Christiane Frémont déconstruit la pensée de Leibniz, grand savant et mathématicien du 18e siècle, et avance que sa pensée était de type algorithmique, « par un art d’inventer qui cherche à chaque fois la solution la plus appropriée à un problème (…), il autorise même des faussetés utiles pour trouver la vérité. La fécondité de la méthode apparaît dans des problèmes mixtes et ne refuse ni l’inattendu ni le paradoxe. » Planchant sur des problèmes mathématiques, le philosophe s’autorise des simulations pour vérifier ses hypothèses. Il considère que ces singularités mathématiques ont quelque chose qui relève de la fiction et de l’imaginaire. Ainsi pour appréhender l’incompréhensible, Leibniz se sert de fictions, « ces historiettes parsèment la pensée discursive comme font les êtres fictifs dans les mathématiques, comme des algorithmes auxquels on a recours quand on ne sait pas résoudre un problème. » L’auteure en tire la conclusion que la méthode des fictions appartient à la pensée algorithmique. Celle qui accepte de « s’écarter du grand chemin pour trouver quelque chose ».
L’insertion de digressions fictives indique l’intrusion d’une pensée algorithmique dans la logique universelle. En effet, Leibniz avait adopté une pensée pluraliste, critique vis-à-vis de Descartes et du principe premier « je pense donc je suis », pour lui « les vérités de fait sont fondés, non seulement, sur le cogito mais aussi sur la diversité de l’expérience ». Le philosophe Deleuze avait soutenu dans son ouvrage Le Pli que Leibniz était un grand baroque, car tout chez lui se plie et se déplie. La période baroque était ce monde « où tous les contraires seraient harmonieusement possibles », une époque entre-deux, païenne, profane ou résonne, peut-être, le carnavalesque médiéval de Bakhtine.
Est-ce qu’on peut en déduire que la fiction, elle-même, s’articule selon des combinaisons algorithmiques? La littérature se comporte, d’une part, comme un art codifié et d’autre part, comme une pratique qui s’écarte du code, cherche à s’en libérer. Dans Éloge de la philosophie Michel Serres souligne l’appartenance de la pensée algorithmique aux cultures sémitiques du récit. La rhétorique sémitique étant une forme de composition littéraire propre aux textes bibliques ou coraniques et elle se différencie de la rhétorique grecque. Cette rhétorique sémitique se caractérise par des constructions qui obéissent au principe de la symétrie, sous forme de parallélisme, d’effet miroir ou encore de chiasme. Peut-on extrapoler et prétendre que la forme algorithmique en est une propre aux métarécits archétypaux? Comment apprécier, dans tout cela, la part du codifié et celle de la liberté?
Homo sapiens est-il sur le voie de devenir homo numérus? En tout cas, il est resté tout aussi bricoleur. L’anthropologue Claude Lévi Strauss, dans un passage de son livre « La pensée sauvage » a soutenu l’idée selon laquelle le travail de sauvage qu’est le bricolage est tout aussi valable comme procédé d’invention que la pensée scientifique moderne. Il a appelé cette forme de processus cognitif la pensée mythique, celle qui prédominait chez les populations dites primitives, « cette pensée mythique bricole », dit-il. Elle prend ce qui lui tombe sous la main et elle se construit au gré des opportunités. La pensée scientifique est certainement plus avancée, car elle dispose de nombreux matériaux et outils. Mais, dit Lévi Strauss « Ne nous y trompons pas : il ne s’agit pas de deux stades, ou de deux phases de l’évolution du savoir, car les deux démarches sont également valides ». Il n’y a pas contradiction, mais complémentarité entre ces deux niveaux. Le bricolage intuitif et la scientificité rationnelle sont tout autant valorisés par le célèbre anthropologue. Comme sur le web, il est question de combiner le dispositif rationnel avec la libre créativité où les connexions imprévues, l’émotionnel, l’intuitif et l’artistique ont toute leur place. À l’instar des historiettes algorithmiques chez le mathématicien Leibniz.
Et à la question de savoir si Homo sapiens bricoleur est-il devenu homo numerus algorithmique que nous nous posons, Lévi-Strauss répond « …Mais il y a plus : la poésie du bricolage lui vient aussi, et surtout, de ce qu’il ne se borne pas à accomplir ou exécuter ; il raconte (…) le caractère et la vie de son auteur. Sans jamais remplir son projet, le bricoleur y met toujours quelque chose de soi. »
Ce bricolage, cette réinvention du monde par l’imagination qui transforme le réel insaisissable en contes, récits, peinture et romans, n’est-ce pas ce qui fait de nous, aussi et avant tout, comme dit l’écrivaine Nancy Huston « l’espèce fabulatrice » par excellence.