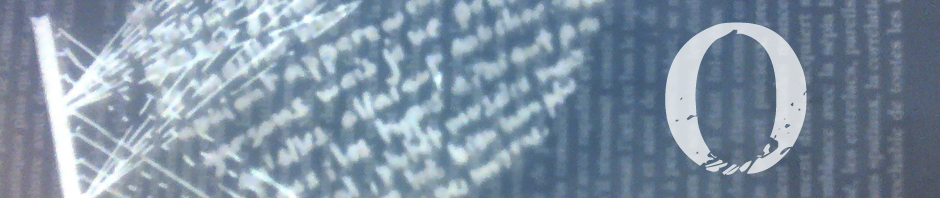Follow Me
-
Articles récents
Commentaires récents
- Jeremy Boivert dans La carte ou le territoire?
- Why should i o it dans La carte ou le territoire?
- liliabitar dans O
- luisloyagarcia dans O
Archives
Catégories
Méta
test youtube
Publié dans Non classé
Laisser un commentaire
Leibniz, la pensée sauvage et les nouvelles technologies
Leibniz, la pensée sauvage et les nouvelles technologies
On imagine l’espace cybernétique comme un espace déterritorialisé et décentré, pourtant il est pris dans un dispositif algorithmique. Le langage algorithmique, mot qui vient du nom du mathématicien perse Al Khawarizmi, « père de l’algèbre », est un langage de permutation, combinatoire qui est à la base de tous les langages de programmation. En littérature, certains écrivains ont fait usage de structures linguistiques artificielles avec une approche mathématique et algorithmique, c’est l’expérience des oulipiens. Leur pratique n’a pas manqué de trouver des résonances avec les possibilités littéraires combinatoires qu’offrait le numérique. Quels liens peut-on observer entre le langage algorithmique et la contrainte oulipienne?
Je me pose cette question dans le cadre d’une réflexion sur les rapports que peuvent entretenir la littérature et les nouvelles technologies. Je pars d’une intuition qui me permet de faire l’hypothèse suivante : l’espace romanesque se base, également, sur une pensée algorithmique, donc computationnelle et par surcroît matérialiste. Une deuxième intuition me permet de dire que cette démarche qui parait être d’une grande scientificité, dans le sens où elle semble être régie par des lois générales et abstraites, est en fait une pensée de bricolage par excellence, à l’instar de la pensée sauvage de Claude Levy Strauss.
Je me propose, tout de suite, d’éclairer mon propos qui se base sur quelques lectures. Dans « Fictions, De l’introduction d’une méthode littéraire en philosophie » l’auteure Christiane Frémont déconstruit la pensée de Leibniz, grand savant et mathématicien du 18e siècle, et avance que sa pensée était de type algorithmique, « par un art d’inventer qui cherche à chaque fois la solution la plus appropriée à un problème (…), il autorise même des faussetés utiles pour trouver la vérité. La fécondité de la méthode apparaît dans des problèmes mixtes et ne refuse ni l’inattendu ni le paradoxe. » Planchant sur des problèmes mathématiques, le philosophe s’autorise des simulations pour vérifier ses hypothèses. Il considère que ces singularités mathématiques ont quelque chose qui relève de la fiction et de l’imaginaire. Ainsi pour appréhender l’incompréhensible, Leibniz se sert de fictions, « ces historiettes parsèment la pensée discursive comme font les êtres fictifs dans les mathématiques, comme des algorithmes auxquels on a recours quand on ne sait pas résoudre un problème. » L’auteure en tire la conclusion que la méthode des fictions appartient à la pensée algorithmique. Celle qui accepte de « s’écarter du grand chemin pour trouver quelque chose ».
L’insertion de digressions fictives indique l’intrusion d’une pensée algorithmique dans la logique universelle. En effet, Leibniz avait adopté une pensée pluraliste, critique vis-à-vis de Descartes et du principe premier « je pense donc je suis », pour lui « les vérités de fait sont fondés, non seulement, sur le cogito mais aussi sur la diversité de l’expérience ». Le philosophe Deleuze avait soutenu dans son ouvrage Le Pli que Leibniz était un grand baroque, car tout chez lui se plie et se déplie. La période baroque était ce monde « où tous les contraires seraient harmonieusement possibles », une époque entre-deux, païenne, profane ou résonne, peut-être, le carnavalesque médiéval de Bakhtine.
Est-ce qu’on peut en déduire que la fiction, elle-même, s’articule selon des combinaisons algorithmiques? La littérature se comporte, d’une part, comme un art codifié et d’autre part, comme une pratique qui s’écarte du code, cherche à s’en libérer. Dans Éloge de la philosophie Michel Serres souligne l’appartenance de la pensée algorithmique aux cultures sémitiques du récit. La rhétorique sémitique étant une forme de composition littéraire propre aux textes bibliques ou coraniques et elle se différencie de la rhétorique grecque. Cette rhétorique sémitique se caractérise par des constructions qui obéissent au principe de la symétrie, sous forme de parallélisme, d’effet miroir ou encore de chiasme. Peut-on extrapoler et prétendre que la forme algorithmique en est une propre aux métarécits archétypaux? Comment apprécier, dans tout cela, la part du codifié et celle de la liberté?
Homo sapiens est-il sur le voie de devenir homo numérus? En tout cas, il est resté tout aussi bricoleur. L’anthropologue Claude Lévi Strauss, dans un passage de son livre « La pensée sauvage » a soutenu l’idée selon laquelle le travail de sauvage qu’est le bricolage est tout aussi valable comme procédé d’invention que la pensée scientifique moderne. Il a appelé cette forme de processus cognitif la pensée mythique, celle qui prédominait chez les populations dites primitives, « cette pensée mythique bricole », dit-il. Elle prend ce qui lui tombe sous la main et elle se construit au gré des opportunités. La pensée scientifique est certainement plus avancée, car elle dispose de nombreux matériaux et outils. Mais, dit Lévi Strauss « Ne nous y trompons pas : il ne s’agit pas de deux stades, ou de deux phases de l’évolution du savoir, car les deux démarches sont également valides ». Il n’y a pas contradiction, mais complémentarité entre ces deux niveaux. Le bricolage intuitif et la scientificité rationnelle sont tout autant valorisés par le célèbre anthropologue. Comme sur le web, il est question de combiner le dispositif rationnel avec la libre créativité où les connexions imprévues, l’émotionnel, l’intuitif et l’artistique ont toute leur place. À l’instar des historiettes algorithmiques chez le mathématicien Leibniz.
Et à la question de savoir si Homo sapiens bricoleur est-il devenu homo numerus algorithmique que nous nous posons, Lévi-Strauss répond « …Mais il y a plus : la poésie du bricolage lui vient aussi, et surtout, de ce qu’il ne se borne pas à accomplir ou exécuter ; il raconte (…) le caractère et la vie de son auteur. Sans jamais remplir son projet, le bricoleur y met toujours quelque chose de soi. »
Ce bricolage, cette réinvention du monde par l’imagination qui transforme le réel insaisissable en contes, récits, peinture et romans, n’est-ce pas ce qui fait de nous, aussi et avant tout, comme dit l’écrivaine Nancy Huston « l’espèce fabulatrice » par excellence.
Publié dans Non classé
Laisser un commentaire
In dialogue
In dialogue
Dans « Internet et la culture de la rupture » de notre recueil de textes du séminaire, Patrick J.Brunet développe l’idée d’une rupture, à la fois, communicationnelle et axiologique, induite par Internet. Quand bien même la pratique du web prétend instaurer la communication et l’interactivité à l’échelle mondiale, paradoxalement, elle provoque une rupture avec la linéarité, l’immédiateté et les représentations conventionnelles, soit nos repères. Il va sans dire que notre identité s’en trouve secouée, et par conséquent nos perceptions et notre rapport au monde passent désormais par le truchement des technologies et du virtuel. Ce cyber support instaure un rapport nouveau et différent au monde tout comme l’ère Gutenberg de l’imprimé avait produit une mutation de la conscience. Notre mode de pensée en est chamboulé ce qui favorise, à long terme, le développement d’une pensée globalisante, arborescente, procédant par association et évocation imagées, à l’opposé d’une pensée linéaire, déductive qui suit un processus logique et dialectique et qui est capable de démonstration. Bref, une culture asynchrone de la rupture.
Mais un mode de pensée par l’image, le son en supplément de l’écrit n’est-il pas également plus riche parce que multisensoriel, hybride et pluriel, à l’image de notre époque? Cette densité et épaisseur dialogique et polyphonique du cyber induit l’hypothèse d’une simultanéité multidimensionnelle qui joue, du coup, avec l’idée de la causalité. En effet, la rupture avec une pensée linéaire binaire, logique, consiste peut-être à proposer une nouvelle forme de pensée à plusieurs niveaux. Or, ceci implique un sérieux chamboulement du concept intangible de la causalité ; l’effet étant le résultat d’une cause. Alors que dans l’univers décentré asynchrone et rhizomique de la télé-présence, l’effet en vient, peut en venir, de façon rétrosimultanée, à s’identifier à la cause, l’effet peut-il même précéder la cause?
Pour tenter un dialogue imaginé entre Brunet et Macluhan, voilà ce qu’affirme ce dernier dans La Galaxie Gutenberg : « L’orientation extrêmement visuelle de cette notion de cause apparaît incongrue dans le monde de la simultanéité qu’est celui de l’électricité. » Puis plus loin, « Les sociétés orales ne connaissent pas cette visualisation séquentielle de la chronologie, d’ailleurs devenue désuète à l’âge de la transmission électronique de l’information. »
Mais, de quelle manière fait-il le lien entre la causalité comme perception et l’oralité comme transmission?: « L’écriture a pour effet de substituer aux dimensions acoustiques de l’expérience des dimensions visuelles.» Macluhan n’hésite pas à circuler entre les différents paradigmes (comme des hyperliens) et parle également de cette visualisation comme d’une « conscience tribale acoustique-tactile que l’écriture à l’ère Gutenberg aurait évacué et qui sommeille dans le collectif »
De la même manière, Brunet parle de patchworks d’images, de hip-hop en images, de juxtapositions rythmées et saccadées d’images récupérées, mais sans vraiment faire le lien avec la sonorité ou la voix. Ce que l’oralité a de significatif, c’est sa dimension multidirectionnelle et multidimensionnelle, soit arborescente, simultanée et acausale.
Macluhan multiplie les correspondances, avec par exemple, l’espace architectural et évoque l’orientation multidirectionnelle acoustique et auditive de l’igloo, puis en littérature, il cite John Ruskin (dans Modern Painters) qui explique que le grotesque gothique est le meilleur moyen de renverser le régime de la perspective conventionnelle et de la vision exclusive ancienne, c’est à dire du réalisme, régime instauré par la Renaissance. (Un beau grotesque exprime en un instant, par une suite de symboles enchevêtrés dans une connexité hardie et audacieuse des vérités qui auraient été fort longues à exprimer verbalement et dont la connexité doit être découverte), cette façon de concevoir la chose a profondément intéressé Rimbaud et Proust et a été massivement pratiquée par Joyce. C’est bien la technique des « painted slides », verres peints qui est adoptée par Rimbaud dans ses Illuminations et Joyce, dit, Macluhan admettait une perception simultané, sans point de vue, sans connexité linéaire ou séquentielle.» Bref, sans un fil de l’histoire.
Macluhan voit également la démarche des Symbolistes, à rebours, partant de l’effet vers la cause comme une réaction à la mécanisation de l’ère industrielle et à la production en masse impersonnelle, « les symbolistes ont commencé à façonner la production artistique à rebours en procédant de l’effet vers la cause, avant la champ sans borne du courant de conscience flow of conscience de Joyce et Woolf, ce qui renverse toutes le étapes de la chaîne de montage. »
Macluhan fait le lien constamment entre la révolution industrielle et la révolution technologique post-Gutenberg.
Le protagoniste de Houellebecq, Jed Martins dans La carte et le territoire opposera un art de type hyperréaliste socialiste de la série de Portraits puis des Métiers de France (la carte de l’idéologie néolibéraliste industrielle) à la pratique des superpositions de photographies traitées avec Photoshop (période plus territoire à perception simultanée et décentrée). Effets de mondialisation.
Encore une fois, ce que nous comprenons est que ce hip hop de la perception permet de s’évader de l’exclusivité de la vue causale.
Mais Brunet met en garde contre une possible dérive vers une illusion de puissance défiant le temps et l’espace, selon le concept cybernétique du anywhere, anytime.
Enfin, dans La Galaxie Reconfigurée, Macluhan cite le poète Blake qui explique que l’homme change quand les rapports des sens changent. « Et les rapports des sens changent quand l’un quelconque des sens ou des fonctions corporelles ou mentales se trouvent extériorisé sous forme technologique. Avec cette extériorisation, il existe une interaction globale des expériences. L’homme est alors obligé de regarder ce fragment de lui-même et il est obligé de devenir cette chose nouvelle qu’il aperçoit. »
Plus loin il dit : « Il semble assez normal que toute génération qui vit à la veille d’un changement profond doive plus tard paraître avoir été aveuglée devant les problèmes et les évènements qui la guettaient. Mais il est nécessaire de comprendre l’énergie des technologies et le pouvoir quelles ont d’isoler les sens et par conséquent d’hypnotiser la société. Un seul sens à la fois, telle est la formule de l’hypnotisme, il cite William Blake : elles devinrent ce qu’elles aperçurent (They became what they beheld) Toute nouvelle technologie diminue l’interaction des sens et la conscience, et particulièrement dans le domaine nouveau des innovations ou se produit une sorte d’identification du sujet et de l’objet. En se conformant comme un somnambule à la nouvelle forme ou à la nouvelle structure, le témoin est d’autant moins conscient de la dynamique de la révolution qu’il y est plongé plus profondément.(…) on s’imagine volontiers dans ces circonstances que l’avenir sera une version nouvelle du passé récent en plus grand et en beaucoup mieux. » Et il conclut avec cette pointe crépusculaire et prophétique : « Juste avant cette révolution, l’image de ce passé récent est nette et précise peut-être parce que c’est là le seul domaine d’interaction sensorielle libre d’identification obsessionnelle avec la nouvelle forme technologique. »
Finalement, qu’en est-il de cette question à savoir notre rapport logique et causal au monde en rupture par les technologies. À la « rupture »de Brunet, Macluhan avance l’idée d’un «jugement en suspens ».
Il affirme : « La mécanisation c’est la méthode du point de vue fixe, ou spécialisé selon laquelle la répétition est la pierre de touche de la vérité et du sens pratique. Aujourd’hui la science et la méthode qui sont les nôtres ne tendent pas vers un point de vue, mais s’efforcent plutôt de découvrir comment ne pas avoir de point de vues : ce n’est pas une méthode de bornage et de perspective, mais plutôt de champ ouvert et de jugement en suspens. Cette méthode est désormais la seule valide dans les conditions de mouvement simultané de l’information et d’interdépendance humaine totale que crée l’électricité. »
À méditer.
Publié dans Non classé
Laisser un commentaire
La carte ou le territoire?
La carte ou le territoire?
Considérer le texte non plus comme objet, mais comme flux et mouvement. Tel est le territoire. Si, dans le passé, territoire et carte ne pouvaient se trouver en congruence par la différence de la nature de leurs supports respectifs, aujourd’hui nous assistons à ce phénomène inouï; carte et territoire coïncident par leur affiliation à un médiateur commun: le flux.
Flux électromagnétique pour la représentation mentale de la carte (virtualisation de concepts sur le web) et flux minéral et organique pour la représentation (ou l’existence réelle et concrète) du territoire.
La cognition mentale étant projetée à l’extérieur, rendue visible, dynamique, interactive, démultipliée et en accélérée dans l’espace cybernétique.
Flux électromagnétique et flux organique entrent en résonance formant un flux tiers évacuant de ce fait l’idée de binarité entre carte et territoire.
Mais, on ne se baigne pas deux fois dans la même eau, toute parole est, de ce fait, différence parce que différée, nous avons bien dit cela, mais le contexte était différent, n’est plus le même, le contexte est hors la parole, extralinguistique, extra-spatial même, doublement, différée dans un premier temps par l’espace concret ou ses capsules temporelles et dans un deuxième temps par l’espace ou les espaces cybernétiques. On parlera alors d’autres dimensions comme de territoires vierges à découvrir. La parole est, alors, hors soi, sans demeure; elle devient acte sporadique et désincarné. C’est à dire que le territoire est bien là comme flux mouvant et continuel mais c’est l’acte singulier de nous immerger dans ce flux/territoire/ réel qui est un évènement, un moment d’intrusion/de reconfiguration/de présence qui tente de s’approprier, marquer le moment. Ces plongées en apnée sont, à chaque fois, à recommencer puisque non reproduisibles, uniques et éphémères.
Les multitudes de copies d’objet à l’ère de la reproduction laissent filer leurs auralités.
De la vient l’idée d’art numérique fluide qui s’inscrit comme évènement/performance/happening direct et non reproduisible. Le médium a changé la donne. Le médium est le territoire, il est flux.
J’en suis venue dans le cadre de mes études, à la lecture du texte de Michel Houellebecq intitulé, La carte et le territoire, et me suis amusée à écouter les voix du roman, ses oralités, ensuite j’ai essayé une transposition de la première scène du roman, Jed Martins en train de retoucher son tableau, sous forme de poésie sonore. L’idée m’est apparue réalisable suite à la conférence de Stéfan Sinclair à laquelle nous avons assisté, Fou(illes) de textes littéraires …, le conférencier nous invitait à nous demander; fouiller le texte, relever ses récurrences, ses « triggers », à la recherche de quoi, que cherche-t-on? La poésie sonore peut-elle entrer en résonance avec le texte et cultiver les récurrences comme des sonorités rythmiques? Sonorités répétitives qui déclenchent certains affects, une certaine présence de la corporéité de la voix. Par la polyphonie, la sonorité musicale et les jeux des récurrences se profile le corps vocal du texte littéraire.
Une incarnation incantatoire et sporadique dans l’espace du web?
L’enregistrement suivant est intitulé NOLOVE (le chauffe-eau est en panne); il reprend en poème sonore la première scène du roman La carte et le territoire de l’écrivain français Michel Houellebecq. La scène représente un peintre, Jed Martins en train de retoucher le front luisant de Jeff Koons, alors qu’une corbeille de fruits barthienne est posée sur une table basse, au loin se profilent des immeubles babéliens, luxe sur papier glacé…mais le chauffe-eau tombe en panne et le froid envahit l’atelier.
L’enregistrement est accompagné d’une musique de Samiyam et Gregory Fabre m’a aidé à réaliser mon premier poème sonore.
Bonne écoute.
Publié dans Non classé
2 commentaires
L’oralité comme flux accéléré
L’oralité comme flux accéléré
L’oralité transmue le texte d’objet d’étude en flux et l’utilisateur expérimente une nouvelle conscience du texte, non pas comme objet statique qui s’offre au regard, mais comme mouvement et palimpseste de ce qui n’est déjà plus là. Et nous sommes toujours, un peu, comme spectateur d’une présence posthume, d’une spectralité.
– Mais encore quel rapport peut-on concevoir entre l’oralité et son support technologique; l’humain versus la machine? Dans son essai sur la Narrative Performance, Suman Gupta fait appelle a la célèbre métaphore de la caverne de Platon, il écrit dans son ouvrage intitulé Globalization and Literature : « Our familiarity with global electronic networks and virtual environments which characterizes the new millenium at the portal of which this novell appreared, is prefigured in the Cavern. Protagonists from different disciplines are invited to use this nascent space to realize their visions and advance their understanding of the world. »
Se pourrait-il que le réseau électronique, se présente tel un espace d’initiation rendu public; l’acte d’initiation ne comportant plus la spécificité d’un évènement secret et personnel restreint a un cercle (comme une sudation ou une initiation soufi) mais bien un spectacle d’hybridation et de mutation d’identité collective humain/machine inouï… ainsi nous serions tous des initiés du numérique en différentes phases dévolution (darwinisme?).
J’avance la possibilité de concevoir l’espace numérique en référence aux mythes. Comme à chaque fois que l’Homme est en présence de la nouveauté et de l’inconnu, ressurgissent les images archétypales liées aux origines et notamment à une symbolique archaïque telle que l’espace de la grotte ou l’allégorie de la caverne. L’individu qui intègre cet espace souterrain (utérin) en forme de matrice, berceau, tombe subit une initiation à l’issue de laquelle il acquiert les attributs de tout initié; maitrise des apparences et adéquation avec le flux, soit acceptation de la loi du changement. C’est donc le lieu des manifestations et du jeu des simulacres mort/renaissance, passages/métamorphoses, énigmes et rebus. Transposant la métaphore de la caverne à l’espace numérique, on peut constater la similitude des aspects tels que la virtualité du cyberspace, la perception altérée de l’espace-temps tel qu’il est généralement appréhendé, le sentiment de plénitude, l’affranchissement des limites et la déviance de la logique de la causalité. Ceci me semble-t-il induit des mutations réelles de la conscience et reconfigure une certaine perspective du réel qui m’a paru être en rapport direct avec l’intrusion de la machine dans le champ de ma conscience. Je ne peux faire autrement que me mettre moi-même dans mon champ d’observation, comme l’a si joliment dit Luis dans son commentaire, et j’ajouterai d’expérience. Par un effet visuel propre aux formes concaves (telle que la grotte) une forme holographique tierce semble se constituer dans l’espace cybernétique qui propose une réalité virtuelle à laquelle peuvent très bien adhérés les utilisateurs et de façon massive. Je cite un extrait : « Les prisonniers de la caverne ne se sentent pas prisonniers, ils pensent que leur mode de vie est la vraie vie, ce qu’ils voient constituent pour eux le réel, les ombres sont réelles (…) La délivrance de l’un des prisonniers lui permet de découvrir la vérité, une fois délivré il accède à la jouissance ». Par exemple, on a parlé du rôle prépondérant joué par les réseaux sociaux et l’espace cybernétique en général dans l’amplification puis la victoire des révolutions du printemps arabes ou des manifs du Carré rouge ou encore du mouvement des Indignés, leur impact a semble-t-il été fondamentale sur ces évènements. Des sentiments de désir de liberté, de vérité et d’élan de jouissance ont exalté les foules. Tout autant emportées par des aspects narcissiques, mimétiques et une volonté de puissance. Je pense que le même processus initiatique (ou on pourrait dire cathartique) se produit sur le plan individuel.
Les slogans scandés rendent comptent d’une parole vernaculaire, dans le sens de desinstitutionalisée, détachée du canon, populaire et matricielle puisque créative comme une polyphonie bakhtinienne parce que plurielle, cathartique, parodique et jouant de la performance et qui traverse le texte ou l’espace physique pour advenir dans l’espace numérique amplifié comme un futur prochain, se reflétant en myriades sur les parois de la caverne de glace.
La littérature nous permet, ainsi, d’entendre la réalité de nos voix posthumes, ce que nous avons été et ce que fut le monde. Ce qui advient ce sont les voix que nous avons hallucinées, les voix qui nous ont parlés dans leurs fréquences et leurs vibrations.
Peut-être est-il intéressant dans notre quête d’une connexion humain/machine d’évoquer ici, le flux deleuzien. Le flux charrie des strates qui sont reliées par des phénomènes de déterritorialisation et d’accélération, véritables nœuds articulés en rhizome. Capteurs de résonnances et d’emboitement d’univers, ces nœuds se comportent comme des carrefours de communication ou des hyperliens accélérateurs de flux électromagnétique lié au passé, mais déferlant vers le devenir, nous précédant comme des vagues sur lesquelles on surferait.
Le langage plonge, alors, dans toutes les strates jusqu’au minéral et à l’inorganique… se déterritorialise jusqu’à la machine.
Par sa trop prégnante présence l’oralité, ne faisant pas l’affaire des structuralistes, a été évacuée de leur domaine d’études. Mais pourquoi? Est-ce parce que la parole échappe à l’arbitraire du signe et défie toute scission entre le signifiant et le signifié, se comportant, du coup, comme un signe plein (sans médiation)? La parole ne se prête pas à l’analyse structuraliste de la langue, car elle constitue un usage subjectif que l’usager fait du langage. Je me demande si on peut faire le lien entre l’oralité comme fait de parole et comme fait de performance. La parole de l’artiste ou la parole politique (les slogans des manifs) sont-ils des faits de parole et de performance? Leur sens n’est-il pas davantage dans leur impact émotif et dans leur pouvoir d’identification?
Le danger qui guette le nouvel initié du cyberspace serait de se perdre dans les abysses du sens, sorte de mimesis numérique ou de démon de la tautologie induit par le pouvoir réflexif du langage et l’identification avec l’Autre (le locuteur).
L’accélération, la mise à distance et la vision kaléidoscopique de la conscience du temps, la déviance par rapport à la loi de causalité produisent le paradoxe suivant : l’ici/maintenant d’une communauté virtuel s’actualise comme évènement aléatoire et hypothétique d’un là-bas/futur d’une autre communauté. Ce phénomène est singulier, car il dit beaucoup de choses sur le réel et le pouvoir de l’écrit-oral que nous pratiquons sur le réseau. Si la parole-pensée-action que je produis ici/maintenant se réalise ou s’actualise entièrement ou comme conséquence, ailleurs, de façon contingente et aléatoire comment puis-je appréhender l’idée de responsabilité? Mais, encore, suis-je moi-même le produit d’une volonté virtuelle autre indépendante de moi? Suis-je le rêve de quelqu’un d’autre?
Une seconde altération de la conscience se produit; la sensation d’éternité du temps et de la présence, mais aussi d’une dualité du temps comme élément physique et réel, d’une part, et comme élément subjectif et de fiction, d’autre part. Et ces deux flux de temps sont comme réfractés l’un dans l’autre et interagissent en différé. Le réel semble en congruence avec le fictionnel; en rhizome; le jumeau voyageur rejoint son jumeau terrestre pour former une vision dédoublée.
Par accélération vertigineuse, ce que nous disons, lisons est déjà lu, dit, vu; seulement par instants fulgurants la sensation du déjà-vu transparait à travers les interstices; en fait c’est nous qui sommes lus et vus, qui sommes des déjà-vus, copies de nous-mêmes projetées dans le flux même de la vie et que nous pouvons parfois saisir comme Borges rencontrait dans Le livre de sable son double, le vieil homme qu’il adviendra.
Nous voici retourné à …. O… ceci est un décentrement, sans début ni fin, ceci est le centre – un vide holographique.
Dans cet espace rendu visible par le numérique, nous assisterons peut-être à des germinations virtuelles du réel induites par nos paroles et nos pensées numériques. Des germinations dans l’obscure du réel qui n’ont pas encore basculé en représentations. Si tel est le cas, la responsabilité de ce que nous transmettons, ce que nous laissons en germes d’un futur probable, ici ou ailleurs, pose également une question d’éthique et de conscience.
Publié dans Non classé
Laisser un commentaire
Oralité?…Vous avez dit Oralité?
– Oralité?…Vous avez dit Oralité?
Oralité du numérique?…Turn ancillaries numériques?…mais alors oralité silencieuse, oralité scripturale ou visuelle, trace d’oralité, oralité sans trace, empreinte de ce qui n’est pas conservé, oralité réflexive, en fait, on parle d’une nouvelle dimension de l’oralité. Un aspect magique du langage, oralité tissée de signes sémiotiques, non pas magiques, mais plutôt une magie des signes. Signes d’oralités dans les rues blanches et silencieuses cristallisés en bannières, affiches, panneaux, messagerie vocales, poésie des rues, oralité carnavalesque bakhtinienne transcrite en logos twitter, facebook, skype, pop ups, smileys…oralité amplifiée, démultipliée, corporelle, car derrière l’écran c’est bien le corps qui écrit et dans le texte le souffle qui passe. Le texte est-il la traduction du monde, d’un autre texte ou bien de l’oralité?
On fouille, alors, le texte à la recherche de son auralité? Barthes dirait oralité comme degré zéro de l’écriture. Un autre espace-temps, l’espace-temps total, celui du cyberspace. Espace virtuel, existant en soi, chamanique ou les mots ont le pouvoir d’agir où oralité et écriture transmuent leur identité, entrent en osmose afin de produire cette « langue des anges» que promet Metatron1
Dans son ouvrage The Barbarian within, Walter Ong écrit: «In an important theoretical sense, all of literature, and not just Homer’s epics, has a primary oral and aural existence.»
La culture numérique serait-elle l’émergence d’une nouvelle oralité? « La nouvelle oralité, explique Geneviève Pigeon de l’Université du Québec à Montréal, peut donc se priver du support vocal, musical et performatif que reconnaissait Paul Zumthor2 dans une définition générale de l’oralité en s’épanouissant au sens d’un medium virtuel dont les codes et les règles sont complètement différentes. La nouvelle oralité, ajoute-t-elle, est spontanée, désintitutionalisée et décomplexée. » L’hybridation texte-image et son pendant la navigation, évoqués par Samuel Archibald3 peut-on l’appeler l’oralité? Mc Luhan4 a remarqué « une mutation de l’oralité dans la communication », Ong5 a repris cette idée sous la forme « d’oralité seconde. » Il dit « qu’en négligeant cette oralité on omet de prendre en compte la textualité enfouie sous ces formes médiatiques et le volet auditif de leur réception. » Archibald parle, plus loin, « d’une distinction entre une médiation produite comme évènement (ce qui recouvre autant la quasi- immédiateté de la parole que la sophistication des medias audiovisuels) et une médiation produite comme trace. Évènement et trace nous ramènent à une autre typologie, celle des rapports entre oralité et littéracie. » L’oralité semble constituer l’expérience sensorielle totale par rapport à l’écrit. Mais l’écriture est une oralité qui s’est révoltée contre le temps dans son désir de mémoire… car elle est flux qui passe.
« Évènement plutôt que trace, fluidité plutôt que stabilité. La fluidité étant l’état d’un support sur lequel nous avons peu de prise, poursuit Archibalde, et dont le contenu est perceptible en surface. L’oralité est performance et fluidité, l’oralité est plus fluide que le texte parce qu’elle s’effectue plus rapidement, sa fluidité est une question d’instantané. » L’oralité comme expérience totale, donc, où écrire serait comme parler, parler comme penser, la médiation se réduisant en peau de chagrin, alors que la mimesis tend à s’actualiser dans l’espace virtuel, espace du grand mime, d’identification et d’osmose. « Le lecteur dans le cyberspace est un expérimentateur et un performer et la navigation se présente comme une lecture sans texte.» À la suite d’Ollivier Dyens, nous pressentons « que le web n’est pas un livre ni un texte.» Peut-on considérer l’espace cybernétique comme le lieu d’expérimentation d’une nouvelle oralité?
Mais, la fluidité agit à un niveau encore plus fondamental celui de l’écriture. Ong rappelle que: «Oral thought is conventional, using mnemonics and formulas to aid in recall. Oral thought is additive rather than subordinative, pulling events together in sequence rather than in relation. Oral thought is aggregative rather than analytic, putting things together rather than taking them apart, It is redundant, since oral culture cannot refer back to what was spoken.» Sur ce point, nous dirons que justement la spécificité de la nouvelle oralité numérique est sa possibilité de se constituer en langue hybride, contextuelle et abstraite, à la fois, qui se présente linéairement et tabulairement comme discours littéraire et informatif. Il semble que le contrat de lecture ratifié entre l’écrivain et son lecteur n’inclut pas la clause oralité, celle-ci reste buissonnière, un souffle, un style…L’oralité se présente alors comme ce qui rend possible l’hypertexte, justement par ses effets de juxtaposition et d’association, peut-on alors parler d’effet d’oralité comme Barthes parlait d’effet de réel?
« À la suite des Maitres du soupçon, nous nous sommes mis à écrire autrement, à reconnaitre des altérites nouvelles de l’écriture », rappelle Archibald. Comme en écho Derrida répond : «Parce que nous commençons à écrire autrement, nous devons relire autrement.»
Relire autrement, serait-ce écouter l’oralité du texte?
1- Métatron, La promesse de Métatron dans L’œil et la main, l’écran et la souris, Thierry Bardini, professeur agrégé au Département de communication de l’Université de Montréal.
2- Paul Zumthor, Performance, réception, lecture, Collection Le Préambule
3- Samuel Archibald, Le Texte et la Technique, Montréal, Le Quartanier, 2009
4- McLuhan, Understanding Media
5- Walter Ong, Orality and Literacy
Publié dans Non classé
Laisser un commentaire
O
Indécision… première impression, car à qui écrit-on au juste?
L’espace lumineux est là, attirant et envoûtant ; énigmatique, léger voile vitré, rideau d’algorithmes… surtout ne pas se laisser prendre aux analogies, aux homologies, au paysage en spirale, à l’envers et à l’endroit de la présence… ne pas traverser le miroir.
Car, une voix autre entonnerait, prendrait le dessus… celle du désir. Désir de soi, de l’autre… préférer à la fleur jaune, ses racines… souterraines et rhizomiques, cela s’entend, mais à les renverser… voici l’espace lumineux, horizon inattendu, devenu sol, terreau, devenu matrice calcaire…
Surtout, et encore fuir les symboles, laisser venir autrement… éviter de briser la fine pellicule et glisser incessamment… remonter à la surface… se mouvoir, plutôt surfer le flux, horizontalement et verticalement jusqu’ à rencontrer le premier récif d’une lettre… pourquoi pas… A… lettre prégnante… voilier ou corne renversée… écho ombré sur fond infini…
Embarquer la lettre iconique, larguer les amarres… lettre suivante… une suite de lettres… une chaîne d’hiéroglyphes, images, représentations, alphabet qui scintille, choses possibles, fossiles… du sens?…Quel sens?… Archéologie… ARCHÉOLOGIE DU NUMÉRIQUE?… DISSÉMINATION?… DERRIDA?…
Fouille, donc,… fouille encore dans l’infini lumineux… mais à la recherche de quoi?… Fouille invisible… se diriger avec sa boussole-curseur, de bas en haut et de gauche à droite et en sens inverse…mais toujours rien… ah oui… un centre… au centre… alors là je sais… c’est le O… O… comme?…comme?…le centre de quoi?… Mon centre, ton centre, son centre… cent centres, sans centre… zut, alors!… O… comme… comme… mais, oui, évidemment, comme… ORALITÉ! … ORALITÉ DU NUMÉRIQUE?!
Zut, alors!… me suis fait prendre!
Court video du texte autopsié qui livre son oralité aurale.
Publié dans Non classé
2 commentaires