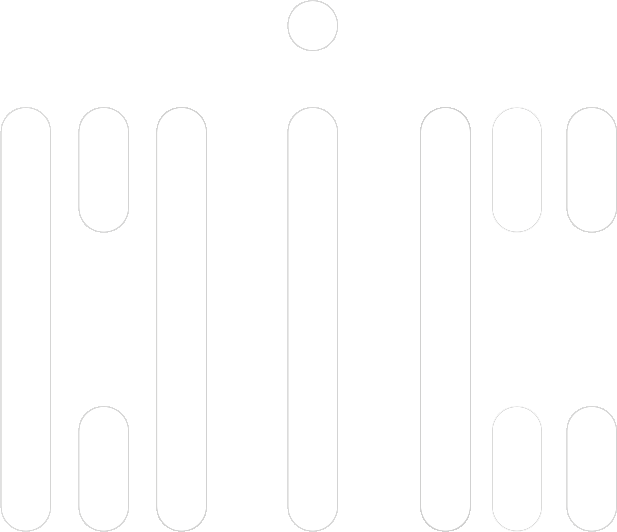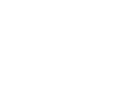La traversée
(Crédits photo: Benoit Bordeleau)
O’shagg mon amour
- Graffiti
De plus en plus, le vide t’avale, cher ami; sur tes écorces
disparaissent les signes, plus rien ne s’y lit à présent.
- Claude Paradis
LIMINAIRE
Au coin des rues Sainte-Catherine et Nicolet se trouve un antiquaire à la façade rouge foncé. Derrière la vitrine de cette boutique, une statuette de plâtre blanc repose, éclairée nuit et jour par une lampe. Elle tient son bras devant son visage, comme un bédouin se protègerait d’un vent de sable. La statue, dont on ne voit pas les yeux, est sculptée avec une absence de détail frappante.
À cette figurine n’est accolée aucune légende qui pourrait permettre d’en saisir le sens ou l’origine. Pas même un prix. La seule chose qu’on puisse en dire, c’est que de la manière dont elle est placée, derrière cette vitrine, elle fait face à l’Est.
La nuit le corps
continent
se disloque
la mâchoire décrochée
court à sa perte
pour vaincre le froid
LIGNE DE FUITE
Tout commence avec un regard, un seul regard sur ce toit de la Sainte-Catherine, un sphinx au-dessus de la mêlée qui refuse de se dissoudre tout à fait, un regard comme ceux-là comme une question qui se creuse, un regard qui contemple les reflets du fleuve sur la rue emportée, qui laisse couler le monde sans battre des paupières, et tout balayer vers on ne sait où vers l’Est, qui lit les lignes et répond sur la marge, prisonnier de ses propres yeux, qui est-il, ce vieux sphinx à demi perdu dans les brumes, avec son regard de tunnel infranchissable?
Un homme passe son torse nu par une fenêtre et se met à hurler.
les mains dans la tête
sur la bouche
entre les lignes blanches
et celles du bottin téléphonique
seul le corps se souvient
de ce qu’il ne sait plus
MÉTAMORPHOSE
Plus personne n’entre à la gare de triage par la rue du premier homme. Ce passage, laissé à lui-même, déjoue le regard. Pourtant il n’est ni clôt, ni sombre, ni repoussant. À vrai dire, il n’inspire pas la moindre émotion. Simplement on glisse le long de sa frontière comme s’il n’existait pas, ou plutôt comme si c’était la possibilité de le franchir elle-même qui n’existait pas. Mais il arrive parfois qu’un corps trouve une brèche. Est-ce le passage qui s’ouvre de lui-même, par une volonté propre? Ou le hasard le plus ténu? Tout ce qu’on sait, c’est que les âmes qui y trouvent refuge ne connaissaient pas son existence, ne le cherchaient pas, ne le cherchent pas, ne le chercheront jamais.
les jambes, longilignes
embrasure du corps
grelotent
au coin d’une rue
entrouvertes, l’instant
d’un claquement de portières
Les échos veulent qu’une fois le passage franchi, on se trouve comme à l’orée d’un désert. Le chemin, qui s’enfonce dans ce champ perdu où les rails se dédoublent, s’effrite, retourne à la poussière à mesure que le trottoir s’efface. Et sur les bords de cette route qui n’en est pas une apparaissent d’étranges monticules de terre séchée. Sur l’un deux, sans doute le plus haut, un arbre se dresse. Il ressemble à cette espèce noueuse d’arbres africains qui semblent si farouchement enracinés dans le sol aride qu’on dirait leurs jointures blanchies par l’effort. Quelque chose en lui, peut-être ces racines obstinées ou ces branches tombantes, inspire l’ermitage. Dans ce lieu pourtant, pas de sage, pas d’être reclus. Il n’y a que cet arbre et le silence acouphène de l’usine de levure, au loin dans l’ombre, qui bruisse entre ses branches. Seulement lui, et cette absence - on ne sait plus trop laquelle.
les lampadaires interpellent
des glissements
patrouillent l’ennui
corps ombre
l’écho des lumières
sur les marches
du silence
LES TEMPLES DE JÉRUSALEM I
Un viaduc comme une frontière, un bandage de peinture écaillée qui peine à retenir le déluge, une citerne rouillée, une épée pendue, un étudiant devant des ruines, une gare qui ne trie plus grand-chose, la poussière de plâtre agglutinée, une cour et dans cette cour un escalier, des marches qui ne mènent à rien, des carreaux brisés des tracts jaunis, un cimetière enterré, une mise en abyme, une affiche sur un mur qui s’effrite, une femme blonde, une seule affiche comme une relique dans un temple oublié, l’envie de la cigarette qui prend, un vieux sphinx exhale et ferme les yeux, et cette phrase murmurée par le cœur crevé des débris : j’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans. Un chat se glisse parmi les ombres comme un prince en son royaume.
par les naseaux du fleuve
le désert expire
la lourdeur du corps
au creux des sleeping bags
sans parole Ontario s’ouvre comme la mer je plonge sans savoir si je suis colère ou égyptien je ne sais plus si j’essaie d’échapper à ce sphinx ou de freiner sa dispersion les intersections s’enfuient dans les marges je trace une ligne nette entre les reflets j’avance et la peur recule dans les ruelles fugitives à mesure que les amorces du monde disparaissent je ne sais plus si c’est le passé qui engloutit le présent ou l’inverse j’avance dans le couloir dans l’étroitesse du passage est-ce le chemin dont il ne faut pas s’écarter ou deux murs immenses ou projeter nos ombres pour ne pas être englouti par le sable avec ses chars et ses guerriers enfin sans aide la nuit ouvre une brèche
Une femme en colère se jette au milieu de la rue sans regarder.
soudain le corps dense
dans les mains une brique
corps brique
qui hurle à la reine d’Angleterre
cette connasse
vingt dollars
donne-moi mon vingt dollars
LES TEMPLES DE JÉRUSALEM II
Une rangée de condos impeccables tournée vers l’intérieur, les murs pour couper court à la rue, entre ces bras de brique une cour à peine perceptible, une table enchainée comme un chien de garde, le gazon frais coupé, l’odeur de la rosée qui perle, une fenêtre sans rideau un œil sans paupière, les lumières ouvertes sur un joyau aveuglant, et sur le mur, une tapisserie de Broadway, les sillons lumineux des taxis vus du ciel, les étoiles d’un rêve inconnu un tapis sans poussière, un divan immaculé, le reflet d’un vieux sphinx apparait, une silhouette noire, une brique dans la main, et cette phrase comme une pierre trop lourde à porter : bientôt le jour va tout cacher. Le silence bruisse comme s’il était roi.
mon hostie
le corps mot
s’affaisse
la main n’atteint pas
le cœur
retombe
au hasard de la fatigue
dans l’anfractuosité #3721
MÉTAMORPHOSE
On dit qu’une nuit d’automne, sur chaque fenêtre placardée de l’école Baril, apparut le visage fantomatique d’un enfant. Pendant un moment, derrière les masques à gaz, leur regard fit réapparaitre sur les vitrines de ce lieu mort la trace fugitive d’un bonheur évacué. Et pourtant ces enfants ne souriaient pas. Il y avait, au contraire quelque chose d’accusateur, quelque chose d’infiniment triste dans leur regard pétrifié.
Ces visages ont disparu depuis longtemps. Rien d’eux, hormis le silence, ne demeure aujourd’hui. Juste en face, sur le mur de l’église, une affiche annonce toujours le spectacle de lutte du samedi soir. Un peu plus loin, un graffiti chancelant chuchote encore Je ne suis pas d’accord. Mais que dire de plus? Car les lieux ne s’effacent-ils pas avec ceux et celles qui les ont habités?
et toujours cette brique
toujours
dans le mur
À deux pas de cette école, un balcon comme tant d’autres surplombe la rue Sainte-Catherine. Deux chaises vides y regardent tantôt vers l’ouest, tantôt vers l’est. Que dire de ce balcon, hormis que juché là, la vue doit être magnifique entre les deux tours de l’église au crépuscule et le fleuve inaccessible? Ou bien que dans l’immeuble, un jour ou une nuit, un incendie a eu lieu, car les traces de suie noire tachent encore la pierre grise?
Dissimulé derrière la façade, un chemin serpente, s’enfonce entre une mince rangée d’arbres. Si ce n’était de la rue Notre-Dame qui réapparait au détour des courbes, on croirait être entré dans un autre lieu, différent, étrange. Mais au bout de ce sentier il n’y a qu’un terrain vague comme tant d’autres. Des marres d’eau stagnante, des déchets un peu partout, une lumière grise, quelques arbres, un arbre, et l’air lourd, chargé des fumées de l’Ouest, qui s’en va, qui s’en va vers l’Est.
au pied du fil
le corps las
pèse peu
sur la balance
use la corde
jusqu’au bout
LIGNE DE FUITE
Si on pouvait regarder la ville en accéléré, peut-être verrait-on que dans l’indifférence totale, des détails disparaissent. Évacués, où peuvent-ils bien aller? Y a t-il, quelque part dans Hochelaga, un vieil antiquaire, ni homme ni femme, assis sur le porche, à se balancer au seuil du monde, qui garderait la demeure inhabitée de tous les détails passés, camelote de la mémoire?
les traces de char brisent
le silence
le corps, encre
translucide
replonge
dans le ventre
LUMINAIRE
La statue de plâtre est devant mes yeux et je comprends que c’est cette question qui a tout déclenché: Que cherche-t-elle si désespérément à ne pas voir? Subitement mes mains cessent de m’obéir, elles se collent à mon visage, mon corps se tourne vers l’Est et une fissure apparait, la lumière me traverse comme le verre par le matin qui chante, un cri s’agglutine en moi comme dans une maison surpeuplée, je retrouve l’espace d’une nuit un passage vers l’oubli un arbre esseulé des ruines pétrifiées les rues qui défilent des jambes entrebâillées un balcon incendié un corps opaque les barreaux translucides des fenêtres je reparcours d’une coulée
les eaux séparées d’Ontario l’expulsion
du paradis les temples
de Jérusalem et ces regards le sphinx
quelque chose se brise et déborde
l’aube crève
se répand
la rue s’étire
disparait

/index.png)