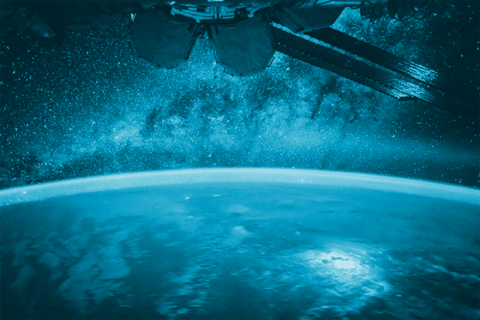«Quand l'interface nous échappe: lapsus machinae, autonomisation et défaillances», les 25, 26 et 27 novembre 2019, Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord.
Ce colloque est organisé par Pierre Cassou-Noguès, Gabriel Tremblay-Gaudette, Arnaud Regnauld, François Sebbah et Gwenola Wagon dans le cadre du projet «Mondes, interfaces et environnements à l’ère du numérique», projet soutenu par le Labex Arts-H2H (désormais fusionné dans l’Ecole Universitaire de Recherche ArTeC: http://eur-artec.fr).
Interface: une surface commune à deux corps à travers laquelle ils communiquent, échangent des informations. L'interface n'est jamais complètement transparente. Il s'y opère des phénomènes de traduction, de brouillage et d'opacification. De l'information s'y perd, mais elle est sans épaisseur, par définition pour ainsi dire. Comment alors nos interfaces pourraient-elles nous échapper, s'échapper, prendre une sorte d'autonomie, voire de créativité par glissement ou même dérapage (ou quand le lapsus devient événement) ?
Tout peut faire interface. La peau peut être considérée comme une interface par où le corps interagit avec l'extérieur, et inversement. Ou alors, pour le sujet contemporain, c'est l'écran tactile de son téléphone intelligent, extension technologique du corps biologique, qui lui donne accès aux réseaux. Ou alors, si le monde se réduit à un réseau de routes interconnectées, c'est la voiture. Ou alors c'est le conducteur qui fait interface: le point par lequel les voitures, celles qui klaxonnent ensemble au carrefour, et celles qui se succèdent dans le temps, les différentes générations d'automobiles, communiquent entre elles. Dans tous les cas, l'interface devient en quelque sorte un organe sensible pour la matrice «intelligente» d'un dispositif technologique qui favorise, voire autorise la mise en relation de deux environnements dont elle maintient, malgré tout, la différence sans pour autant se constituer en tant qu'espace proprement dit. À moins de penser cet espace comme processuel, mouvement où se diffère perpétuellement la fusion anticipée, semble-t-il, par l'osmose ?
Porter son attention sur une interface revient en effet à distinguer deux choses, ou entités qui communiquent, en isolant le lieu de leur communication, et décréter celui-ci non pas comme transparent mais comme plutôt dépourvu d'épaisseur: décréter qu'il ne se constitue pas lui-même en «chose» au même titre que les deux «choses» dont il ne représente alors que la surface de contact.
Pourtant, ce que nous appelons nos interfaces semble bien acquérir une autonomie et une importance croissante. Elles se détraquent, elle se dérèglent, ou, au contraire, elles fonctionnent trop efficacement, au point de nous donner l'impression qu'elles n'ont plus besoin de nous. De quoi s'agit-il ?
Les défaillances appelés «bugs» dans le vocabulaire informatique, devraient-elles être comprises comme similaires à une irritation de la peau ? Un eczéma atopique, circulant à la surface du corps numérique, qui pourrait résulter seulement d'une sorte de friction entre deux «choses» mal assorties, ou manifester un symptôme, comme ceux dont parle la psychanalyse, et par lesquels nous exprimons quelque chose que nous ne comprenons pas nous-mêmes ?
Ou bien notre intérêt pour les «bugs» fait-il signe vers une apparente autonomisation des interfaces, dont le paradigme alors serait, plutôt que le «bug», la voiture qui se conduit toute seule, ou l'algorithme de flash-trading, voire l'aboutissement du C3I (Commandement-Contrôle-Communication-Renseignement). Autonomes, ces machines cesseraient d'être des interfaces à proprement parler, et l'interface ne serait peut-être plus un concept adéquat pour les désigner à l'aune de certaines technologies contemporaines. Il n'y aurait plus d'interfaces, sinon, à la limite, nous-mêmes qui servirions d'interface dans une communication généralisée entre les choses; à titre d’exemple, les cartes numériques qui devraient être les interfaces entre un sujet et un espace en sont venues à dicter nos déplacements, voire notre perception du monde et nos comportements. Les idoles du fétichisme de la marchandise se seraient enfin animées.
Nous souhaitons lors de ce colloque, solliciter des propositions théoriques aussi bien qu'artistiques sur la thématique de l'interface, et plus précisément sur son autonomie croissante ou ses défaillances: histoire des interfaces, concept d'interface, usage des bugs et, plus largement, de l'image de l'autonomisation de l'interface dans la littérature et l'art, rapport au comique.
Les propositions, d'une longueur maximale de 300 mots, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique doivent être soumises sur Easychair d'ici le 1er septembre 2019 à l'adresse suivante: https://easychair.org/cfp/Interfaces19
Les participant.e.s dont les propositions seront retenues seront avisé.e.s par courriel dans les deux semaines suivant la réception des propositions.
Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter à l’adresse suivante: gabriel-gaudette at gmail dot com