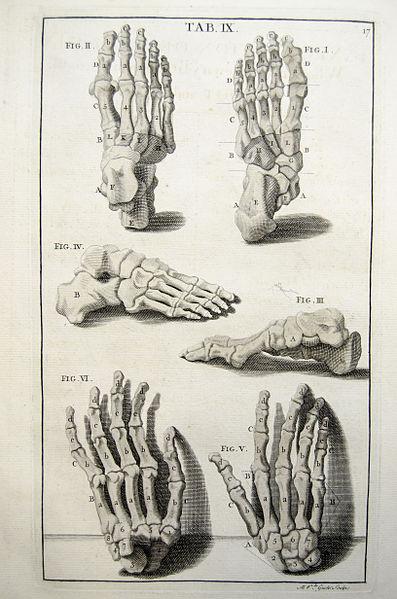OBSERVATOIRE DE L'IMAGINAIRE CONTEMPORAIN
Le pied de Fanchette et les mains d’Emma Bovary
La critique a abondamment usé et abusé du mot «réalisme» pour décrire l’œuvre de l’un et de l’autre: Rétif de la Bretonne et Gustave Flaubert figurent en bonne place dans toute étude portant sur l’histoire de cette tendance esthétique dans la littérature française.
Le premier, que Paul Bourget qualifiait jadis dans un élan darwinien plus ou moins heureux de «pithécanthrope de Balzac1» (Bourget: 723), a souvent été salué comme un précurseur des romanciers du XIXe siècle, l’un des premiers à s’être intéressé aux classes populaires et à avoir eu l’ambition d’offrir par son œuvre un panorama fidèle de la société et des mœurs de son temps. Ses héros et héroïnes tirés du petit peuple de Paris ou du monde paysan, ses intrigues faisant bonne place aux trivialités d’une réalité quotidienne encore rarement dépeinte, de même que sa prétention à parler en historien de son temps2 ont été salués par ceux qui souhaitaient faire de son œuvre une étape vers la forme parachevée du réalisme qui sera incarné près d’un siècle plus tard, bon gré mal gré, par un romancier comme Flaubert.
La présente analyse entend revisiter cette filiation problématique à l’aune d’une sociocritique qui postule que le réalisme n’est jamais que le produit historiquement variable d’une interaction entre un texte et la semiosis sociale3, et qui rejette la vision téléologique faisant des romanciers du XVIIIe siècle tels que Rétif de la Bretonne les acteurs d’une évolution esthétique qui n’aurait connu sa pleine réalisation qu’au siècle suivant. Nous souhaitons plutôt jeter ici un regard comparatif sur les procédures spécifiques de mise en texte de l’ambition mimétique telle qu’elle se manifeste dans les portraits respectifs des deux héroïnes des romans Le Pied de Fanchette (1769) et Madame Bovary (1857). Nous avançons l’hypothèse que ces portraits, et plus particulièrement le traitement narratif réservé au pied de la première et aux mains de la seconde, sont non seulement révélateurs des différences profondes qui existent entre les manières dont les deux écrivains se représentent la beauté, la singularité, le naturel désirable (ou non) du corps féminin, mais que leur pouvoir de vraisemblance tient peut-être avant tout aux liens qu’ils entretiennent avec les discours, les représentations et les pratiques sociales dont ils sont contemporains. Loin d’être réductibles à la chose qu’ils dénotent, le pied et la main des personnages sont aussi, comme le rappelle Claude Duchet dans la définition qu’il donne de la «socialité», producteurs de lisibilité, facteurs d’ancrage dans une réalité extralinguistique en ce qu’ils figurent parmi «les ensemble et réseaux signifiants du roman: portraits, gestes, objets, lieux, vêtements, langages… qui sont tous faits de société, codes par et pour leur mise en texte» (Duchet: 450).
Dans ces romans, un pied n’est jamais un simple pied, ni une main une simple main. Médiateurs polysémiques du désir amoureux, actants à part entière dans le récit, ces parties du corps trahissent l’origine, le caractère et la condition des héroïnes en inscrivant leur apparence dans les discours de leur temps. Elles manifestent leurs aspirations et leurs rêves, tout comme elles en tracent les limites. Par-dessus tout, la manière dont ces parties sont représentées et connotées inscrit les personnages dans un imaginaire social qui détermine le champ de leurs possibles narratifs. Couple antipodal, le pied et la main sont investis d’une valeur symbolique qui dépasse leur seule fonction anatomique. Tandis que le pied, menu, étroit ou charmant, participe d’une longue tradition picturale et littéraire qui en fait l’un des symboles privilégiés pour désigner le sexe féminin, la main, gantée ou usée par le travail, molle ou ornée d’une bague signalant le lien conjugal, sert souvent dans le roman réaliste à révéler la psychologie d’un personnage, à divulguer le vrai sens d’une action. Tantôt idéalisés, voire fétichisés, tantôt chargés d’exprimer une singularité dont ils seraient le signe ou le point nodal, ils sont des lieux de condensation symbolique qui annoncent, désignent et contiennent en raccourci la trajectoire sociale de leur héroïne. À travers les descriptions qu’en offrent Rétif de la Bretonne et Flaubert se manifestent ainsi deux conceptions du réalisme romanesque, deux façons d’envisager la socialité du corps féminin et des rapports entre les sexes.
L’appel du pied
Une comparaison des titres des deux romans fait dans un premier temps entrevoir quelques distinctions importantes. Avec Madame Bovary, le personnage central, dépossédé de son prénom, doit son identité au patronyme de l’homme à qui elle a donné sa main. Avec Le Pied de Fanchette, la jeune fille «sans nom et sans naissance» se voit quant à elle définie par la partie du corps qui donnera l’impulsion à son destin et par laquelle sa vertu sera plus d’une fois mise à l’épreuve. Alors que le roman de Flaubert entend offrir un aperçu des mœurs en province, celui de Rétif de la Bretonne se déroule dans le milieu parisien de la petite bourgeoisie commerçante. Fanchette, pauvre marchande de mode orpheline, poursuit le rêve d’un mariage qui pourrait lui apporter une nouvelle condition. Pourvue d’un petit pied si séduisant qu’il devient rapidement l’objet de toutes les convoitises, Fanchette doit subir les assauts répétés de quantité d’hommes aux mœurs douteuses qui cherchent à la séduire. Enlèvements, séquestrations, tentatives de viol se succèdent dans une intrigue qui ne manque pas de rebondissements, mais qui verra tout de même triompher la vertu puisque la jeune femme finira par épouser un homme au cœur noble. À la base du récit se trouve donc une histoire édifiante d’ascension sociale rendue possible par une farouche résistance aux bas instincts inspirés par sa beauté.
Cette variation sur le thème de la vertu récompensée, reprenant un canevas au demeurant fort commun dans le roman du XVIIIe siècle, se distingue par le rôle narratif singulier que Rétif accorde aux petits petons de son héroïne. «Je suis l’historien véridique des conquêtes brillantes du pied mignon d’une belle4», déclare d’entrée de jeu le narrateur dans le premier chapitre. Comme souvent dans l’œuvre de Rétif, il est difficile de séparer clairement la voix du narrateur de celle de l’auteur, lui qui constamment s’amuse à brouiller la frontière entre réel et imaginaire. Dans la section de son autobiographie consacrée à la revue de son œuvre, Rétif présente comme suit l’origine de cette «histoire véridique»:
Il y avait longtemps que l’idée de cet ouvrage s’offrait à mon imagination, embrasée par la vue d’une foule de jolis pieds, dont alors quelques-uns étaient chaussés d’un goût exquis. J’étais dans cette situation, lorsqu’un dimanche, dans le temps que je demeurais rue Quincampoix, j’aperçus dans la boutique de modes qui faisait l’angle des rues Tiquetonne et Comtesse-d’Artois, une jeune personne chaussée en souliers roses, à talons élevés et minces; elle avait une jupe courte et piquée, parce qu’elle s’habillait, et jamais je n’ai rien vu d’aussi voluptueux. J’ignore ce que les femmes d’aujourd’hui gagnent aux talons bas, mais je sais bien ce qu’elles y perdent: de l’élégance, de la noblesse, de la finesse dans la jambe, de la mignonesse et de la volupté dans le pied. […] je fus si ému de la vue du joli soulier rose que j’entrai en verve. (Rétif de la Bretonne, 1989: vol.2, 899)
Ce soulier «couleur de rose» qui viendra se substituer à «l’orpheline française» dans le sous-titre des deuxième et troisième rééditions du roman, pour être suggestif à souhait, ne prétend pas moins trouver sa source dans un souvenir personnel et «véridique» de l’auteur. L’œuvre rétivienne est d’ailleurs tout entière parsemée d’allusions à cette faiblesse que l’auteur avoue avoir toujours éprouvée à la vue d’un pied délicat. À plusieurs reprises dans Monsieur Nicolas, il confie qu’un pied mignon est un charme auquel il n’a jamais pu résister; afin de ne laisser aucun doute sur la nature de son désir, il précise bien que «ce charme ne produit pas de la tendresse5.» (Rétif de la Bretonne, 1989: vol.1, 421) La chaussure féminine, surtout celle que le talon mince et élevé distingue de la chaussure masculine, est chargée par Rétif d’un pouvoir d’attraction tout aussi troublant.
Comme le fait très justement remarquer Didier Masseau, il paraît difficile de départager ce qui, derrière ce fétichisme du pied et de la chaussure, relève du fantasme individuel ou d’un imaginaire collectif qui, depuis au moins la Renaissance, fait de cette partie du corps féminin un objet érotique privilégié. (Masseau, 1996) Le célèbre conte de Perrault et les autres variations inspirées par le mythe de Cendrillon sont là pour nous rappeler le sens de l’expression «trouver chaussure à son pied» et la substitution sémantique qu’elle opère pour désigner la promesse d’une bonne entente sexuelle. Citant plusieurs auteurs anciens et modernes, multipliant les références mythologiques et antiques, Rétif lui-même ne manque pas de rappeler tout au long du Pied de Fanchette que le fantasme du pied féminin a une longue et riche l’histoire. Ses contemporains sont nombreux à l’attester, à commencer par Jean-Jacques Rousseau, à qui Rétif emprunte un extrait de sa Lettre à d’Alembert sur les spectacles en guise d’épigraphe à son roman: «Une jeune Chinoise avançant un bout de pied couvert et chaussé fera plus de ravages à Pékin que n’eût fait la plus belle fille du monde dansant toute nue au bas du Taygète.» De même, dans l’une des nombreuses notes explicatives jointes au Pied de Fanchette, Rétif cite longuement Agathe et Isidore, roman de Mme Benoît paru l’année précédente, dans lequel la volupté éprouvée par un amant devant le pied de sa maîtresse fait l’objet d’une scène décrite «avec beaucoup de chaleur». (PF: t.3, 144)
Symbole et substitut du sexe, le pied est ainsi un ressort dramatique pour nombre d’écrivains du XVIIIe siècle qui, s’amusant de ses connotations érotiques, ne peuvent, quand il s’agit de décrire celui de leur héroïne, imaginer d’autres qualificatifs que «menu» ou «mignon». Romanciers, poètes, philosophes contemporains de Rétif s’entendent généralement pour présenter la petitesse comme qualité essentielle d’un pied parfait. Dans L’Académie des grâces, un traité galant traduit de l’anglais en 1755 et consacré à la célébration des charmes et des appâts du «beau sexe», l’auteur est on ne peut plus clair: «pour garder une juste symétrie et faire une beauté parfaite, le pied doit être petit.» (Spence: 34) L’année précédente, en 1754, Antoine Le Camus, docteur-régent de la Faculté de médecine de Paris, faisait quant à lui paraître un curieux ouvrage intitulé Abdeker ou L’Art de conserver la beauté. Il y soutient que l’attrait «naturel» éprouvé par «la plupart des hommes» envers les petits pieds repose sur un «principe de délicatesse» qu’il explique ainsi: «la longueur des pieds dénote presque toujours une basse extraction, une vie exercée par les travaux les plus rudes, une négligence particulière de tout ce qui peut contribuer à la beauté. Au contraire, rien de si enchanteur qu’un petit pied proprement enchâssé dans une chaussure bien faite.» (Le Camus: t.1, 89) À en croire Le Camus, la finesse du pied serait, comme le teint pâle et les mains douces, indice d’une oisiveté aristocratique, attestation d’une noble naissance. Aux raisons érotiques et esthétiques qui fondent la plus grande partie de l’argumentaire en usage au moment où écrit Rétif de la Bretonne, s’ajoute ainsi une troisième raison voulant que le pied et ce qui l’enserre jouent le rôle de marqueurs sociaux.
Dans le roman qui nous intéresse, le petit pied de Fanchette est toujours chaussé d’un soulier finement orné ou d’une mule de goût. Il est, en même temps que l’indice des rares mérites du personnage, l’expression de sa volonté d’afficher une noblesse que lui refuse la modestie de ses origines. Ce pied, «première cause des conquêtes, des malheurs et de la délivrance de la belle orpheline» (PF: t.2, 111), incarne à la fois la tentation d’une réussite facile mais déshonorante et la source des épreuves dont le triomphe représentera au final une forme d’ennoblissement. Au noyau thématique du pied sont ainsi associés les motifs corollaires du déplacement, de l’ascension sociale et de l’élévation morale.
Car le souci de faire voir la vertu et la grandeur morale au sein des basses classes, récurrent dans l’ensemble de l’œuvre rétivienne où se rencontrent quantité de personnages que ne distinguent ni les titres ni les biens, traverse aussi Le Pied de Fanchette. Dans l’épître placée en tête du roman et dédiée à «Madame L***, femme d’un marchand», Rétif admet d’emblée son désir de montrer que le mérite et le talent se rencontrent dans toutes les couches de la nation, y compris dans la petite bourgeoisie commerçante à laquelle appartient sa dédicataire. «En quoi donc ceux que distingue une naissance illustre peuvent-ils se flatter de l’emporter sur votre condition?» (PF: t.1, v) lui demande-t-il rhétoriquement. La prétention de parler pour le peuple, de prendre cause pour lui et de montrer qu’il peut servir de modèle de dignité et de vertu est encore plus explicite dans la toute première note du roman, qui en énonce le programme: «Mon but, dans cet ouvrage, n’est pas de peindre en grand. […] Je vole terre à terre. Mes héros sont pris dans la médiocrité.» En France, «on n’écrit sur le peuple, on ne l’introduit sur la scène que pour le ridiculiser», poursuit-il avant d’ajouter qu’il n’y a pourtant «rien de plus sacré, de plus respectable, de plus saint», dans une monarchie comme une république, que «le peuple et ses droits.» (PF: t.3, 137)
Cette défense de l’intérêt littéraire et moral des classes inférieures, de ces individus qui forment «le gros de la nation», Rétif la réitère à plusieurs reprises dans toute son œuvre, et particulièrement dans la préface du 19e volume de ses Contemporaines, souvent citée comme pièce à conviction par ceux qui voudraient faire de l’auteur un jalon incontournable dans l’histoire du réalisme. Dans cette préface écrite une quinzaine d’années après Le Pied de Fanchette, on peut voir Rétif défendre de nouveau son droit de voler «terre à terre» et de trouver sa matière romanesque au coin des rues ou aux étals des marchands. «Il pourrait se trouver quelqu’un peut-être qui me reprocherait ici la prétendue bassesse de mes personnages. Le corps de la nation n’est pas vil, voilà ma réponse.» (Rétif de la Bretonne, 1785: vol.19, 4) Appliquée à un roman comme Le Pied de Fanchette, l’expression invite à une double lecture. Ce «corps de la nation» dont Rétif entend montrer la noblesse, désigne à la fois cette masse informe composée par l’ensemble des citoyens ordinaires et le corps de la petite marchande de mode. Si les portraits de personnages féminins de Rétif paraissent souvent sortir du même moule — rien de moins distinct qu’une héroïne rétivienne: systématiquement «jolies» ou «charmantes», elles sont toujours pourvues d’une taille fine, des «plus beaux yeux», d’une poitrine «faite au tour» et, bien sûr, d’un pied minuscule et «mignon» —, l’auteur accorde un bien plus grand soin à varier les souliers somptueux dont il chausse sa Fanchette. Nulle chaussure n’est pareille à la précédente: chacune se caractérise par des couleurs et des motifs différents, renouvelant chaque fois le charme chez celui qui la voit. Un aspect toutefois ne change pas: le talon élevé, que Rétif ne cesse de défendre dans tous ses ouvrages contre la mode des souliers plats qui apparaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui culminera sous la Révolution. Loin d’être convaincu par le discours des médecins et des anatomistes qui accusent le talon haut d’être source d’inconfort et de causer du tort à la santé des femmes, Rétif plaide au contraire pour la préservation de cette distinction (féminine et aristocratique) dans la chaussure. À ses yeux, si le port du talon «donne un sexe au pied des femmes», il trouve avant tout sa fonction dans l’élévation qu’il octroie au-dessus des souillures de la rue: «C’est aux femmes de Paris qu’on doit la mode des talons hauts et minces: elle fut nécessité par la boue presque perpétuelle de la capitale. Un talon mince enlève peu de crotte, et en distribue moins aux bas et à la jupe.» (Rétif de la Bretonne, 1794: 2599) Le talon constitue une manière de rester au-dessus de la fange, de tenir à distance l’immonde pour mieux s’élever dans un monde où le talon plat ne s’est pas encore imposé comme principe d’égalité.
Petit et élevé: les deux caractéristiques du pied idéal célébré par Rétif de la Bretonne sont aussi celles qui décrivent le mieux le personnage de Fanchette. Sans fortune, sans condition, celle-ci parvient néanmoins à se sortir de sa misère et à conquérir par son mérite un statut que semblait lui refuser sa naissance, offrant au lecteur un modèle édifiant de vertu. Le Pied de Fanchette donne à voir ce que l’on pourrait appeler (faute de mieux) un «imaginaire de l’élévation» par lequel le roman du XVIIIe siècle n’a cessé de chercher à transfigurer une aspiration verticale qui, à l’aube de la Révolution, ne pouvait encore se dire que sous la forme du fantasme et en travaillant à son compte les usages, les symboles et les obsessions de son époque.
Les signes de la main
On connaît le compte rendu qu’Edmond Duranty consacra à Madame Bovary dans la revue Réalisme le 15 mars 1857, quelques mois après la publication du roman en feuilleton: «Madame Bovary représente l’obstination de la description. […] Par suite de ce système de description obstinée, le roman se passe presque toujours par gestes; pas une main, pas un pied ne bouge, pas un muscle du visage, qu’il n’y ait deux ou trois lignes ou même plus pour le décrire.» (Duranty: 79) On connaît aussi les nombreux travaux qui se sont appliqués à montrer le rôle du corps, du vêtement et des portraits physiques de personnages dans le roman réaliste et dans le roman flaubertien en particulier (pour s’en tenir à trois exemples, citons Gothot-Mersch, 1974; Czyba, 1983; Masson, 1993). Dans Madame Bovary, pas une main, pas un pied, pas un geste qui ne soit porteur de sens et qui ne s’inscrive dans l’espace des signes socialement marqués. Si la représentation du pied dans l’œuvre de Flaubert a déjà fait l’objet d’une exégèse détaillée par Florence Emptaz (et pour cause: du pied bot d’Hyppolyte aux pantoufles de peau verte du pharmacien Homais, en passant par les belles bottes de cuir verni de Rodolphe, le thème du pied émaille Madame Bovary), l’étude de la main reste encore à faire. Cette partie signifiante et agissante du corps, sur laquelle convergent images et discours, représente en effet l’une des médiations par lesquelles se manifeste la socialité du texte.
C’est par la description de sa main que le personnage d’Emma fait son entrée en scène dans le roman. Charles, en visite chez M. Rouault pour y soigner sa jambe fracturée, y rencontre celle qui deviendra sa femme. Typique de la manière dont Flaubert introduit souvent ses personnages, ce premier portrait d’Emma se construit par l’addition de petites scènes successives entraperçues par Charles, dont le point de vue circonscrit et guide la description. La main d’Emma, saisie en action au moment où celle-ci s’applique à coudre des coussinets pour le pansement de son père, suggère déjà un embarras dans les tâches domestiques: «tout en cousant, elle se piquait les doigts, qu’elle portait ensuite à sa bouche pour les sucer». Le geste, à la fois tendre et sensuel, sert d’embrayeur à une plus longue description:
Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe, et taillés en amande. Sa main pourtant n’était pas belle, point assez pâle peut-être, et un peu sèche aux phalanges; elle était trop longue aussi, et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Ce qu’elle avait de beau, c’étaient les yeux; quoiqu’ils fussent bruns, ils semblaient noirs à cause des cils, et son regard arrivait franchement à vous avec une hardiesse candide.6
Partie du bout des doigts, la narration glisse le long du bras pour remonter jusqu’au visage, où se découvre finalement la beauté qui manque aux mains. Passée la surprise causée par la vue de ces ongles épargnés par la saleté et le travail paysan, le regard se fait plus critique dès qu’il s’agit de décrire une main qui se caractérise par ce qu’elle n’est «pas», «point assez» et par ce qu’elle a en «trop». Cette première rencontre avec Emma est déjà placée sous le signe de la lacune, de ce qui fait défaut. Incapable de soutenir les promesses suggérées par les visions invitantes de blancheur, de finesse, d’ivoire et d’amande, cette main qui «pourtant n’était pas belle» force à chercher la grâce ailleurs que sur l’objet sur lequel le regard s’est d’abord arrêté. Le coup de foudre n’aura pas lieu. Dans L’Éducation sentimentale, en comparaison, l’éblouissement ressenti par Frédéric en voyant Mme Arnoux pour la première fois est total. Dans une pose semblable à celle d’Emma, Mme Arnoux brode. Quelle différence pourtant dans la manière dont est décrite son «apparition» devant les yeux déjà amoureux de Frédéric: «jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille ni cette finesse des doigts que la lumière traversait.» (Flaubert, 1954: 5) La confrontation des deux passages fait bien voir comment la description de la main d’Emma, en même temps qu’elle contribue par l’accumulation de petits détails à l’individuation réaliste du personnage, joue des stéréotypes qu’exige la mise en scène romantique de la rencontre amoureuse.
Chez Rétif, le pied de Fanchette participait d’une représentation idéalisante d’une beauté féminine éternelle. Il était volontiers représenté de façon statique, tel qu’en lui-même déjà pourvu d’une perfection plastique. La main dans Madame Bovary est quant à elle toujours donnée à voir à l’occasion d’une pose, d’un geste ou d’un mouvement qui rend sa présence signifiante dans la narration et qui inscrit sa propriétaire dans un système de valeurs. Conformément à l’usage dans le roman réaliste, la fonction sociale du personnage suit la forme de son corps et son apparence. Signe de classe et de condition, la main porte une empreinte (celle de l’histoire ou d’une vie) au même titre qu’elle en laisse une sur ce qu’elle touche. Exemple éloquent, celle de Catherine Leroux, la pauvre paysanne honorée d’une risible médaille lors des comices agricoles, porte les marques d’un «demi-siècle de servitude»:
Alors on vit s’avancer sur l’estrade une petite vieille femme de maintien craintif, et qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois, et, le long des hanches, un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d’un béguin sans bordure, était plus plissé de rides qu’une pomme de reinette flétrie, et des manches de sa camisole rouge dépassaient deux longues mains, à articulations noueuses. La poussière des granges, la potasse des lessives et le suint des laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, qu’elles semblaient sales quoiqu’elles fussent rincées d’eau claire; et, à force d’avoir servi, elles restaient entrouvertes, comme pour présenter d’elles-mêmes l’humble témoignage de tant de souffrances subies. (MB, 250)
Par son pathétique, la description transforme le corps marqué et meurtri en indice idéologique. Magnifiées par la douleur et le travail, les mains de la servante font bien voir, par contraste, la valeur que le roman attribue à celles, bourgeoises, lacunaires et sans histoire, de Mme Bovary. Seul élément distinctif de ces dernières, l’anneau nuptial qui ne remplira toutefois jamais la promesse de sa signification. La plume de Flaubert n’est guère plus flatteuse lorsqu’il s’agit de dépeindre les mains de maître Hareng, l’huissier qui se présente chez Emma pour l’inventaire de la saisie. L’animalité poisseuse évoquée par son nom se retrouve dans la mention de ses mains fouillant le pupitre où Emma garde rangées les lettres de Rodolphe, à la recherche de quelques pièces de monnaie: «l’indignation la prit, à voir cette grosse main, aux doigts rouges et mous comme des limaces, qui se posait sur ces pages où son cœur avait battu.» (MB, 435) Le contact entre les doigts de l’huissier et l’écriture manuscrite de son amant est pour Emma l’équivalent d’une profanation, il avilit le souvenir de la main aimée qui a tracé les mots sur la page. La scène résume au fond en une image forte l’expérience d’Emma tout au long du roman: le désenchantement que produit l’idéologie bourgeoise en s’emparant d’un sentiment, l’amour, finalement bien moins sacré que ce que ses rêves de jeunesse lui avaient laissé croire.
L’efficacité de l’écriture de Flaubert vient de sa capacité à nous annoncer et à nous faire voir les étapes menant à ce désenchantement à travers la description des poses et des gestes de son héroïne. Actrice et témoin de l’illusion romantique, expression de ses états d’âme, la main d’Emma suit et mime la trajectoire de ses désirs. La chose s’observe d’abord dans la tentation du personnage de vouloir se conformer aux postures stéréotypées héritées d’une certaine mythologie intemporelle de l’amour. De ses lectures de couvent, elle gardera notamment une image de langueur et de mélancolie amoureuse qui lui donnera envie d’être comme «ces châtelaines au long corsage, qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plume blanche qui galope sur un cheval noir.» (MB, 101) Quelques années plus tard, mariée et rêvant déjà d’un autre sort, le souvenir de la pose lui reviendra lorsqu’elle sentira naître en elle les premiers émois causés par Léon: «au crépuscule, lorsque, le menton dans sa main gauche, elle avait abandonné sur ses genoux sa tapisserie commencée, souvent elle tressaillait à l’apparition de cette ombre glissant tout à coup. Elle se levait et commandait qu’on mît le couvert.» (MB, 183) Le pastiche imparfait ne peut garder à distance la plate réalité des tâches ménagères et du dîner à préparer, mais il lui paraît néanmoins préférable à une vie dépourvue de ces preuves incontestables de l’amour que représentent à ses yeux «les soupirs au clair de Lune, les longues étreintes, les larmes qui coulent sur les mains qu’on abandonne». (MB, 130) Lorsque se présente à elle la possibilité de vivre un amour en accord avec l’ardeur de son désir, Emma peut finalement goûter au bonheur des amants qui, en se faisant la cour, arrivent à communiquer leurs pensées les plus intimes sans parler, par la seule jonction de leurs mains dénudées. Le texte ne manque pas de suggérer le caractère charnel d’un tel contact, comme lorsque Rodolphe, au milieu des discours des petits dignitaires réunis pour les comices agricoles, joint aux mots doux qu’il murmure le geste qui confirme à Emma leur attraction réciproque: «Rodolphe lui serrait la main, et il la sentait toute chaude et frémissante comme une tourterelle captive qui veut reprendre sa volée.» (MB, 249) Une fois débarrassées de la barrière des gants, les chairs se touchent, les doigts s’entrelacent et se confondent, mais l’abandon aux mains du riche séducteur est en même temps une capture. Ailleurs, le même geste, échangé dans le cadre d’une poignée de main douloureusement distante, sert au contraire à confirmer une rupture. C’est la voie que choisit Léon pour lui faire ses adieux:
Ils s’avancèrent l’un vers l’autre; il tendit la main, elle hésita.
— À l’anglaise donc, fit-elle abandonnant la sienne tout en s’efforçant de rire.
Léon la sentit entre ses doigts, et la substance même de tout son être lui semblait descendre dans cette paume humide. Puis il ouvrit la main; leurs yeux se rencontrèrent encore, et il disparut. (MB, 211)
Le rire est forcé, mais la moiteur de la main révèle ce que la bouche ne dit pas. Derrière l’enflure de l’image, un peu forcée elle aussi, on a du mal à dire avec assurance à qui appartient la «paume humide» dépositaire de cette très lyrique liquéfaction. Quelques chapitres plus loin, c’est encore la main d’Emma qui comblera les silences du texte et dira le mieux la nature non équivoque des retrouvailles avec le même Léon. Au milieu de la course sans fin du fiacre dans les rues de Rouen, la «main nue» passée entre les rideaux fermés fournit le seul indice explicite de la scène érotique en train de se jouer dans la voiture. Car gantée ou découverte, la main ne signifie évidemment pas la même chose, à preuve tous ces passages où le gant (de cuir, de fil, noir, jaune ou blanc) agit plutôt comme marque de distinction et de civilité — à moins qu’il ne soit source de honte, lorsqu’il se révèle, comme celui de Charles, déteint ou trop vieux. Emma est particulièrement sensible à ce genre de détails, elle qui, dans son mariage comme dans sa relation avec Léon, prend la pleine mesure de cette métaphore que le texte offre au lecteur comme une vérité générale: «le dénigrement de ceux que nous aimons toujours nous en détache quelque peu. Il ne faut pas toucher aux idoles: la dorure en reste aux mains.» (MB, 418) Métonymie des personnages, expression des silences du texte, signe lisible d’une situation ou d’un caractère, la main dans Madame Bovary est actrice de toutes les scènes importantes. Elle le sera encore au dernier acte, quand Emma plongera la sienne dans le bocal du pharmacien pour y puiser la poudre blanche qui lui donnera la mort.
***
Un exercice comme celui-ci ne peut évidemment conduire qu’à des conclusions bien partielles. À défaut de déboucher sur une lecture totalisante, l’analyse des représentations du corps dans deux romans écrits à près d’un siècle d’intervalle montre bien comment celles-ci participent à la mise en relation entre le récit et l’espace dans lequel il s’écrit. Qu’il soit traité comme objet de fantasme, révélateur de caractère, ou employé comme critère textuel de (non-)distinction, le corps romanesque est toujours une donnée socialisée qui demande à être lue comme telle. La manière dont on le décrit a ses conventions, s’appuie sur des attentes elles-mêmes déterminées par une toile de fond discursive propre à chaque époque. Le pied idéalisé de Fanchette ne «rate» pas davantage la réalité que la main d’Emma ne la reproduit exactement. D’une part, tous deux renvoient à des pratiques, à des représentations ou, pour parler comme Marcel Mauss, à des «habitus» qui, entre les XVIIIe et XIXe siècles, n’ont cessé de varier, déplaçant du même coup la clé des connotations et des significations associées à ces parties du corps. D’autre part, chacun ne trouve sa pleine signification qu’à l’intérieur de l’univers spécifique et du cadre esthétique mis en place dans et par chaque roman, celui-ci ayant pour manifester sa socialité des techniques parfois très visibles (la description «obstinée»), parfois plus diffuses, comme c’est le cas chez la plupart des pithécanthropes de Balzac.
En somme, si quelque chose rapproche le «réalisme» du Pied de Fanchette et celui de Madame Bovary, c’est peut-être le fait que l’un ni l’autre ne peuvent se résumer à la seule ambition de «reproduire le réel» ou de fabriquer l’illusion d’une extériorité palpable du texte, mais qu’ils sont, par la force des choses, pétris des significations déjà partagées et disponibles dans l’espace social qui les produit. Le pied d’Emma Bovary n’a pas la même valeur d’usage que celui de Fanchette sur le marché flaubertien des unions conjugales, et jamais la main de cette dernière, eût-elle été la plus mignonne et la plus délicate, n’eût pu l’aider à trouver son bonheur dans un roman de Rétif de la Bretonne.
Bibliographie
Bourget, Paul. 1925. «À propos d’un centenaire». Revue des Deux Mondes, p. 723.
Czyba, Lucette. 1983. Mythes et idéologie de la femme dans les romans de Flaubert. Lyon: Presses universitaires de Lyon.
Duchet, Claude. 1973. «Une écriture de la socialité». Poétique, vol. 16, p. 446-454.
Durenty, Edmond. 1857. «Réalisme». 5, p. 79.
Emptaz, Florence. 2002. Aux pieds de Flaubert. Paris: Grasset.
Flaubert, Gustave. 1954. L’Éducation sentimentale. Paris: Classiques Garnier.
Flaubert, Gustave. 2001. Madame Bovary. Paris: Flammarion, 513 p.
Gothot-Mersch, Claudine. 1974. «La description des visages dans Madame Bovary». Littérature, 15, p. 17-26.
Joly, Raymond. 1969. Deux études sur la préhistoire du réalisme: Diderot, Rétif de la Bretonne. Québec: Presses de l'Université Laval.
Le Camus, Antoine. 1754. Abdeker ou L’Art de conserver la beauté. Paris: Cuchet.
Marx, Jacques. 1974. «Le réalisme de Restif de la Bretonne». Études sur le XVIIIe siècle, 1, p. 29-38.
Masseau, Didier. 1996. «La chaussure ou le pied de Fanchette». Études françaises, 322, p. 41-52.
Masson, Bernard. 1993. «Le corps d'Emma», dans Flaubert, la femme, la ville. Paris: Presses universitaires de Fran, p. 13-22.
Mauss, Marcel. 1950. «Les techniques du corps», dans Sociologie et anthropologie. Paris: Presses universitaires de France, p. 363-386.
Popovic, Pierre. 2014. «De la semiosis sociale au texte: la sociocritique». Signata. Annales des sémiotiques/Annals of Semiotics, 5, p. 153-172.
de la Bretonne, Restif. 1769. Le Pied de Fanchette, ou L’Orpheline française, histoire intéressante et morale. La Haye / Francfort: J.G. Eslinger.
de la Bretonne, Restif. 1781. Les Contemporaines ou Aventures des plus jolies femmes de l’âge présent. Paris: Veuve Duchesne.
de la Bretonne, Restif. 1794. L’Année des dames nationales ou Histoire jour pour jour d’une femme de la République française.
de la Bretonne, Restif. 1989. Monsieur Nicolas. Paris: Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade».
Spence, Joseph. 1755. Académie des grâces. Paris: Aux dépens de la Société.
Testud, Pierre. 1977. Rétif de la Bretonne et la création littéraire. Genève: Droz.
Wymgaard, Amy. 2013. Bad Books. Rétif de la Bretonne, Sexuality, and Pornography. Newark: University of Delaware Press.
- 1. La fameuse formule de Bourget s’appuie sur cette partie de la critique qui a longtemps insisté pour faire figurer Rétif parmi les sources du réalisme et du naturalisme. La filiation n’en a pas moins été souvent critiquée et contestée, voir Joly, 1969; Marx, 1974; Testud, 1977.
- 2. Cette ambition s’affiche notamment dans la préface de ses Contemporaines: «C’est ici une histoire particulière et bourgeoise calquée absolument d’après la nature, où sont recueillis différents traits qui marquent l’esprit du temps, les usages, la manière de voir, de sentir, l’espèce de philosophie qui règne […]. On aura ainsi dans un seul ouvrage l’histoire complète des mœurs du XVIIIe siècle» (Rétif de la Bretonne, 1781: 16).
- 3. Selon le sens que donne Pierre Popovic à cette expression, c’est-à-dire «l’ensemble des façons et des moyens langagiers par lesquels une société se représente ce qu’elle est, ce qu’elle a été et ce qu’elle peut devenir» (Popovic, 2014: 159).
- 4. Rétif de La Bretonne. 1769. Le Pied de Fanchette, ou L’Orpheline française, histoire intéressante et morale. La Haye / Francfort: J.G. Eslinger, t.1, 1 (dorénavant désigné entre parenthèses par les lettres PF, suivies du tome et du numéro de page).
- 5. Ailleurs, dans le même ouvrage, l’analyse de son penchant se fait encore moins équivoque:
«Ce goût pour la beauté des pieds, si puissant en moi qu’il excitait immanquablement les désirs et qu’il m’aurait fait passer sur la laideur, a-t-il sa cause dans le physique, ou dans le moral? Il est excessif, dans tous ceux qui l’ont: quelle est sa base? Serait-ce ses rapports avec la légèreté de la marche? Avec la grâce et la volupté de la danse? Le goût factice pour la chaussure n’est que le reflet de celui pour les jolis pieds, qui donnent de l’élégance aux animaux mêmes; on s’accoutume à considérer l’enveloppe comme la chose. Ainsi la passion que j’eus, dès l’enfance, pour les chaussures délicates, était un goût factice basé sur un goût naturel. Mais celui de la petitesse du pied a seulement une cause physique, indiquée par le proverbe, parvus pes, barathrum grande! [petit pied, trou énorme!]». (Rétif de la Bretonne, 1989: vol.1, 46)
- 6. Gustave Flaubert. 1999. Madame Bovary, édition préfacée et annotée par Jacques Neefs. Paris: Librairie générale française, «Le Livre de Poche»: 72 (dorénavant désigné entre parenthèses par les lettres MB, suivies du numéro de page).