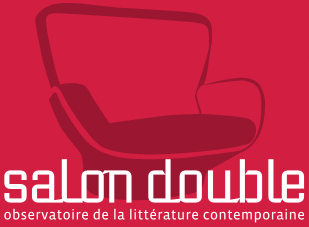Patrick Imbert, Ph.D, est né en 1974. Il est professeur titulaire à l’Université d’Ottawa et a une Chaire de recherche intitulée: «Canada: Les défis sociaux et culturels dans une société du savoir». Il a été directeur exécutif de l’International American Studies Association (2005-2009) et a été élu Président de l’Académie des arts et des sciences humaines de la Société royale du Canada en 2009. Il est vice-président de la Cité des Cultures de la paix et directeur d’un projet subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (2010-2013) qui est intitulé «Établir des paradigmes opératoires pour comparer les variations discursives dans les Amériques menant des identités enracinées, de leur inclusion ou exclusion, aux identités transculturelles dans le contexte de la glocalisation».