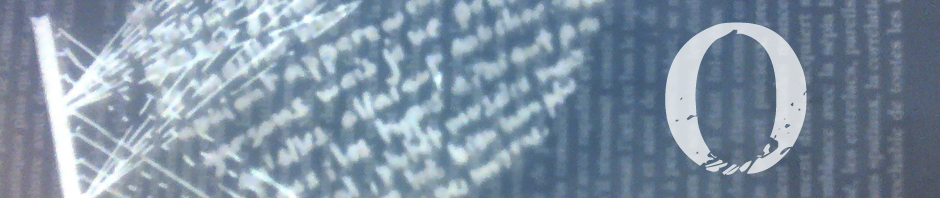– Oralité?…Vous avez dit Oralité?
Oralité du numérique?…Turn ancillaries numériques?…mais alors oralité silencieuse, oralité scripturale ou visuelle, trace d’oralité, oralité sans trace, empreinte de ce qui n’est pas conservé, oralité réflexive, en fait, on parle d’une nouvelle dimension de l’oralité. Un aspect magique du langage, oralité tissée de signes sémiotiques, non pas magiques, mais plutôt une magie des signes. Signes d’oralités dans les rues blanches et silencieuses cristallisés en bannières, affiches, panneaux, messagerie vocales, poésie des rues, oralité carnavalesque bakhtinienne transcrite en logos twitter, facebook, skype, pop ups, smileys…oralité amplifiée, démultipliée, corporelle, car derrière l’écran c’est bien le corps qui écrit et dans le texte le souffle qui passe. Le texte est-il la traduction du monde, d’un autre texte ou bien de l’oralité?
On fouille, alors, le texte à la recherche de son auralité? Barthes dirait oralité comme degré zéro de l’écriture. Un autre espace-temps, l’espace-temps total, celui du cyberspace. Espace virtuel, existant en soi, chamanique ou les mots ont le pouvoir d’agir où oralité et écriture transmuent leur identité, entrent en osmose afin de produire cette « langue des anges» que promet Metatron1
Dans son ouvrage The Barbarian within, Walter Ong écrit: «In an important theoretical sense, all of literature, and not just Homer’s epics, has a primary oral and aural existence.»
La culture numérique serait-elle l’émergence d’une nouvelle oralité? « La nouvelle oralité, explique Geneviève Pigeon de l’Université du Québec à Montréal, peut donc se priver du support vocal, musical et performatif que reconnaissait Paul Zumthor2 dans une définition générale de l’oralité en s’épanouissant au sens d’un medium virtuel dont les codes et les règles sont complètement différentes. La nouvelle oralité, ajoute-t-elle, est spontanée, désintitutionalisée et décomplexée. » L’hybridation texte-image et son pendant la navigation, évoqués par Samuel Archibald3 peut-on l’appeler l’oralité? Mc Luhan4 a remarqué « une mutation de l’oralité dans la communication », Ong5 a repris cette idée sous la forme « d’oralité seconde. » Il dit « qu’en négligeant cette oralité on omet de prendre en compte la textualité enfouie sous ces formes médiatiques et le volet auditif de leur réception. » Archibald parle, plus loin, « d’une distinction entre une médiation produite comme évènement (ce qui recouvre autant la quasi- immédiateté de la parole que la sophistication des medias audiovisuels) et une médiation produite comme trace. Évènement et trace nous ramènent à une autre typologie, celle des rapports entre oralité et littéracie. » L’oralité semble constituer l’expérience sensorielle totale par rapport à l’écrit. Mais l’écriture est une oralité qui s’est révoltée contre le temps dans son désir de mémoire… car elle est flux qui passe.
« Évènement plutôt que trace, fluidité plutôt que stabilité. La fluidité étant l’état d’un support sur lequel nous avons peu de prise, poursuit Archibalde, et dont le contenu est perceptible en surface. L’oralité est performance et fluidité, l’oralité est plus fluide que le texte parce qu’elle s’effectue plus rapidement, sa fluidité est une question d’instantané. » L’oralité comme expérience totale, donc, où écrire serait comme parler, parler comme penser, la médiation se réduisant en peau de chagrin, alors que la mimesis tend à s’actualiser dans l’espace virtuel, espace du grand mime, d’identification et d’osmose. « Le lecteur dans le cyberspace est un expérimentateur et un performer et la navigation se présente comme une lecture sans texte.» À la suite d’Ollivier Dyens, nous pressentons « que le web n’est pas un livre ni un texte.» Peut-on considérer l’espace cybernétique comme le lieu d’expérimentation d’une nouvelle oralité?
Mais, la fluidité agit à un niveau encore plus fondamental celui de l’écriture. Ong rappelle que: «Oral thought is conventional, using mnemonics and formulas to aid in recall. Oral thought is additive rather than subordinative, pulling events together in sequence rather than in relation. Oral thought is aggregative rather than analytic, putting things together rather than taking them apart, It is redundant, since oral culture cannot refer back to what was spoken.» Sur ce point, nous dirons que justement la spécificité de la nouvelle oralité numérique est sa possibilité de se constituer en langue hybride, contextuelle et abstraite, à la fois, qui se présente linéairement et tabulairement comme discours littéraire et informatif. Il semble que le contrat de lecture ratifié entre l’écrivain et son lecteur n’inclut pas la clause oralité, celle-ci reste buissonnière, un souffle, un style…L’oralité se présente alors comme ce qui rend possible l’hypertexte, justement par ses effets de juxtaposition et d’association, peut-on alors parler d’effet d’oralité comme Barthes parlait d’effet de réel?
« À la suite des Maitres du soupçon, nous nous sommes mis à écrire autrement, à reconnaitre des altérites nouvelles de l’écriture », rappelle Archibald. Comme en écho Derrida répond : «Parce que nous commençons à écrire autrement, nous devons relire autrement.»
Relire autrement, serait-ce écouter l’oralité du texte?
1- Métatron, La promesse de Métatron dans L’œil et la main, l’écran et la souris, Thierry Bardini, professeur agrégé au Département de communication de l’Université de Montréal.
2- Paul Zumthor, Performance, réception, lecture, Collection Le Préambule
3- Samuel Archibald, Le Texte et la Technique, Montréal, Le Quartanier, 2009
4- McLuhan, Understanding Media
5- Walter Ong, Orality and Literacy