
Poèmes épiques, romans, nouvelles : beaucoup des formes narratives que l’on retrouve en littérature sont le fruit de contraintes relatives à leur support. Le passage de la tradition orale à l’écriture a amené des changements majeurs dans notre façon de raconter. Le fait de pouvoir coucher sur papier un récit en construction permet de le développer davantage, de jouer avec la narration. Au XIXe siècle, l’espace restreint des journaux a popularisé les genres brefs comme la chronique et la nouvelle. Avec l’avènement récent du numérique, les nouveaux formats se multiplient à une vitesse fulgurante. Blogues, messages instantanés, hypertextes : la technologie bouleverse notre façon de lire et d’écrire. Plus que jamais, notre définition de la littérature et les conventions jusqu’ici admises sont remises en question.
Explorant certaines des possibilités qu’offre le support numérique, Détournement [1] de Serge Bouchardon remplit une double fonction : par sa forme et sa structure interactive, elle est une œuvre non linéaire, un jeu narratif qui rend le lecteur complice de l’écriture. Par son propos toutefois, elle amène ce dernier à se questionner sur sa façon de consommer la littérature et sur son rôle dans l’existence d’une œuvre. Par l’analyse des principaux thèmes abordés dans l’œuvre, puis par un survol des différents moyens techniques offerts au lecteur pour modifier Détournement, nous tenterons de mieux définir le message qui y est véhiculé à propos des nouvelles pratiques de lecture qu’amène le numérique.
Détournement est composé de cinq modules (ou « chapitres ») portant chacun un titre : « Dérouter », « Faire un détour », « Rerouter », « Tuer l’auteur » et « Bonus : détourner ». Sur la page d’accueil du site, le visiteur est invité à choisir l’un d’entre eux. Étant donné que ces sections ne sont jamais abordées dans le même ordre et parce que le nombre de liens et de fragments de texte qu’elles contiennent rendrait leur description inutilement laborieuse, nous n’aborderons que les éléments les plus significatifs dans chacune d’elles. De plus, il n’y a pas vraiment de récit au sens traditionnel du terme [2] pour servir de fil conducteur à la lecture. Comme nous le verrons, le propre de l’œuvre n’est pas d’enchaîner les évènements de façon logique et structurée : au contraire, elle fonctionne plutôt comme un enchevêtrement de voies qui font naviguer le lecteur de lien en lien.
Le module « Dérouter » sert de présentation de l’œuvre. L’auteur y établit d’emblée une relation ambiguë entre lui et le lecteur : « Lecteur, allons-nous nous accorder ? Ou très vite nous détourner l'un de l'autre ? Ou encore l'un va-t-il à détourner l'intention de l'autre ? » Dans ce préambule, le caractère passif souvent attribué au lecteur laisse place à un rôle beaucoup plus actif. La relation que le visiteur entretient avec l’œuvre est ici dynamique : l’énoncé sous-entend que l’auteur peut détourner le lecteur de son but premier (lire et ainsi détourner l’œuvre) et vice-versa. L’idée de pouvoir écarter un texte de son objectif initial est inusitée : notre perception traditionnelle de la littérature admet que durant la lecture, c’est l’auteur qui influence le lecteur, et non l’inverse. Or, ici, une sorte de compétition (à première vue inégale), un jeu instigué par l’auteur se met en place. Dès la page suivante, le lecteur est invité à participer : trois liens s’offrent à lui, chacun menant apparemment vers une voie différente. Or, la suite ne lui est révélée que s’il résiste à son envie de cliquer : les habitudes de navigation de l’internaute sont remises en question en même temps que ses habitudes de lecture. La mise en page donne au lecteur l’illusion de pouvoir progresser par lui-même dans le réseau de liens qui constitue sa lecture. L’issue de l’épreuve prouve pourtant que les résultats des actions posées par l’internaute sont préprogrammés et que son intervention, dans ce cas-ci sa non-intervention, ne fait que révéler la couche suivante de l’œuvre. N’appartient donc au lecteur que le choix du moment et de l’ordre dans lesquels se manifeste chaque élément du réseau. En effet, l’auteur de Détournement a tout mis en place pour conserver une maîtrise presque totale de son œuvre.
Malgré ce qui est annoncé dans la présentation, le récit à détourner est en fait absent. Un seul paragraphe peut être considéré comme le début d’une histoire. Il met en scène un lecteur, Jean, qui tombe par hasard sur une œuvre interactive et tente de la détourner. Le visiteur du site se retrouve donc face à sa propre histoire. Logiquement, au fil de ses interventions sur le site, il accomplit la double tâche de construire l’histoire et de la découvrir. La frontière jusqu'alors assez nette entre auteur, lecteur et acteur se brouille. La section « Tuer l’auteur » constitue le chapitre le plus significatif et le plus critique dans ce jeu sur l’identité auteur-lecteur-acteur. Dans ce module, le lecteur doit « passer de l’autre côté du miroir », c’est-à-dire accéder au code source de la page pour progresser. Une fois la nouvelle page trouvée, deux options s’offrent à lui : soit modifier le texte, soit tout laisser tel quel et considérer plutôt que les modifications qu’il fait dans sa tête au fil de sa lecture suffisent pour « tuer » l’auteur. Cette deuxième option concerne autant la littérature traditionnelle que la littérature numérique : la pluralité des lectures et l’appropriation du texte par le lecteur ont été étudiées par plusieurs penseurs. [3]
Bouchardon, pour sa part, est très conscient de l’attrait et de la nouveauté de son support, mais surtout de la façon différente dont on perçoit une œuvre numérique : immatérielle, instable et donc apparemment contrôlable. Les hyperliens sont communs à beaucoup d’œuvres hypermédiatiques et, s’ils constituent un élément de diversion pour égarer le lecteur, ils ne sont pas le moyen de participation principal de ce dernier dans Détournement. Des liens vers un blogue et vers l’adresse courriel de l’auteur permettent même au lecteur de compléter le récit de façon individuelle ou collective. Cette intervention directe sur le contenu du site contribue à brouiller la frontière entre auteur, lecteur et acteur de l’histoire. Le lecteur ambitieux qui modifie l’œuvre dans le but d’assassiner son créateur reçoit en bout de ligne une bonne leçon : « Tout ceci n'était qu'un leurre. Je suis toujours là. Tu as joué ton rôle dans un dispositif prévu par un auteur à l'ego surdimensionné. Allez, ne fais pas cette tête, cela nous a permis de mieux nous connaître. » [4] Bouchardon réserve une dernière surprise au lecteur qui a voulu modifier son histoire : « Tu as, l’espace d’un moment, été détourné de tes occupations. J’espère que tu as pris un peu de plaisir dans ce détournement. À présent, éteins ton écran et regarde, tu peux deviner le visage du lecteur. Rien de tel qu’un reflet pour une œuvre spéculaire. » [5] À la lumière de cette conclusion légèrement moqueuse, Détournement apparaît comme un pied-de-nez aux défenseurs de l’interactivité. Tout au long du parcours, Bouchardon donne à son lecteur l’illusion de contrôler l’œuvre. Or, par la boutade de la conclusion (« éteins ton écran et regarde, tu peux deviner le visage du lecteur »), l’auteur affirme sa présence et son pouvoir, tout aussi grand dans une œuvre hypertextuelle que dans une œuvre imprimée. Ce pouvoir de l’auteur est d’ailleurs mis de l’avant par une citation de Diderot tirée de Jacques le fataliste et son maître :
Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me plairait. Qu'il est facile de faire des contes ! [6]
L’intertextualité entre Bouchardon et Diderot crée un lien étroit entre les deux textes malgré leurs supports et leurs fonctionnements radicalement différents.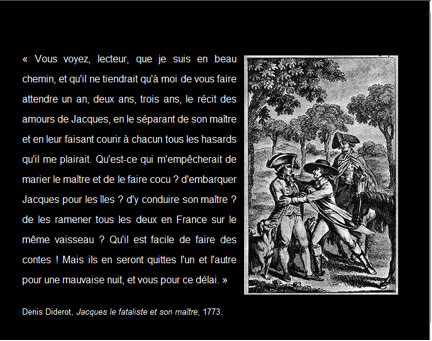
Pour faire avancer la réflexion du lecteur à propos des détours et des enjeux que provoque l’interactivité dans les hypertextes, Bouchardon a ajouté en « incise » des textes qui soulèvent la même question. Dans la section « Faire un détour », sous « Littérature », on retrouve notamment un lien vers un texte de Jean Clément, « La littérature au risque du numérique » [7]. Celui-ci traite des changements que la littérature numérique amène dans la conception traditionnelle du livre, de la lecture, de l’édition, etc. La présence de ce texte parmi les multiples liens de Détournement en appuie la visée informative, la tentative de conscientisation de Bouchardon :
La prise en compte du lecteur dans le processus de formation de l’œuvre donnée à lire fait naître une nouvelle problématique qui est notamment présente dans les hypertextes. En plaçant le lecteur en situation d’acteur, la littérature ne risque-t-elle pas de perdre une partie de ses privilèges en matière de narration au profit d’un jeu dramatique dans lequel le lecteur s’improvise auteur/acteur. Là encore, l’œuvre littéraire se trouve confrontée à sa disparition. [8]
On reconnaît très bien Détournement dans ce texte : dépourvu de récit, il laisse une place majeure au « jeu dramatique ». Malgré tout, l’opinion de Bouchardon est plus nuancée que celle émise par Clément. En fait, tout porte à croire que Bouchardon ne voit pas du tout le numérique comme une menace pour la littérature. En effet, le lien vers le texte de Clément est inscrit dans une page où Bouchardon mentionne les récits enchâssés chez Scarron et les écrits labyrinthiques de Borges. Il y glisse aussi le lien vers la citation de Diderot qui, dans Jacques le fataliste et son maître, s’adresse à son lecteur. Ainsi, si l’implication du lecteur est plus grande dans la littérature numérique, Bouchardon prouve que c’est un phénomène ni nouveau, ni marginal. De plus, comme nous l’avons vu, les paramètres de l’interactivité sont toujours déterminés par l’auteur. La narration, bien que différente, n’est donc pas absente ou dégradée dans les hypertextes : elle passe plutôt d’une structure linéaire à une structure arborescente.
Le deuxième module, « Faire un détour », élabore tout un discours sur le détour, le labyrinthe, la digression. « Le lecteur souhaite détourner l'histoire qu'il est en train de lire. Mais il est lui-même pris dans différents détours. Les détours suivants sont tous légitimes et véridiques, car jamais détour ne ment. » [9] Parmi les détours « légitimes et véridiques » offerts au lecteur, se trouvent la littérature, l’art, la mythologie, le jeu et un onglet trompeur intitulé « Lire sans détour ». Les sections « Mythologie » et « Lire sans détour » constituent en quelque sorte des commentaires sur le caractère labyrinthique de la navigation sur Internet.
Dans la première section, le lecteur est conduit sur le site d’un jeu, « Les 12 travaux de l’internaute », qui vise à mythifier nos gestes quotidiens « pour pouvoir les démystifier, mais dans le même temps [les] transfigurer. » [10] Ce jeu permet de se questionner sur l’impact de la technologie dans nos vies — un propos tout à fait en lien avec celui de Détournement, mais à plus grande échelle. Le but du jeu est de survivre au réseau. Pour ce faire, il faut vaincre des obstacles technologiques associés aux douze travaux d’Hercule (par exemple, l’hydre de Lerne est remplacée par des fenêtres intempestives qui se multiplient quand l’internaute les ferme). La question de la survie de l’internaute rejoint celle de la survie de la littérature : pour triompher, l’un et l’autre doivent apprendre à composer avec le numérique, se l’approprier pour en tirer un maximum de possibilités.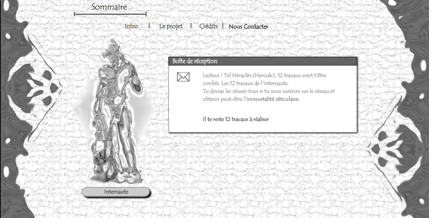
La page « Lire sans détour », comme le piège qui attendait le lecteur au tout début de son périple, est révélatrice par sa forme arborescente et son propos :
Pris dans un labyrinthe de liens, comment vas-tu t'en sortir ? Dans ce voyage immobile, tu empruntes des trajectoires à la recherche d'indices. De nœud en nœud, de fragment en fragment, tu navigues entre l'impression d'effectuer un travail herculéen et celle d'une perte de temps, à la poursuite d'un lien introuvable. Anonyme dans ce réseau inextricable, tu es désorienté. Il existe pourtant une solution. Un lien acceptera d'être touché et te conduira vers la fin. [11]
La plupart des mots de ce texte sont des boutons qui mènent soit à une image, à une citation ou à une autre œuvre hypertextuelle qui possède elle aussi une multitude de liens. Le lecteur qui joue le jeu se perd donc dans un dédale de pages. La logique du détournement qui règne dans l’œuvre atteint ici son paroxysme et le contenu de l’œuvre est renforcé par la forme. Sans les hyperliens associés aux mots, le lecteur ne se reconnaîtrait pas du tout dans le texte. Ainsi, contrairement à d’autres œuvres hypermédiatiques qui ont été adaptées en format papier, Détournement ne peut exister et livrer son message de façon efficace que sur Internet. Les dispositifs mis en place dans l’œuvre permettent au lecteur d’y participer, mais confèrent aussi une certaine matérialité aux mots. Comme le soulignent Bertrand Gervais et Nicolas Xanthos dans « L’hypertexte, une lecture sans fin » [12], le visiteur de la page de Détournement ne lit pas les mots qui s’y trouvent pour en extraire une histoire. Ce sont les liens qui l’attirent :
Un autre effet des conventions hypertextuelles actuelles est une fixation sur le mot, mais un mot graduellement vidé de sa charge sémiotique, elle-même remplacée par une charge informatique. Dans l’hypertexte fictionnel, le mot est le lieu d’un conflit : d’une part, il est, comme à l’écrit, signe linguistique ; d’autre part, il est parfois un bouton, au sens informatique du terme. [13]
La matérialité que le mot acquiert dans l’œuvre permet de le détourner afin de rediriger le lecteur vers une autre page. Le mot, premier matériau de la communication depuis la tradition orale, gagne une nouvelle dimension, une nouvelle fonction grâce à Internet. En plus de sa « charge sémiotique », le mot acquiert une « fonctionnalité » qui en multiplie le symbolisme. Le mot en tant qu’hyperlien est une porte vers de nouveaux éléments de sens, que ce soient des images, des sons, des vidéo ou d’autres textes. Ces éléments peuvent avoir un lien plus ou moins étroit avec la signification d’origine du mot : celui-ci devient donc un prétexte à des associations plus libres, les images, par exemple, étant porteuses de sens, mais d’une façon tout à fait différente. La signification linguistique des mots-liens est en quelque sorte diluée au profit d’associations plus instinctives, détachées du langage et, d’une certaine manière, beaucoup plus riches.
Exploitant cette idée de la signification des images, le module en bonus, « Détourner », incite le lecteur à détourner des images afin de les ajouter à une banque collective. Celles-ci sont utilisées à plusieurs endroits dans Détournement, notamment sur la page d’accueil. Chaque nouvelle connexion au site fait apparaître une illustration différente. Plusieurs d’entre elles évoquent le problème de la consommation. Par exemple, on peut voir sur l’une d’elles un encadré qui dit : « Attention! Ne mets pas tes yeux sur les pubs, tu risques de te faire manipuler très fort ». Une autre montre un panneau publicitaire sur lequel on a gribouillé : « La consommation = L’opium du peuple ». Dans la section « Faire un détour », l’onglet « Art » nous amène dans une galerie de photos d’œuvres d’Ingres, de Man Ray et de Witkin représentant des corps de femmes. Soumis aux canons de leurs époques respectives ou aux fantaisies des artistes, leurs corps sont modifiés, dénaturés, détournés. Ces images évoquent toutes le problème de la consommation, des modes et de la manipulation par les médias. Pour le lecteur attentif à ces détails, le module « Détourner » ne se présente plus comme un jeu en supplément de l’œuvre, mais comme une façon de se questionner sur la propriété intellectuelle des créations mises sur Internet et sur notre attitude face à celles-ci. La notion de détournement prend ici un sens nouveau : au-delà du détournement des mots et des histoires dans le monde du numérique, il y a aussi une manipulation des informations et, surtout, une manipulation des esprits.
À mi-chemin entre le jeu et la littérature, Détournement de Serge Bouchardon vise d’abord et avant tout à sensibiliser les lecteurs aux enjeux qu’entraîne le numérique. Bien que l’interactivité donne au lecteur l’impression d’avoir le contrôle sur ce qu’il lit, l’auteur reste en grande partie le maître de son œuvre. Leurs rôles respectifs sont moins fixes que dans la littérature traditionnelle, certes, mais Bouchardon ne semble pas voir le mélange entre littérature et technologie comme une menace. La présence d’articles théoriques sur l’hypertexte parmi les liens prouve que l’auteur veut d’abord et avant tout provoquer une réflexion chez son lecteur. Une grande partie du propos de l’œuvre est soutenue par sa forme : sans les multiples hyperliens pour dérouter le lecteur, le discours sur la dimension labyrinthique du Web n’aurait que peu de poids. La profusion des liens et des œuvres disponibles en un clic sur Internet soulèvent des questions à propos de leur consommation. Bouchardon le souligne à plusieurs reprises : le choix de continuer la lecture et de s’y investir totalement repose entre les mains du lecteur. Par contre, ce pouvoir de décision ne le protège pas de la manipulation. Tout consommateur risque de se faire prendre au piège, particulièrement dans une zone où il est facile de détourner des informations. Bouchardon dénonce cette réalité en offrant à son lecteur l’occasion de détourner des images et de modifier le texte de son site. Visiblement Bouchardon ne craint pas qu’Internet fasse disparaître la littérature. La confrontation auteur-lecteur qui structure Détournement laisse plutôt croire que les principaux dangers de la littérature hypermédiatique guettent le lecteur lui-même. Que devient la lecture quand changent les paramètres établis depuis des siècles ? Que devient la lecture quand le lecteur se considère comme la clé de toute œuvre interactive ?
[1] Bouchardon, Serge, Détournement, en ligne: http://wwwcyg.utc.fr/si28/detournement/index.html (consulté le 3 avril 2010).
[2] « Au sens large, tout texte narratif ou à dominance narrative, qui raconte, par le biais d’une instance de narration, une histoire constituée d’une série d’évènements concernant des personnages. » Source : Van Gorp, Hendrik et al. (2005) « Récit » dans Dictionnaire des termes littéraires, Paris: Honoré Champion, collection « Champion Classiques», p. 406.
[3] Par exemple, Michel de Certeau voit la lecture comme un braconnage : son lecteur est actif, sélectif, au-dessus du texte. Voir de Certeau, Michel (1990) L’invention du quotidien, Tome I, Paris: Gallimard, 347 pages
[4] Bouchardon, Serge, Détournement, op. cit.
[7] Clément, Jean (2001) « La littérature au risque du numérique », en ligne : http://www.cairn.info/article.php?
ID_REVUE=DN&ID_NUMPUBLIE=DN_051&ID_ARTICLE=DN_051_0113 [Site consulté le 3 avril 2010].
[9] Bouchardon, Serge, Détournement, op. cit.
[10] Bouchardon, Serge, Les 12 travaux de l’internaute, en ligne : http://www.les12travaux.com/ (consulté le 11 avril 2010)
[11] Bouchardon, Serge, Détournement, op. cit.
[12] Gervais, Bertrand et Xanthos, Nicolas, « L’hypertexte, une lecture sans fin », dans astrolabe, en ligne: http://www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe/articles/art0036.htm (consulté le 9 avril 2010)
