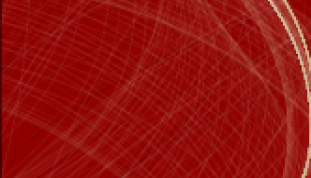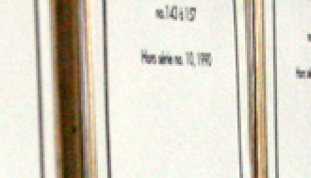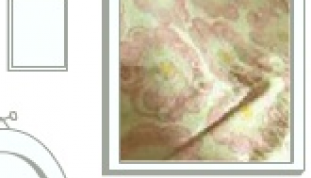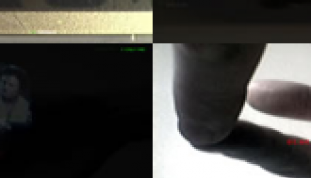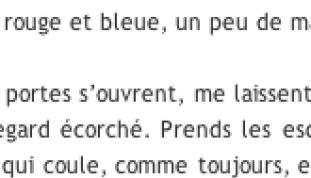En art comme en littérature, les artistes se sont appropriées le Web, détournant ses pratiques et son langage. Les œuvres ainsi produites, inscrites à même les nouvelles technologies, sont destinées à être expérimentées et lues par le biais d’Internet. Comme ces œuvres se présentent dans des formats nouveaux, les outils habituels de description, que ce soit en études littéraires ou en histoire de l’art, ne suffisent pas. De plus, l’institutionnalisation de ces œuvres n’est pas encore assurée, aucune bibliographie, aucun répertoire complets ne les regroupent.
Au cours de l’année 2006, l’équipe du groupe de recherche Arts et littératures hypermédiatiques, associée au NT2, a donc travaillé à la recherche et à la description d’œuvres hypermédiatiques, acquérant ainsi une expertise unique en la matière. De nombreux problèmes ont été rencontrés, certains ont été solutionnés, des pistes de réflexion ont été ouvertes. Ces analyses et réflexions ont données lieu à une journée d’étude, qui s’est tenue en septembre 2006 à l’Université du Québec à Montréal. Les chercheures, chercheurs de l’UQAM, de Concordia, de Laval et d’Ottawa, sous la direction de Bertrand Gervais, de Joanne Lalonde, d’Ollivier Dyens, de René Audet et de Christian Vandendorpe, ont partagé leur expérience de la phase d’exploration de ces œuvres. Cette première année de recherches a donné lieu à un Répertoire des arts et littératures hypermédiatiques, comprenant des milliers d’entrées, décrivant et classant les différentes manifestations d’art et de littérature hypermédiatiques.
Dans son intervention, Marianne Cloutier aborde la démarche générale du groupe de recherche en arts hypermédiatiques, mettant en relief le mandat, le choix des œuvres ainsi que le système des labels qui soulignent à la fois les grandes thématiques de celles-ci et témoignent de l’expérience de l’internaute. Amélie Langlois Béliveau expose le volet littéraire de ces problématiques, liées à la constitution du corpus, tout en expliquant l’apport du système de cote, instauré par les chercheures, chercheurs qui est intervenu pour palier à certains problèmes rencontrés lors de la description des oeuvres. Valérie Comtois, pour sa part, se penche sur un des aspects principal du Répertoire — les mots-clés — tout en s’attaquant à un terme descriptif essentiel et problématique : la « Navigation à choix multiples ». Poursuivant la réflexion sur les mots-clés vus à la fois comme essentiels et réducteurs, Paule Mackrous propose l’ajout de son corollaire, le label, plus interprétatif et plus à même de décrire l’expérience de l’oeuvre.
Moana Ladouceur amorce quant à elle un questionnement sur l’intentionnalité et l’autorité de l’auteure, auteur dans le processus d’interprétation des œuvres hypermédiatiques. Par ailleurs, Amélie Paquet discute l’aspect ludique observé, dans maintes oeuvres décrites, qui mine la lecture de ces dernières. Valérie Cools et Alexandre Béland-Bernard, de leur côté, se sont intéressés à une forme d’œuvre particulière, le blogue littéraire, et tentent de faire ressortir l’aspect novateur d’une des sous-catégories issues de leurs recherches, le « blogue œuvre ».
Ces recherches ont été réalisées grâce à une subvention du CRSH, obtenue dans le cadre du programme Les textes, les documents visuels, le son et la technologie.