
Une première version de ce texte a été présentée le 15 octobre 2010 au colloque «De la presse au numérique: Que font les médias à la littérature?», à l’Université Laval (Ste-Foy).
afternoon, a story de Michael Joyce, écrit en 1987 et publié une première fois par Eastgate Systems en 1990 [1], est considéré comme un des classiques fondateurs dans le domaine des hypertextes de fiction, aux côtés d’œuvres comme Victory Garden de Stuart Moulthrop [2] et Patchwork Girl de Shelley Jackson [3]. Aujourd’hui, il est rare qu’un cours ou qu’un séminaire sur la littérature hypermédiatique soit donné sans qu’il en soit fait mention. Pour reprendre un des auteurs du projet The Electronic Labyrinth, à propos de sa propre expérience de l’œuvre:
It seemed entirely appropriate that the first computer on which I read Michael Joyce's afternoon, a story was located in the Classics Department of a major university. By the time I viewed the opening screens, six years after the text first appeared, afternoon was firmly established as a classic of hypertext writing. The Whole Earth Review has called it «an information age Odyssey». [4]
Si on se concentre sur le récit par défaut d’afternoon – c’est-à-dire si on se contente de peser sur la touche «Retour» pour traverser le texte –, l’œuvre de Michael Joyce raconte une journée vue par Peter, un homme qui pense avoir été témoin d’un accident de voiture dans lequel son ex-femme et son fils auraient été impliqués. L’accident a lieu le matin, et on suit pendant toute la journée les efforts de Peter pour déterminer si les victimes étaient bien son fils et son ex-femme et, le cas échéant, si ceux-ci sont seulement blessés ou morts. Il va, entre autres, contacter le bureau de son ex-femme, son nouveau conjoint, l’école que fréquente son fils et même l’hôpital pour essayer de les retracer; il va aussi revisiter le lieu de l’accident pour trouver des indices; mais c’est finalement sans réponse définitive qu’il se couche à la fin de la journée.
Au plan technique, afternoon a été créé avec le logiciel Storyspace [5], développé par Jay David Bolter et Michael Joyce lui-même dans les années 1980. C’est un logiciel conçu pour la rédaction d’hypertextes de fiction qui permet de déployer plusieurs récits arborescents à partir de quelques lexies de texte de base – ici, le récit par défaut que nous venons de décrire – et de contrôler la manière dont le lecteur peut progresser à travers ces récits. Dans le cas d’afternoon, on peut se promener d’une lexie à l’autre pendant la lecture en cliquant sur certains mots du texte qui renferment des hyperliens; en utilisant les touches «oui» ou «non» au bas de l’écran pour répondre à des questions simples; en inscrivant dans un champ de saisie spécialement conçu certains mots – par exemple, des pronoms interrogatifs; ou encore en consultant simplement la liste disponible pour chaque lexie des liens actifs et protégés pour y sélectionner une destination spécifique. Bref, avec afternoon, on est dans une logique de lecture tabulaire qui fonctionne à la fois par sélection, association, contiguïté et stratification [6].
Dans une perspective critique, cependant, le principal «défaut» d’un dispositif hypermédiatique de programmation et de lecture très technique comme celui d’afternoon est de reléguer au second rang la proposition textuelle au profit de la technicité de sa lecture. La technicité de l’hypertexte sur ordinateur nous amène en effet souvent à confondre exploration du medium et interprétation du texte. Comme l’écrivaient Bertrand Gervais et Nicolas Xanthos:
On porte peu attention à la lettre du texte, au grain de sa signification, on s’amuse et épuise son attention au niveau de la forme, du dispositif offert, l’enchaînement des fragments, les possibilités visuelles et sonores, la dimension technique du médium. […] On débat des vertus et possibilités du médium, on identifie les premières ou plus surprenantes fictions rencontrées, celles de Stuart Moulthrop ou de Michael Joyce, quand ce n’est pas Cosmos de Gombrowicz, mais on ne les donne pas à lire, on ne les étudie pas. [7]
C’est ce que déplore aussi Espen J. Aarseth dans son ouvrage Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, lorsqu’il affirme que «[i]nstead of asking, What have I read? the critic might become preoccupied by the question, Have I read all? and come to identify the task of interpretation as a task of territorial exploration and technological mastery» [8].
Dans le cas d’afternoon, ce biais technique dans la littérature critique est on ne peut plus évident. Jay David Bolter, par exemple, parle d’afternoon comme traitant du problème géométrique de sa propre lecture, faisant abstraction de tout contenu narratif [9]. Astrid Ensslin, de son côté, semble d’abord aborder afternoon comme un roman psychologique, évoquant une certaine parenté entre Michael Joyce et Franz Kafka ou J. D. Salinger, mais rejette aussitôt sa propre hypothèse pour retourner à l’«essentiel» du texte, c’est-à-dire la question des insertions macro- et micro-structurelles du récit [10]. Tout pour la forme, rien pour le contenu.
Autrement dit, la technicité du dispositif de lecture d’afternoon entraîne les critiques dans une entreprise involontaire de désinformation, où le texte entier est pensé comme étant inaccessible, masqué par le problème que pose sa propre forme. Par exemple, dans une critique de Jean Clément: «la multiplication des débuts nous fait soupçonner que quel que soit le nombre des lectures qui s'offrent à nous, nous ne saurons jamais tout de l'histoire» [11]. Ou encore, chez J. Yellowlees Douglas: «As I completed each reading, however, I remained painfully aware of my reading representing only one among many actualizations of the narrative’s constellation of possibilities» [12]. On nous donne à penser qu’afternoon est un texte trop monumental ou que sa structure est trop complexe pour en effectuer une lecture globale, ce qui entraîne malheureusement une multiplication des interprétations partielles et des fausses pistes dans la littérature critique. Nous pouvons penser ici aux déclarations étranges (et très discutables) de J. Yellowlees Douglas à propos des supposés évènements mutuellement exclusifs dans le récit [13] ou d’Ilana Snyder sur l’absence d’intrigue et de causalité [14].
Mais afternoon n’est pas un générateur de texte et reste composé d’un ensemble fini de lexies. Plus encore, Michael Joyce n’a pas conçu afternoon comme une œuvre postmoderne où le lecteur se perd dans les marges du réel et où le temps se divise en unités irréconciliables. Il s’agit d’un simple roman moderne sous forme hypertextuelle. Pour citer l’auteur lui-même à propos des différents chemins de lecture possibles et des arborescences du récit: «There are not versions, but the story itself in long lines» [15].
Dès lors, comment retrouver une perspective critique juste face à afternoon? Nous croyons que le meilleur moyen est de commencer par cartographier la structure d’afternoon afin d’en saisir l’ampleur réelle, bien en-deçà de ce qu’ont pu nous faire croire certains critiques qui ont comparé afternoon avec, par exemple, l’Odyssée d’Homère [16]. Toutefois, afternoon ne contient pas d’index général des lexies permettant d’en effectuer une cartographie rapide. Nous devons donc, pour en modéliser la structure, opérer un détournement des outils de navigation offerts par Storyspace.
Comme nous l’avons déjà mentionné, une fonction disponible dans afternoon permet d’ouvrir une liste de l’ensemble des destinations accessibles à partir de chaque lexie rencontrée pendant la lecture.
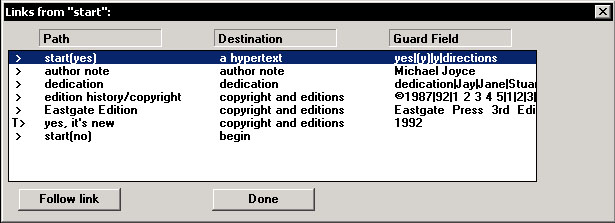
[Fig. 1] Interface montrant la liste des destinations accessibles à partir d’une lexie unique.
Même si certaines des destinations sont bloquées par des champs de garde activés ou désactivés en fonction du chemin déjà parcouru par le lecteur, ce dernier peut à n’importe quel moment passer au-delà de ces champs de garde pour accéder à toutes les destinations en utilisant l’interface de la liste. En passant par les listes, il est donc possible de répertorier l’ensemble des lexies et de déterminer le nombre minimal de sélections nécessaires pour accéder à n’importe laquelle d’entre elles, nombre qui indique le niveau d’accès de chaque lexie. De plus, comme le nombre de lexies total est fini, le nombre de niveaux sera lui aussi fini.
Avec un peu de travail, on peut ainsi mettre sur pied une carte d’accès permettant de retrouver son chemin vers n’importe quelle lexie et de répertorier facilement tous les parcours menant à un même point. Dans afternoon, on dénombre au total 532 lexies réparties sur 37 niveaux (incluant le niveau 0 de l’écran d’accueil), formant une courbe culminant à la 78e lexie du 5e niveau, avec un seul lien mort, attribué à la lexie de 5e niveau intitulée «yes».
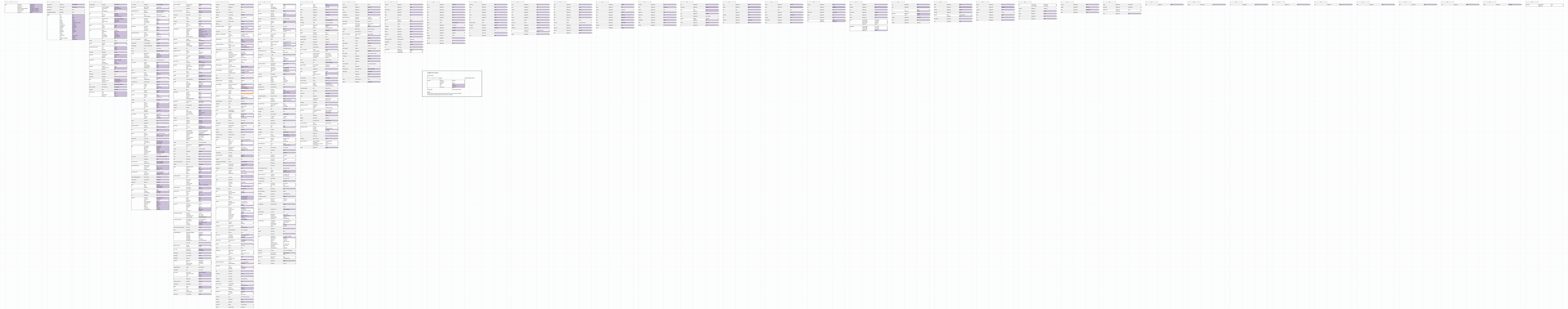
[Fig. 2] Tableau détaillé des lexies d’afternoon. Pour télécharger et consulter le tableau en format .jpg, utiliser ce lien.
Notons que dans ce tableau, les lexies sont classées verticalement par ordre de première apparition par rapport aux listes des lexies du niveau inférieur immédiat, la donnée centrale indique le chemin d’accès régulier, les entrées listées en mauve identifient les liens menant vers les lexies du niveau supérieur immédiat et le chiffre indiqué au bout de chaque entrée réfère au niveau de la lexie de destination.
Dans un sens, il est certain que ce tableau est moins attrayant que plusieurs discours de complexification qui se sont développés autour d’afternoon avec le temps. Mais en passant par une modélisation mathématique de l’hypertexte, nous avons la chance de lui donner une certaine évidence géométrique qui permet de dépasser sa technicité pour plonger dans le texte lui-même – un peu à la manière dont, par automatisme, on soupèse un livre que l’on s’apprête à lire pour en évaluer le volume. En prenant conscience de l’étendue d’un hypertexte, on cesse d’être intimidé ou fasciné par son déploiement.
D’ailleurs que devient afternoon une fois qu’on l’a déplié et lu dans son entièreté? Si la tendance générale est de comprendre le récit par défaut comme étant le centre thématique nerveux de l’œuvre, cette lecture résiste-t-elle à une approche plus systématique? En fait, à la lumière d’une lecture exhaustive d’afternoon, on observe au contraire que les arborescences ouvrent sur des déviations radicales qui nous entraînent sur de tout autres territoires, plus proches des thèmes qui reviendront ensuite dans les autres œuvres de Michael Joyce.
Après la phrase-choc placée en début de texte – et souvent citée par les critiques – «I want to say I may have seen my son die this morning» (aft., «I want to say»), une des premières actions opérées dans le récit est la mise à distance du fils. Lorsqu’il se rappelle de l’accident, Peter ne met jamais le fils au premier plan, se concentrant plutôt sur le corps de son ex-femme «so beautifully there upon the wide green lawn» (aft., «white afternoon»). Le fils paraît étrangement accessoire, comme le souligne l’interrogation d’un autre personnage s’adressant à Peter: «Whom are you concerned with? Her or him?» (aft., «Whom») Peter est d’emblée ambivalent, allant jusqu’à admettre qu’une partie de lui-même serait «soulagée» par la mort de son fils (aft., «storm tossed»). Cette mise à distance du fils dans le texte s’accompagne parallèlement d’un mouvement de convergence vers le personnage de Werther, le patron de Peter. C’est lui, et non le fils, qui constitue le point d’attention des angoisses de Peter. Ce recentrage des préoccupations entre l’ouverture du récit par défaut et le reste du texte est clairement mis en évidence lors de la session de consultation entre Peter et Lolly, dans le fragment intitulé «Penelope»: «<How much of this is about him?> she asks. I think she means my son. <I miss him -- I say -- when I found his school paper I began to cry. These tears are only a continuation.> <I understand -- she says -- but I meant Werther.>» Peter a peur de Werther, et c’est cette peur qui met en relief la clef herméneutique d’afternoon.
Nous entendons par là que Peter est présenté comme un être hybride et féminin (aft., «monsters») à la psychologie problématique, et que c’est son opposition à Werther qui alimente le récit, tout comme l’opposition entre la femme de Werther, Lolly, et l’ex-femme de Peter, Lisa, pose la nécessité de la mise à mort de cette dernière.
En effet, afternoon repose sur une dynamique à deux couples: Werther/Lolly d’une part, et Peter/Lisa de l’autre. Werther, d’un côté, représente une nouvelle masculinité, plus jeune et agressive. On ne connaît rien de ses parents, si tant est qu’il en a; il construit constamment de nouvelles versions de lui-même, mentant de façon éhontée sur ses origines ethniques et religieuses; et jamais il n’assume une quelconque position de paternité. Symboliquement, on peut l’assimiler à son logiciel, le WUNDERWRITER R, développé à l’aide d’un système de calcul complexe reposant sur l’anonymat total des analystes nourrissant ses banques de données et capable de déterminer la valeur mathématique de tout. Werther est une figure menaçante, un véritable prédateur obsédé par l’établissement d’un ordre nouveau. Comme le souligne Peter dans une des premières lexies où il est question de Werther: «Have I mentioned that he is younger than I? It isn’t something I think of, though I think it fair to say it’s something never far from his mind» (aft., «Werther3»).
Lolly, la femme de Werther, est présentée comme un «miroir» (aft., «Medusa»), c’est-à-dire comme l’image inversée de la masculinité agressive de Werther. Elle parle longuement de sa famille, fournissant une multitude de détails sur ses origines; elle dit porter son nom un peu comme un bateau, en symbole des désirs refoulés des femmes de la génération précédente (aft., «Lolly2»); plus encore, elle est déjà littéralement devenue sa mère en prenant l’identité de celle-ci pour s’enfuir en Asie, dans sa jeunesse. Aussi, elle ne comprend pas les hommes et travaille comme thérapeute, dans le domaine de l’in-quantifiable. Elle pratique d’ailleurs avec ses clientes un genre de corps à corps nu visant à recréer un lien organique pour servir de base à l’établissement d’une nouvelle sororité.
Bref, Werther et Lolly représentent le devenir duel de l’humanité et sont résolument les produits du «dry age» (aft., «early eighties») pendant lequel se déroule afternoon.
Peter et Lisa, au contraire, forment une espèce de couple océanique impossible et dépassé, Michael Joyce se servant constamment de l’image de la mer pour souligner leur caractère humide, fusionnel et hybride. Leur existence va à l’encontre du devenir de l’humanité et réclame leur destruction. D’ailleurs, si Peter ne meurt pas lui-même, contrairement à Lisa, c’est seulement pour être changé – ou «sauvé» (aft., «The Good Soldier») – par l’abandon de son hybridité.
Le titre de l’œuvre, afternoon, réfère donc à cet entre-deux, à cette période dormante de mutation avant une nouvelle ère active. Ce n’est plus l’ère de Peter et Lisa, le couple hybride, mais ce n’est pas encore tout à fait celle de Werther et Lolly non plus. Cette théorie revient doublement dans le récit, d’abord à propos des journées d’été pendant lesquelles on ne vit que le matin et le soir, passant l’après-midi à attendre sous la chaleur sèche, puis à propos de l’histoire humaine à plus grande échelle:
in each of the last three centuries in the West, the dominant culture went in «cyclic dormancy,» in preparation for the efflorescence which followed in the first decades of the new. [...] We are no different. We live in a dry age which awaits the discovery and flowing forth of our granddaughters. (aft., «early eighties»)
afternoon nous amène au seuil du réveil, à deux doigts d’une nouvelle ère, et la transformation de Peter symbolise les mutations au cœur de cette période de dormance: rejet du fils, migration de la banlieue humide et vivante vers la ville sèche et impersonnelle, dépendance grandissante des hommes aux machines représentées par les systèmes WUNDERWRITER R et Datacom, etc. Peter est en train d’être assimilé par Werther. La terreur qu’il éprouve est liée à sa propre transformation, de plus en plus difficile à nier. Par exemple, lorsqu’il parle des contrecoups psychologiques de l’accident de son fils avec Lolly: «<I had an awful dream.> I say, and the voice fails to convince me. It seems farther and farther away, like the sound of ships steaming away in submarine movies. [...] <It was an awful dream. Awful!> I insist» (aft., «no, luv»). Peter n’arrive plus à croire en sa propre performance.
Pour analyser ce processus de transformation, notons que nous pourrions aussi nous pencher sur le rôle de Nausicaa comme incarnation de la figure de la sage-femme, présente dès les premiers fragments d’introduction (aft., «midwife»). Responsable du bon déroulement de la nouvelle naissance de Peter, elle s’efforce de l’engager dans une dynamique de couple semblable à celle du couple Werther-Lolly. Et même si le récit ne se rend pas jusqu’à l’aboutissement du processus de transformation lui-même, l’issue est tout de même déjà annoncée: «The Princess gets her Prince and a little death hardly seems an awful price to pay» (aft., «gift of speech»).
Bref, afternoon annonce la mutation du masculin en un genre de régime anti-générationnel intenable: les hommes ne reconnaissent plus leurs pères, ils disparaissent derrière les machines, ils cessent de penser à leurs fils et ils flirtent avec l’autodestruction. Ce n’est pas pour rien que l’incarnation de cette nouvelle masculinité porte le nom de Werther, clin d’œil au célèbre roman épistolaire de Goethe se soldant par le suicide du personnage principal. C’est aussi plutôt entre les mains des femmes que Michael Joyce place l’avenir de l’humanité, leur confiant les commandes de la nouvelle ère qui s’annonce. La nomination des femmes comme nouvelles héritières est explicite dans ce passage que nous avons cité plus tôt: «We live in a dry age which awaits the discovery and flowing forth of our granddaughters» (aft., «early eighties»), mais s’exprime aussi plus subtilement dans les discussions récurrentes sur l’ouverture d’une nouvelle période philosophique féministe (voir notamment aft., «post-feminist»).
Finalement, les blessures subies par le fils dans l’accident n’ont aucune importance. Mort ou vivant, il n’a déjà plus de père. Par sa jeunesse, il fait d’emblée partie de la masculinité d’avenir représentée par Werther. Comme l’annonce de façon prophétique la secrétaire de l’école que son fils fréquente lorsque Peter essaie de savoir si celui-ci est en classe: «There’s a permission on file, I tell you, for an explorat’ree to the Cognitive Science la-bore’tree at the University. He’ll be interacting with robots even as we speak» (aft., «Cognitive Sigh»). afternoon ne raconte pas l’angoisse d’un père qui pense avoir perdu son fils, mais celle d’un homme qui découvre que, quoiqu’il arrive, il ne sera plus jamais père.
En dépassant la technicité de l’hypertexte grâce à une approche méthodique de sa structure, il est donc possible de procéder à une véritable analyse littéraire d’afternoon. Au-delà du caractère spectaculaire de sa forme, afternoon demeure un texte à lire – ou, pour faire écho à Samuel Archibald: en dépit de la place prépondérante accordée à l’interface dans les médias numériques, l’altérité du texte ne déserte pas obligatoirement ses structures sémiotiques internes [17].
[1] Michael Joyce (1990 [1987]) afternoon, a story. Watertown (MA): Eastgate Systems.
[2] Stuart Moulthrop (1991) Victory Garden. Watertown (MA): Eastgate Systems.
[3] Shelley Jackson (1995) Patchwork Girl. Watertown (MA): Eastgate Systems.
[4] Christopher Keep, Tim McLaughlin et Robin Parmar (2006) «Afternoon: A Reading», The Electronic Labyrinth. En ligne: http://elab.eserver.org/hfl0288.html (consulté le 21 juillet 2009)
[5] Jay David Bolter et Michael Joyce (1987) Storyspace. Watertown (MA): Eastgate Systems.
[6] À ce sujet, voir Christian Vandendorpe (1999) Du papyrus à l'hypertexte. Essai sur les mutations du texte et de la lecture. Montréal: Boréal, 271 p.
[7] Bertrand Gervais et Nicolas Xanthos (1994) «L’hypertexte: une lecture sans fin» dans Alain Vuillemin et Michel Lenoble (dir.), Littérature Informatique Lecture. Paris: Presses universitaires de Limoges, p. 113.
[8] Espen J. Aarseth (1997) Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: Johns Hopkins University Press, p. 87.
[10] Astrid Ensslin (2007) Canonizing Hypertext. Explorations and Constructions. Londres: Continuum International Publishing Group, p. 69-70.
[11] Jean Clément (2000) «Afternoon, a Story: du narratif au poétique dans l'œuvre hypertextuelle», Département Hypermédia, Université Paris 8. En ligne: http://hypermedia.univ-paris8.fr/jean/articles/Afternoon.htm (consulté le 21 juillet 2009)
[12] J. Yellowlees Douglas (2009) «"How Do I Stop this Thing?" Closure and Indeterminacy in Interactive Narratives» dans Mark Bernstein et Diane Greco (éd.), Reading Hypertext, p. 66. Watertown (MA): Eastgate Systems.
[14] Snyder, Ilana (1996) Hypertext. The Electronic Labyrinth. Melbourne: Melbourne University Press, p. 89.
[15] Michael Joyce, op. cit., «in my mind». À l’avenir, les références à afternoon, a story seront identifiées entre parenthèses par l’abréviation aft., suivie du titre de la lexie citée.
[16] Christopher Keep, Tim McLaughlin et Robin Parmar, op. cit.
[17] Archibald, Samuel (2009) Le texte et la technique: la lecture à l’heure des médias numériques. Montréal: Le Quartenier, p. 134.
