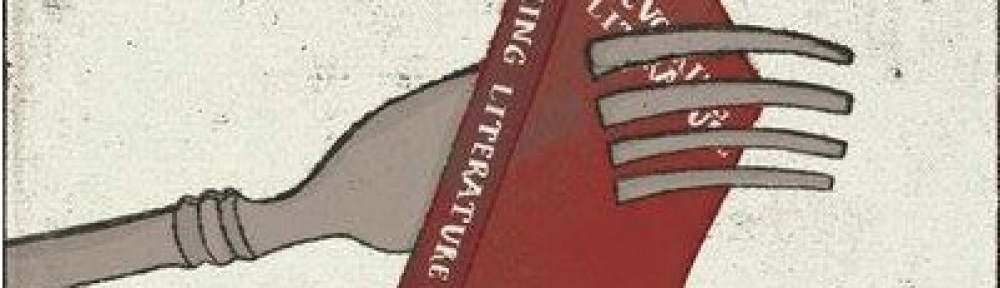Aujourd’hui je vais vous faire partager ma découverte de la semaine passée. En effet, dans le cadre du cours de Méthodologie (FLIT 600) de Monsieur Sylvain David, nous avons dû lire un mémoire de maîtrise qui pouvait s’apparenter au type de sujet ou de recherches sur lesquels nous voulons travailler dans notre propre mémoire. Je fais d’avance mes excuses à certains de mes camarades qui ont déjà entendu mon exposé dithyrambique sur le sujet au dernier cours. Hey les boys, faites comme si de rien n’était : lisez-moi cette semaine, comme si je vous apprenais encore quelque chose de neuf et d’intéressant! (Clin d’œil complice).
Ledit mémoire portait le titre suivant : La quête identitaire des livres de chef : la transformation du discours gastronomique québécois en parole originale. Mémoire publié par Marie-Noëlle Aubertin en mars 2010 dans le cadre de sa maîtrise en études littéraires de l’UQAM.
Ce qu’on peut y lire, c’est que le livre de chef se distingue du simple livre de recettes (par exemple de celui de Jehane Benoît ou du Cercle des Fermières) par sa parole, son discours.
En effet, comme le livre de recettes a une fonction éducative – on veut nous montrer comment réaliser une recette, voire nous enseigner à cuisiner tout simplement – le vocabulaire sera simple, didactique, concis; les phrases, elles, vont fourmiller de verbes d’action qui donnent une indication précise des étapes de réalisation de la recette. Jamais on ne retrouvera le « je ». Le narrateur du livre est effacé. On opte pour la formule impersonnelle du « on » très souvent. Voilà pour le contenu. Pour le contenant : c’est tout aussi simpliste : une petite photo de la main qui fouette le liquide avec l’outil de cuisine et une photo (ou non) du plat réalisé pour nous montrer à quoi il devrait ressembler après avoir suivi les étapes de réalisation.
Pour le livre de chef, il en va de toute autre chose. Comme il remplit d’autres fonctions, le discours qu’on emploiera sera différent du livre de recettes. Et quelles sont donc ces « fonctions »? L’auteure du mémoire en identifie principalement trois : identitaire, autoritaire et une rattachée à l’individualité (le caractère unique) du chef. Ici le narrateur VEUT être présent, laisser sa marque. Il y a nécessairement auto-représentation. D’ailleurs plusieurs chefs ne se gênent pas pour employer dans leur livre la narration au « je » pour décrire les étapes : « je vous suggère de prendre des baies d’Arthabaska, mes préférées… » (Daniel Vézina, Ma route des saveurs au Québec, 2001). Le chef se sert de son livre pour se positionner comme un spécialiste, une sommité, un expert en gastronomie. Son livre reflètera donc son caractère d’autorité en la matière. Il apparaît (en images et en mots) comme le gourou des gourous. Bien sûr, cela a aussi pour but de mousser son image marketing et de l’aider à remplir son restaurant… C’est le principe Hygrade ! Plus de gens viennent dans le restaurant du chef-écrivain car ils ont aimé son livre et plus de gens achètent le livre car ils aiment la cuisine du chef ! (Ça c’est de moi, vous l’aurez deviné! Ne cherchez pas cette allégorie dans le mémoire de Madame Aubertin).L’identité : c’est la couleur de l’artiste. La façon Vézina, le style coloré et provoquant de Martin Picard, par exemple. Le livre prend donc la forme d’un manifeste, d’un récit poétique, d’une œuvre d’art. Le livre contaminé par l’art (Aubertin, p.86). Le livre comme objet d’art et objet unique car le chef EST unique ! À preuve les créations originales du chef ou ses recettes de classiques « revisités », qui donnent à la recette traditionnelle une toute autre forme et couleur. L’objet lui-même, le livre, est l’extension du chef. Il lui ressemble, porte sa signature, sa couleur. Ce type de livre réduit le nombre de pages dédiées aux recettes pour laisser la place aux photos dont l’esthétisme relève du grand art et parfois à des textes qui n’ont rien à voir avec les recettes, comme les réflexions écologiques de Martin Picard dans son livre (Restaurant : Au pied de cochon, l’album, 2006). Finalement, les mots que les chefs emploient pour décrire leurs ingrédients ou leurs titres de recette sont choisis pour démontrer justement ces trois caractéristiques propres au chef (autorité-identité-unicité). On ne dira pas « bouillon de poulet » mais plutôt « bouillon de volaille » et les bleuets sous la plume de Daniel Vézina deviennent des « myrtilles flamboyantes des prés verdoyants de Dolbeau »… Allô Baudelaire !
Il va sans dire aussi que le coefficient de difficulté relié à l’exécution des recettes de livres de chefs est hautement élevé, ce qui ajoute au caractère hermétique du livre. Cet hermétisme tant au niveau du langage employé qu’à celui de la réalisation des recettes elles-mêmes renforce la position d’autorité du chef (lui seul peut le faire – « Oh et puis zut! Je vais aller au restaurant du chef pour goûter ce plat au lieu de le faire! ») et d’unicité (personne ne fait un tartare comme lui). Les plats qu’on a photographiés et mis en valeur dans l’album-livre en témoignent… Novices s’abstenir.
Conclusion : on achète le livre de chefs pour sa beauté esthétique et parce qu’on aime s’en inspirer (plus pour les belles photos de pièces montées) mais on se sert du livre de recettes quand on doit recevoir les amis et qu’on ne veut pas manquer son coup!
Aujourd’hui, le livre de recettes voit ses ventes diminuer car internet fournit de multiples recettes gratuites par le biais de plusieurs sites (Coup de pouce/Ricardo/ Recettes du Québec/Recettes gourmandes/Le p’tit cuistot/À la Di Stasio…). Le livre de recettes a donc tendance (ce sera peut-être le sujet d’une prochaine chronique) à se spécialiser pour contrer la vague technologique des informations sur le Web. On aura ainsi des recettes d’aliments contre le cancer, sur les anti-oxydants, pour perdre du poids et rester en santé, sur un aliment en particulier comme le pitaya, cet aliment méconnu. Ces livres seront signés par des experts en la matière. Exemples : Docteur Béliveau, Josée Lavigueur avec Kilo Cardio, Isabelle Huot, avec un livre sur les anti-oxydants,… Dans un monde où l’image est reine et le web (sur)informe, le livre de recettes prend une toute autre forme pour continuer d’exister. Les chefs, nos vedettes des temps modernes, ont vite compris que le livre de chef est un des moyens de faire parler d’eux et de se distinguer des autres pour attirer la clientèle dans leur restaurant.
Cette lecture (forcée!) du cours de Sylvain David m’a fait beaucoup réfléchir au rôle du chef qui devient un peu un écrivain et usurpe son identité avec la publication d’un livre. Ce qui m’intéresse dans mon projet de mémoire, c’est de trouver l’ alter ego de ces chefs-écrivains. Le principe des vases communicants. En effet, si les chefs se prétendent écrivains, qu’en est-il des écrivains qui décident de s’improviser chefs et utilisent les médias pour mousser leur nouvelle « expertise »? Réussissent-ils à vendre plus de livres grâce à cette nouvelle corde à leur arc ? Sachant que le food est maintenant une religion consacrée avec moult adeptes à travers le monde, en tous cas certainement au Québec, de quelles façons la nouvelle visibilité médiatique de ces écrivains comme gastronomes invétérés s’inscrit dans leurs réalisations créatrices? Est-ce par le langage qu’on peut trouver des similitudes entre écrire et cuisiner ? Ou l’acte d’écrire est-il semblable en d’autres points à l’acte de faire à manger ou de réaliser un délicieux plat ? C’est ce que nous approfondirons dans les prochaines semaines.