Le roman est peu lu aujourd’hui, même s’il a été réédité en 2007. On y rencontre Karen, 40 ans, dont les enfants ont déjà quitté la maison, située dans la banlieue torontoise fictive qu’est Rowanwood – «une terre promise» (27) où tout le monde devrait être bien, presque malgré soi. Le roman débute lors d’une journée spéciale pour la ménagère, alors que Karen assiste à la livraison d’un tapis chinois dont son mari et elle rêvent depuis des années, et qui représente la preuve tangible de leur succès. Mais lorsqu’elle déroule le tapis, Karen voit aussi dérouler les années qui ont passé et ressurgir son désespoir. La première phrase du roman situe l’état d’esprit du personnage de façon absolument claire: «Early morning sunlight warm against the thin, smooth contour of one cheek, Karen sat in the breakfast-room and thought about suicide.» (7) L’arrivée du tapis pourrait se réduire à un prétexte banal pour déclencher l’activité mémorielle, puisque l’objet compte moins que l’accomplissement qu’il représente, mais son importance n’est pas négligeable puisque le tapis est le premier signe indiquant au lecteur qu’il cheminera dans un paysage d’objets: ceux-ci, dans leur nature et leur disposition, seront plus révélateurs des relations entre les personnages, de leurs désirs et de leurs failles que n’importe quel autre élément du récit.
Crédit:
McGill-Queen's University Press
Drummond, David. 2007 «The Torontonians» [Couverture de la réédition de 2007]
Karen elle-même décrit à plusieurs reprises son impression de vivre dans un monde de papier glacé, où les choses et les gens paraissent moins réels que les publicités en couleur occupant des pleines pages dans le magazine Life (165). Tous ses voisins, les boissons qu’ils boivent, les vêtements qu’ils portent, ne lui semblent que des pâles copies de ceux qui apparaissent dans ces publicités. La déprime et la douleur tirent Karen en marge de son propre monde, sur lequel elle pose soudainement un regard distancié et analytique. Le roman est parsemé de commentaires à saveur sociologique – ce que la critique a d’ailleurs reproché à ce roman qui verse parfois dans l’explication didactique –, mais qui constituent pour Karen une manière de combattre son sentiment de désorientation. La banlieue est «un labyrinthe doré», d’où elle sort brusquement. Elle décrit ainsi l’époque précédant sa «révélation»:
During that period the house was Karen’s life. Everything outside of if receded, became vague and of no particular importance. The cold war was like something she had read about in a history book. […] Downtown Toronto was a foreign country which she invaded only when she had to, and then only because she needed something for the house. […] she saw that the city was acquiring a new dimension composed of ever-thickening TV aerials. But none of these things really meant anything to her. (73)
Auteur inconnu. Année inconnue. «Garden party» [Photographie]
La vie de Karen se déroule dans une bulle jusqu’à ce que, sans avertissement, elle s’aperçoive que ses voisins et ses amis tiennent le coup grâce au whiskey et aux tranquillisants (13). Au fil du roman, elle découvre tout ce qui ne fonctionne pas, non seulement dans la vie de ses voisins – des familles pratiquement toutes au bord de l’éclatement -, mais dans le mode de vie nord-américain en général. Elle utilise à plusieurs reprises l’expression «North American wives» pour décrire sa vie et celle de ses semblables, absolument consciente d’une sorte d’identité monolithique construite à la fois par la publicité et les politiques sociales. Sa critique s’étend aux mécanismes d’un capitalisme plus vigoureux que jamais: la «vente à tempérament», le renouvellement régulier de voitures en parfait état, la course aux derniers gadgets toujours plus performants... Elle décrit avec un humour cinglant le rapport à l’argent et à la consommation de ses voisins rongés par l’avidité. Elle voit bien qu’ils sont surtout tous plus désespérés les uns que les autres, hommes comme femmes.
Devenir spectatrice de la détresse d’autrui représente pour elle la plus insoutenable des angoisses, mais également une forme de responsabilité à laquelle elle ne peut plus échapper. La nuit, Karen se poste à sa fenêtre, pour veiller sur son quartier et sur les gens qu’il abrite :
she had scanned the houses she was passing, and known that even though there were people, and plenty of them, in those houses, it would be over-optimistic to expect help […]. In suburbs at night, togetherness, like the palsied wraith it was, ceased to exist. (275)
En effet, sa veille est vaine, puisqu’un soir, elle assiste impuissante à la mort de sa voisine, qui succombe à une crise cardiaque, seule dans son garage. Karen, après plusieurs minutes d’hésitation, se décide à aller lui porter secours, trop tard. La ménagère fait donc figure de témoin d’un mode de vie qu’elle juge néfaste et décadent, mais aussi témoin de la catastrophe mineure qui bouleversera la vie quotidienne de son milieu. Toutefois, c’est cette catastrophe qui mène vers la résolution relativement positive du roman, puisqu’elle semble libérer Karen du sentiment de menace qui l’oppresse. Tout au long du récit, la ménagère ne cesse d’espérer non seulement sa propre fin mais la fin du monde, affirmant qu’elle appuierait à n’importe quel moment sur le détonateur qui provoquerait un cataclysme global. Mais la mort de la voisine apparaît étonnamment comme une compensation valable, elle permet de crever l’abcès, de faire craquer le vernis de mensonge qui recouvrait la vie de Karen et de ses voisines. Ainsi, il leur est possible de reprendre le cours normal des choses.
Je poursuivrai mon analyse dans le prochain billet en abordant un autre roman canadien publié neuf ans plus tard, The Fire-Dwellers, de Margaret Laurence, aujourd’hui beaucoup plus connu (et lu!) que le livre de Young.
Bibliographie
Brett Young, Phyllis. 2007. The Torontonians, Nathalie Cooke et Suzanne Morton. Montréal et Kingston: McGill-Queen's University Press, 325 p.

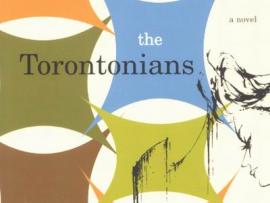


Ajouter un commentaire