24 mai 2012, 18:09
12 sur 20
On retrouve dans The Fire-Dwellers1 de Margaret Laurence, publié en 1969, un imaginaire de la catastrophe permettant de rapprocher ce roman de The Torontonians de Phyllis Brett Young, dont j’ai parlé dans le dernier billet. L’action se passe ici en banlieue de Vancouver et met en scène Stacey, mère de quatre enfants en bas âge.
Comme dans The Torontonians, ce roman présente l’univers domestique comme un espace poreux, artificiellement protégé du monde, où la détresse extérieure ne cesse de se faire entendre. Dans ce contexte, la ménagère souffre d’une perception schizophrénique. Alors qu’elle prépare le déjeuner de ses enfants, elle entend «des voix», celles que la radio projette, et dont l’horreur infiltre insidieusement toutes ses actions. Les dialogues familiaux sont retranscrits sans mise en contexte, entre lesquels sont intercalées des manchettes alarmistes, produisant sur la page une espèce de collage hystérique:
Come on, you kids. Aren’t you ever coming for breakfast?
THIS IS THE EIGTH-O’CLOCK NEWS BOMBING RAIDS LAST NIGHT DESTROYED FOUR VILLAGES IN
Mum! Where’s my social studies scribbler?
I don’t know, Ian. Have you looked for it?
[…]
ROAD DEATHS UP TEN PER CENT MAKING THIS MONTH THE WORST IN
I got to take fifty cents, Mum. (87-88)
Stacey est sans cesse assaillie par des visions de fin du monde, que ce soit dans ses rêves la nuit ou en marchant dans le centre-ville de Vancouver. Une comptine vient la hanter, la narguer, lui rappelant sans cesse la fragilité de ce qui devrait être si solide, sa maison («This fortress, which I’d like to believe strong.» (13)), sa famille:
Ladybird, ladybird,
Fly away home;
Your house is on fire;
Your children are gone. (1, 222, 298)
Dans la foulée de la paranoïa de la guerre froide et du sentiment d’insécurité qui accompagne la guerre du Vietnam, la télévision diffuse des reportages sur la construction d’abris anti-nucléaires pour chaque famille. Stacey échafaude des plans pour fuir la ville si une attaque avait lieu: elle s’imagine s’entasser dans la voiture avec son mari et ses enfants et partir vers le nord, vers les montagnes (57). Ce fantasme qui prend quasiment la forme d’un retour à la terre semble l’enthousiasmer plutôt que l’effrayer, jusqu’à ce qu’elle se rappelle qu’aucun membre de sa famille ne saurait survivre plus de 24 heures en forêt.
Stacey se dit dans un état constant de «pré-deuil» (9), elle sent le spectre de la mort la guetter. Comme Karen dans The Torontonians, elle sera elle aussi témoin d’une catastrophe locale, lorsqu’un ami de son fils se fait renverser par une voiture devant ses yeux. Mais contrairement au roman de Young, l’accident arrive ici au début du récit et ne libère pas le personnage de sa tension, il contribue plutôt à alimenter son angoisse. Le fait d’enfiler les gin tonics en préparant le souper, de se saouler dans les partys de bureau de son mari, de prendre un amant, ne contribuent pas à soulager Stacey, au contraire. Elle paraît de plus en plus engourdie. Même devant la montée des mouvements de contestation qui s’organisent à travers l’Amérique, elle ne ressent que scepticisme et embarras, comme dans cette scène où elle participe à une manifestation:
Someone starts singing «We Shall Overcome». Most of the marchers are young. Their voices are strong and certain. […] Stacey tries to sing, but she cannot. […] all I can feel is embarrassment. I might at least have the decency not to feel embarrassed. Maybe I’d feel differently if I had faith. […] It’s like church – you think maybe if you go, the faith will be given, but it isn’t. (267-268)
Stacey quitte la manifestation et revient chez elle en autobus. Sa propre impuissance dans sa vie quotidienne lui apparaît avec trop de force pour qu’elle puisse croire au pouvoir de la révolte. À la fin du roman, son mari obtient une promotion, ses enfants grandissent vite, la famille pourra se payer une maison plus grande, et Stacey décide d’accepter son sort. Pourtant, ses visions ne la quittent pas, elle continue d’imaginer une ville prise par les émeutiers, brûlant dans la rage et désolation: «I see it and then I don’t see it. It becomes pictures. And you wonder about the day when you open your door and find they’ve been filming those pictures in your street.» (296) Le roman se clôt alors que Stacey dit sentir la ville disparaître pendant qu’elle-même verse dans le sommeil.
The Fire-Dwellers et The Torontonians se terminent donc tous deux dans un apaisement relatif, ou en tout cas dans un mouvement de retour à la vie normale. Malgré la crise passagère de la ménagère, l’édifice social, l’édifice familial sont épargnés, ils s’en trouvent même solidifiés. Pourtant, dans The Fire-Dwellers, en particulier, le constat de Stacey est sombre et cynique, et les cibles se multiplient: «I was wrong to think of the trap as the four walls. It’s the world.» (294) Ces romans ne fournissent donc pas seulement un commentaire sur le cercle vicieux de la condition féminine, mais également sur celui que constitue l’idée de progrès. Est déjà contenue ici l’idée que les transformations sociales qui se succèdent dans les années 60 ne seront pas suffisantes, que le règne des objets et de l’argent est là pour rester. La vision du capitalisme transmise dans ces textes est celle d’un cul-de-sac, puisque le sentiment de révolte du sujet se résorbera toujours, ultimement; le marché ne produit pas uniquement des biens de consommation, mais de la satisfaction en barre.
Le point de vue adopté par les deux narratrices est celui d’un témoin radicalement impuissant: immobile, isolé, forcé de regarder la course du monde depuis un repaire pas si sûr. L’horreur y surgit constamment comme un bruit de fond. Cette position passive leur est reprochée: Stacey lit par exemple dans une revue féminine que les ménagères surprotectrices et angoissées «anéantissent la force vive de la nation». On les blâme en fait d’incarner les faiblesses d’une société apparemment pimpante de santé. Elles témoignent d’un malaise encore informulé, d’une souffrance incompréhensible, presque indécente, dans un monde d’abondance et de paix. Leur énonciation est marquée par cet empêchement, cette impression de parler depuis une position intenable. La voix narrative des deux romans est divisée, passant du «elle» au «tu» dans The Torontonians, et du «elle» au «je» dans The Fire-Dwellers, les narratrices ayant du mal à prendre en charge leur propre expérience (non seulement de femme mais de sujet souffrant), multipliant les stratégies textuelles pour faire de leur mal-être une simple digression à l’intérieur d’un récit national plus grand et plus triomphal.
Ces ménagères dévoilent sans pudeur les plaies du corps social.
Dans l’exposition d’un désarroi franc, sans origine apparente, vécu dans l’isolement du chez-soi, ces écritures sont plus contemporaines que jamais. C’est pourquoi on pourrait parler d’une énonciation sur un mode prophétique : en ce sens que ces romans semblent déjà contenir en germe plusieurs éléments structurants de l’imaginaire contemporain (sentiment de menace imminente, atomisation de la société, recentrement sur le temps du quotidien), mais aussi en ce que ces voix colériques accusent et condamnent une société qui semble courir à sa perte. Ces ménagères-prophètes exposent un mode de vie sous ses pires aspects et en jugent les acteurs, dont elles sont les premières représentantes. Elles jugent leur propre incapacité à changer les choses, elles qui épient le déroulement du monde depuis leur cuisine et ne sont en mesure de lire les enjeux sociopolitiques qu’à travers le filtre de leur vie privée. Le portrait qu’elles peignent de leurs communautés toxiques, enclavées dans les limites faussement étanches de la banlieue, exacerbe les tares d’une société perpétuellement en crise: mensonge, fraude, ostracisme, maladie mentale, suicide… Ces ménagères dévoilent sans pudeur les plaies du corps social.
Bibliographie
Brett Young, Phyllis. 2007. The Torontonians, Nathalie Cooke et Suzanne Morton. Montréal et Kingston: McGill-Queen's University Press, 325 p.
Laurence, Margaret. 1969. The Fire-Dwellers. Toronto: McClelland & Stewart Ltd., 305 p.
- 1. Margaret Laurence, The Fire-Dwellers, Toronto, McClelland & Stewart, coll. «New Canadian Library», 2009 [1969], 305 p. Toutes les citations renvoient à cette édition.
Pour citer ce document:
. 2012. « La ménagère désespérée (4/5): The Fire-Dwellers (1969) ». Dans Suburbia: l'Amérique des banlieues. Carnet de recherche. En ligne sur le site de l’Observatoire de l’imaginaire contemporain. 24 mai 2012. <https://oic.uqam.ca/fr/carnets/suburbia-lamerique-des-banlieues/la-menagere-desesperee-4-5-the-fire-dwellers-1969>. Consulté le 1 mai 2023.
Aires de recherche:
Période historique:
Contexte géographique:
Problématiques:
Objets et pratiques culturelles:
Figures et Imaginaires:

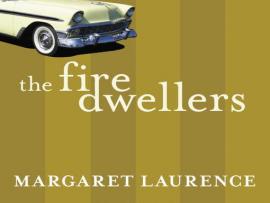

Ajouter un commentaire