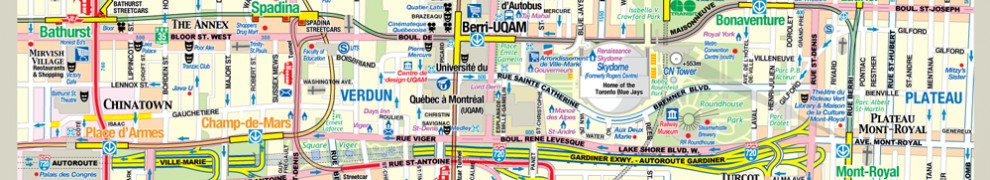Ce trimestre, je suis un cours en méthodologie de recherche, en vue de déposer mon projet de mémoire en mai. L’un de nos premiers projets est d’expliquer, en cinq minutes, la problématique qui nous intéresse, et ce que l’on a déjà pu découvrir à son propos. Dans un esprit d’ouverture, je présente ici cette petite introduction à mon projet. En une trentaine de mots, mes questionnements se résument ainsi: 1) qu’est-ce que les réseaux sociaux peuvent nous dire sur le discours social ambiant qui ne se saurait pas ailleurs? et 2) qu’est-ce que la théorie littéraire peut expliquer des réseaux sociaux qui ne s’expliquerait pas autrement?
Définissons nos termes
Par réseaux sociaux (ou ‘social media’), on entend l’ensemble de sites et d’outils en ligne qui permettent aux utilisateurs de publier des images, du texte, des vidéos, etc., et de commenter, partager et éditer les publications d’autres utilisateurs, dans un endroit libre de hiérarchie explicite. Cela s’oppose aux médias traditionnels, où la publication est restreinte à quelques acteurs désignés (l’écrivain dans une maison d’édition, le journaliste dans un journal, le metteur en scène au théâtre) et où il y a une hiérarchie explicite (le journaliste rend son travail au rédacteur en chef qui l’approuve, et qui l’envoie au conseil d’administration pour le faire approuver; la personne lectrice n’est pas libre de répondre directement).
Ici, nous voyons se dessiner une distinction importante: dans les médias traditionnels, on peut parler de la personne lectrice comme ‘consommateur’ de production médiatique, qui a à peu près les mêmes droits qu’un consommateur d’aliments dans un restaurant: on est libre de quitter le restaurant, de plus jamais y revenir, de publier une critique en ligne ou sur papier, mais point d’entrer dans la cuisine et de changer des choses. Le consommateur médiatique est alors passif devant l’oeuvre qu’il lit. Sur les réseaux sociaux, par contre, la personne lectrice est plus proprement considérée comme un ‘collaborateur’. Au lieu de consommer ce qu’on lui sert au restaurant, un collaborateur assiste plutôt à un pot-luck, où chaque invité prépare un plat et tout le monde mange un petit peu des contributions des autres. Ils parlent de leurs créations et s’exposent aux pratiques et aux visions des autres. Le collaborateur médiatique ne peut être qu’actif dans la création de l’oeuvre, qui n’appartient dans sa totalité à personne.
Le cas de Twitter
Jusqu’ici, mes recherches n’ont visé que Twitter. Il y a deux raisons pour cela:
1) Sa simplicité. Sur Twitter, chaque intervention comporte une limite stricte de 140 caractères. Chaque tweet ne peut comporter que quatres fonctions de base: le texte simple (visée de la théorie littéraire, bien sûr), le @profil (qui sert à adresser un tweet à un utilisateur en particulier), le #hashtag (qui sert à insérer un tweet dans le discours entourant un #sujet particulier) et le hyperlien (manifestation pure de que Genette appelle l’intertexualité, c’est-à-dire la présence effective d’un texte au sein d’un autre texte). À ces quatre fonctions de base rajoutent quatre opérations fondamentales: le retweet (où l’on republie verbatim le tweet d’un autre utilisateur), la réponse (qui se fait par la fonction @profil, mais qui permet à Twitter d’afficher à une troisième personne lectrice le tweet auquel on répond, ainsi que la réponse elle-même), le ‘favourite’ (qui désigne au-delà du simple retweet que le tweet en question plaît à la personne qui republie), et l’abonnement (faire afficher les tweets du profil auquel on s’abonne dans son propre flux). Les structuralistes, j’en suis persuadé, auraient eu bien moins de difficulté à formuler leurs théories si la littérature avait adhéré à une structure si nette.
2) Son achalandage. Il y a 500 millions de profils actifs sur twitter. Même si on suppose que les 3/4 (chiffre à confirmer) sont des bots (profils automatisés) ou des sock-puppets (multiples profils alimentés par un seul auteur), cela nous donne quand même 125 millions de personnes uniques dans l’environnement du site. Cela fait quatre fois la population du Canada et treize fois celle du Québec. Parmi eux, Barack Obama, le Pape, NotACop, et l’astromobile Curiosité – c’est-à-dire des vraies personnes qui entrent en contact avec les personnages inventés. Ça fait bizarre, si ce n’est pas intéressant.
Que sait-on déjà de Twitter?
Beaucoup et pas beaucoup. Twitter se distingue des autres réseaux sociaux, cela on le sait déjà. Sur Twitter, il y a parfois, mais pas toujours, une correspondance entre le nom et l’image du profil et l’identité de la personne derrière le clavier (sur Facebook, ce lien étroit est obligé par les conditions de l’utilisations du site – il faut normalement que ça soit son vrai nom et sa vraie photo sur son profil, et cela tient à 95% (chiffre à vérifier)). Sur Twitter, il y a une limite très stricte du nombre de caractères qu’un message peut comporter (sur Reddit ou Wikipédia, il n’y a pas de telle limite). Sur Twitter, il y a beaucoup de monde (sur Google+, il n’y en a presque pas).
On sait qu’il n’y a pas d’auteur unique sur Twitter. Nous pouvons postuler un ‘texte zéro’ sur Twitter, qui serait la somme totale de tous les messages n’ayant jamais été sur le site. Nous ne pouvons pas observer ce texte, bien que nous pouvons en concevoir son existence. Un texte à auteurs multiples n’est pas quelque chose que l’on trouve souvent dans la littérature traditionnelle – oui, il y a des anthologies (où il est clair que tel auteur a écrit telle partie de l’oeuvre), oui, il y a des romans ayant plus qu’un auteur (où c’est le rédacteur qui est le médiateur entre eux), mais ce n’est pas le même ordre de choses.
On sait que le rédacteur/narrateur est absent de Twitter. Chaque message est publié au nom de son auteur, mais il n’y a pas de superstructure qui vient imposer un sens – la structure de Twitter émerge des messages publiés là-dessus. Il y a des commentateurs qui peuvent a posteriori interpréter la signification de tel ou tel tweet, mais personne qui ne le fait dans une capacité d’autorité, comme le fait le narrateur dans le roman humoristique, qui peut médiatiser entre les différents points de vue qui sont représentés. Dans la littérature traditionnelle, il y a toujours soit un narrateur, soit un rédacteur qui s’assure d’une unité de sens dans l’oeuvre: cette unité est évacuée de Twitter.
So what?
Ce sont juste des petites ébauches de théorie que je me suis permis de publier ici, car le grand travail d’interrogation n’est pas vraiment commencé. Reprenons nos questionnements du tout début:
1) qu’est-ce que les réseaux sociaux peuvent nous dire sur le discours social ambiant qui ne se saurait pas ailleurs?
Ici, il est clair qu’un milieu où peuvent interagir le Pape, le Président, et Curiosity est un milieu fécond pour l’observateur de l’imaginaire contemporain. En mettant ces acteurs sur un pied d’égalité (un profil, une voix, 140 caractères), Twitter permet une interaction libérée en partie des exigences du protocole social qui informe toute interaction dans une société. Moi, en réalité, je prendrais plus que 140 caractères si je m’adressais au Pape, je m’habillerais d’une certaine manière, je me rendrais probablement en Italie pour le faire, je serais entouré d’autres personnes voulant elles aussi lui adresser la parole – bref, c’est une interaction complètement différente de celle que j’ai quand je lui adresse un ‘what’s crackin » en pyjama de ma chambre à coucher. Et, ce qui est de plus, si on se limite à considérer cette interaction dans la twittosphère (et non pas une éventuelle réponse où His Holiness se pointe chez moi pour me dire what’s what, et où les protocoles sociaux normaux s’appliqueront), Sa Sainteté elle aussi est contrainte à me répondre en 140 caractères (peut-être alors qu’il est en pyjama lui aussi).
En fait, la différence entre la médiatisation effectuée entre des individus par les médias traditionnels et celle qu’effectuent les réseaux sociaux, c’est l’instantanéité. Si j’avais voulu écrire au Pape dans mon pyjama en 1950, j’aurais très bien pu le faire, mais il m’aurait fallu des semaines pour avoir une réponse (imaginant qu’il reçoit mon message et qu’il y répond immédiatement). Maintenant, on parle d’un délai de secondes. Si j’avais voulu dire qu’un journaliste était un crétin en 1950, j’aurais très bien pu le faire, mais il m’aurait fallu une semaine pour voir ma lettre dans le journal (dans une autre section) – si le rédacteur avait décidé de l’approuver et de republier. Les réseaux sociaux nous permettent de voir la réponse sociale à un propos où une idée à peu près en temps réel. Si, enfin, cela ne nous permet pas de comprendre de manière différente, cela nous permet au moins de comprendre plus vite.
2) qu’est-ce que la théorie littéraire peut expliquer des réseaux sociaux qui ne s’expliquerait pas autrement?
À cette question, je n’ai pas encore de réponse. Les travaux des structuralistes (surtout Barthes) nous permettent de dessiner une idée de la structure de Twitter, et possiblement les réseaux sociaux en général. Les théories de la lecture (chez Eco, par exemple) et l’idée du maître absent (chez Michel Biron?) nous permettent de combler l’absence de narrateur/rédacteur. Le plurilinguisme chez Bakhtine nous permet de comprendre un peu l’impact d’une multitude de perspectives au sein d’une même oeuvre. La théorie du discours social chez Marc Angenot nous donne une idée des différents discours existants et entourants avec lesquels les réseaux sociaux peuvent entrer en contact. Ces théoriciens ont mis en place des réflexions qui expliquent quelques-uns des phénomènes que le lecteur averti remarque sur Twitter.
Il reste à les développer face à un nouvel objet.
(edit: corrections de S. Marcotte intégrées le 22 janv. 16h45)