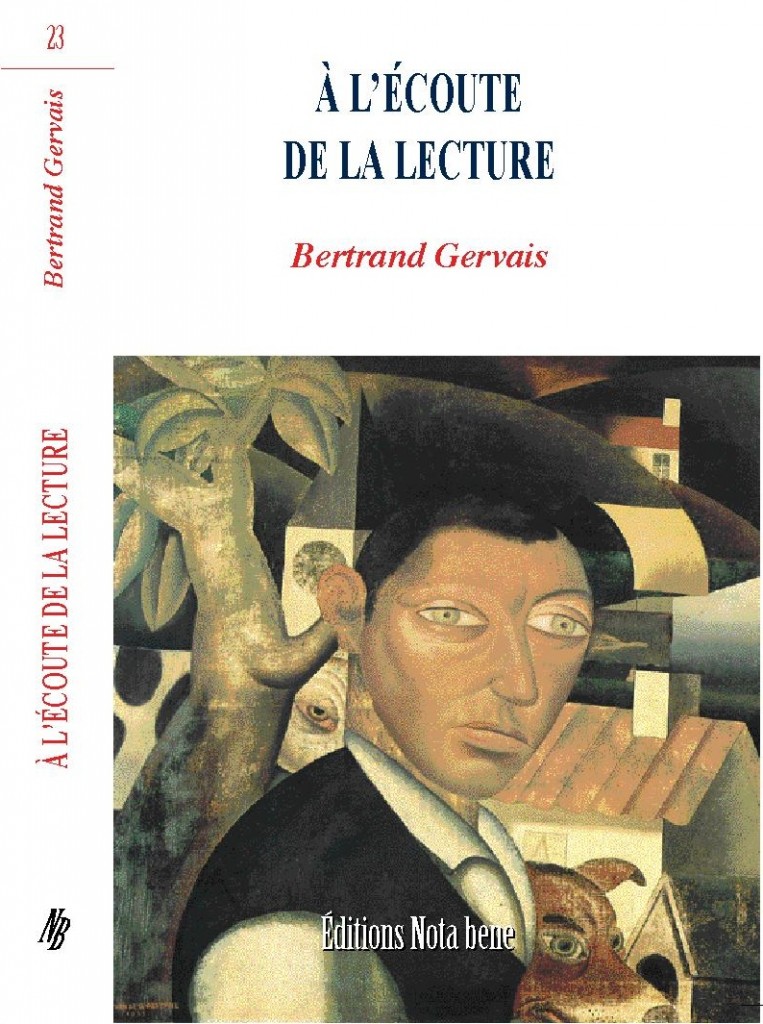
Page titre
À l’écoute de la lecture, Québec, Nota bene, 2006, 294 p.
Extrait de l’introduction
Dans Comme un roman, Daniel Pennac dresse la liste des droits imprescriptibles de tout lecteur : le droit de ne pas lire; le droit de sauter des pages, de ne pas finir un livre, de relire, de lire n’importe quoi, le droit au bovarysme (maladie textuellement transmissible), le droit de lire n’importe où, de grapiller, de lire à haute voix, et surtout de se taire. De ne pas avoir à expliquer sa lecture, de ne pas avoir à communiquer ses résultats, sa compréhension. En fait, le droit de ne pas avoir à faire immédiatement de notre lecture un acte public, pour autrui, un acte de communication, mais au contraire, de lui garder quelque temps encore son caractère privé, personnel. Il faut lire et apprendre à lire pour soi; c’est la seule façon d’aimer la lecture, et peut-être aussi de l’enseigner. Car cette déclaration des droits du lecteur, que livre Pennac, est l’aboutissement d’une entreprise de revalorisation de la lecture. Il faut redonner le goût de lire à ceux qui l’ont perdu ou qui ne l’ont jamais eu, à ceux pour qui lire n’était plus qu’une activité scolaire, un devoir qui se fait dans le cadre d’une classe, un acte public. La lecture n’est pas que cela, elle est même tout autre chose. Elle est, tout à la fois, lecture du journal le matin, d’un œil distrait et à demi ouvert, de ce roman dont on parcourt quelques pages dans le métro, les publicités qui défilent, le mode d’emploi qu’on ne parvient à comprendre que beaucoup trop tard, quand l’instrument dont il prescrit l’usage est déjà maîtrisé, le cahier d’exercices, le dictionnaire consulté à la hâte, l’œuvre littéraire étudiée dans un cours de littérature, pour son style, sa forme, sa réception critique, l’extrait analysé pour le lendemain matin. La lecture est un acte dont la forme varie selon les contextes, les mandats. Il y a ceux, privés, que nous nous donnons à nous-mêmes, et dont nous sommes finalement les seuls juges; et il y a ceux qui nous sont imposés, par l’institution ou le travail, et desquels nous devons répondre. Savoir lire, c’est être en mesure de cumuler ces fonctions, de passer d’un mandat à l’autre, et ne pas perdre de vue qu’on lit d’abord pour soi, dans l’intimité de son silence.
Un peu à la manière de Pennac, mais sur un tout autre registre, cet essai part du fait qu’il existe de nombreux mandats, qu’il y a donc des régies de lecture, dont la première est avant tout personnelle, privée. Il ne s’agit pas d’une simple constatation, ce principe s’impose comme prémisse même de toute mon argumentation. L’acte de lecture varie selon les besoins, les moments, les buts qui sont fixés; et toute théorie du lire doit tenir compte de la diversité de ces régies. Il n’y a pas un seul acte de lecture dont on pourrait faire une théorie unifiée et globale, il y a une multiplicité d’actes dont il faut reconnaître et, par suite, définir les variables.
Dans la première partie de cet essai, je tente d’établir le principe des régies de lecture. Le rapport au texte apparaît comme un travail dont la forme est réglée par le jeu de deux économies. Ce sont les économies de la progression et de la compréhension. Le principe de leur définition est simple, il consiste à remarquer que lire est à la fois progresser dans un texte et le comprendre; leur jeu repose, quant à lui, sur le fait que, selon les mandats du lecteur, l’un ou l’autre geste est privilégié: comprendre plus ou progresser davantage. Ce jeu permet d’établir diverses situations ou régies de lecture. Deux situations limites sont proposées, qui correspondent aux bornes des possibilités de variation de l’acte. L’une, la borne inférieure, est une lecture-en-progression, une lecture par conséquent régie par le besoin de progresser plus avant dans le texte, lors d’une lecture première par exemple; l’autre, la borne supérieure, est une lecture-en-compréhension, fondée sur le projet d’accroître la compréhension du texte, comme lors de lectures littéraires. Lire se déploie donc en fonction de ce double horizon des limites lecturales.
Parmi les textes qui sont donnés à lire, dans cette partie, deux surtout méritent d’être signalés. L’un est la nouvelle d’Alphonse Allais, « Un drame bien parisien ». Ce texte est déjà célèbre, ayant fait l’objet d’une importante étude de la part d’Umberto Eco, en illustration de sa théorie du Lecteur Modèle. La lecture que j’en offre montre ce qu’une conception différente de la lecture, respectant des principes tout autres, permet d’ajouter à la compréhension du texte. Le second est une nouvelle de l’écrivain américain Donald Barthelme, intitulée « Engineer-Private Paul Klee Misplaces an Aircraft Between Milbertshofen and Cambrai, March 1916 ». Cet écrivain minimaliste, à l’humour tranchant (on peut penser à Snow White ou à Unspealable Practices, Unnatural Acts), est peu connu au Québec, mais ses satires, fables, parodies et contes illustrés en ont fait l’un des auteurs les plus lus du postmodernisme américain. Dans le cadre de cet essai, j’ai travaillé à partir du texte anglais, mais on trouvera en note les extraits cités tels qu’ils apparaissent dans le recueil Émeraude, paru chez Denoël en 1992.
La seconde partie de cet essai se veut une sorte d’application pratique des régies de lecture, une démonstration des résultats de l’application de deux mandats de lecture différents. Un roman, Le libraire de Gérard Bessette, est soumis à diverses lectures dont les finalités et les projets sont totalement distincts: une lecture première en quelque sorte, une saisie approximative du roman, et des entreprises critiques plus complexes, de réception, d’évaluation et d’interprétation du texte. Il s’agit de comparer les résultats de ces deux types de lecture afin de déterminer quelles opérations ont été faites sur le texte et, surtout, de quelle façon sa compréhension varie selon les mandats.
Le cas du Libraire est intéressant à plus d’un point de vue. Voici un roman qui a été beaucoup lu au Québec depuis les années soixante, voici un texte qu’on donne encore à lire dans nos classes, voici un texte surtout dont l’interprétation s’est déjà en quelque sorte stabilisée. Le roman fait partie des tout premiers textes de la révolution tranquille, dont il anticipe la venue par sa dimension satirique, sa critique de la société canadienne-française, et son personnage principal, Hervé Jodoin, apparaît comme un de ses premiers héros, un des premiers personnages mythiques québécois. Jodoin est perçu en effet comme un précurseur important de l’identité nationale contemporaine, un révolutionnaire avant la date qui n’a d’autre choix que de vivre en marge d’une société et d’un système de valeurs qu’il rejette. Cette interprétation a assuré au roman et à son narrateur-diariste une présence soutenue dans les études québécoises. Elle a imposé par contre une attitude et une attention de lecture bien précises, qui ont eu un impact important sur le texte. Elles ont fait en sorte de modifier de façon substantielle la figure du narrateur, le transformant d’un personnage cynique et désabusé en héros de la révolution tranquille; d’effacer le plus possible certains problèmes temporels du récit; de négliger la satirisation du lecteur qui est un des principaux jeux du texte. C’est en confrontant une expérience première du texte à certaines de ses lectures critiques, surtout nationales, qu’il a été possible d’identifier ces principaux effets. Ils sont dus à l’application de certains présupposés et principes interprétatifs, au mandat que s’était donnée une communauté de critiques et d’intellectuels québécois, à savoir d’établir les jalons d’une identité nationale, de mettre au monde un sujet québécois contemporain. La confrontation des lectures introduit donc à une relecture de ce roman de Bessette, à une remise en question de certaines interprétations établies. Elle permet en fait, et à un second degré, de voir à l’œuvre une communauté interprétative, selon l’expression de Stanley Fish.
