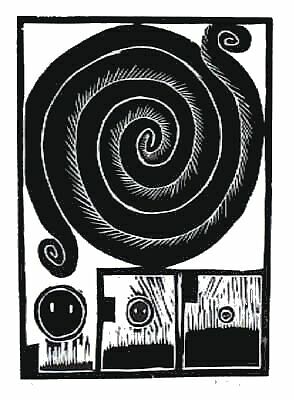Dans Le tiers-Instruit, Michel Serres réfléchit à sa propre contrariété et aux formes diverses de l’apprentissage. Il en vient à adopter une attitude renversante face au devenir droitier des gauchers. Il affirme ainsi ne conseiller à personne « de laisser un enfant gaucher libre de sa main, surtout pour écrire » » (Éditions François Bourin, 1991, p. 35). Il le fait, non pas parce qu’il tient à refouler sadiquement cette frange de la population, mais parce que cette rééducation est un apprentissage de la complexité. Elle fait des gauchers des êtres uniques, qui connaissent la troisième rive.
Je cite le passage in extenso, seule façon de comprendre la pensée parfois étonnante de Serres.
« Travail extraordinaire, écrire mobilise et recrute un ensemble si raffiné de muscles et de terminaisons nerveuses que tout exercice manuel fin, d’optique ou d’horlogerie, est plus grossier en comparaison. […]
Faire l’entrée de ce monde nouveau en inversant son corps exige un abandon bouleversant. Ma vie se réduit peut-être à la mémoire de ce moment déchirant où le corps explose en parts et traverse un fleuve transverse où coulent les eaux du souvenir et de l’oubli. Telle partie s’arrache et l’autre demeure. Découverte et ouverture dont toute une vie professionnelle d’écriture décrit, par la suite, la cicatrisation différée.
Cette balafre suit-elle avec fidélité la suture vieille de l’âme et du corps? Le gaucher dit contrarié devient-il ambidextre? Non, plutôt un corps croisé, comme une chimère : resté gaucher pour le ciseau, le marteau, la faux, le fleuret, le ballon, la raquette, pour le geste expressif sinon pour la société – ici le corps – il n’a jamais cessé d’appartenir à la minorité maladroite, sinistre, prétend le latin – vive la langue grecque qui la dit aristocrate! Mais droitier pour la plume et pour la fourchette, il serre la bonne main après la présentation – voici l’âme –; bien élevé pour la vie publique, mais gaucher pour la caresse et dans la vie privée. À ces organismes complets les mains pleines.
[…] Je ne conseillerai à personne de priver un enfant de cette aventure, de la traversée du fleuve, de cette richesse, de ce trésor que je n’ai jamais pu épuiser, puisqu’il contient le virtuel de l’apprentissage, l’univers de la tolérance et le scintillement solaire de l’attention. Lesdits gauchers contrariés vivent dans un monde dont la plupart des autres n’explorent que la moitié. Ils connaissent limite et manque et je suis comblé : hermaphrodite latéral. » (p. 35-36)
Je ne crois pas avoir la sagesse de Michel Serres. Ma vie est encore une rébellion. Et je ne suis pas prêt à pardonner. Le syndrome de Stockholm, très peu pour moi merci… S’il eut fallu qu’il me dise ça de vive voix, je n’aurais pas su quoi lui répondre. Je ne sais même pas si j’aurais été capable de me retenir. Priver un enfant de l’aventure d’une rééducation inutile! Quelle ironie… À ce compte, pourquoi ne pas le priver de la vue ou d’un membre ou d’un parent? Il faut apprendre à combler les déficits, c’est le principe de la résilience. Je veux bien. Mais doit-on en faire un programme social? Imaginer des cursus scolaires composés à partir de contraintes physiques et cognitives? Cela dit, penser que tous les droitiers de ce monde puissent être forcés à écrire de la main gauche est un grand amusement.